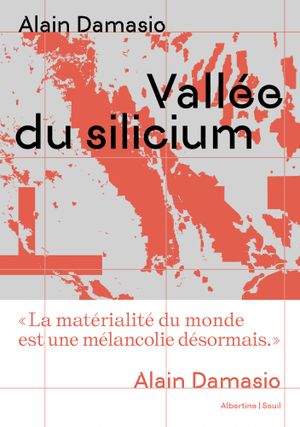La sortie d'un livre d'Alain Damasio est toujours un événement pour les amateurs de littérature fantastique et de science-fiction à la française. À tel point que l'auteur est désormais reçu et écouté bien au-delà des cercles habituels de la littérature qu'on qualifiera "de l'imaginaire". Il a le droit à ses passages à la Grande Librairie, chez France Inter, Quotidien ou Blast. Car Alain Damasio n'est pas qu'un auteur, il est aussi un homme très engagé, comme l'a bien montré son dernier roman, datant de 2019. Les Furtifs étaient autant une fiction qu'un pamphlet contre les sociétés de surveillance – "de trace", dirait-il. Un auteur assez ouvertement anti-capitaliste, également, que je pensais être le seul à lire parmi mes collègues de chez Microsoft (entreprise que j'ai quitté par conviction en 2022), à la sortie de ce dernier roman. Loin s'en faut ! Je n'étais pas le seul à porter en moi des contradictions, semblait-il.
Cette fois-ci, Alain Damasio ne passe plus par le truchement de la fiction pour critiquer les évolutions de notre monde, qu'il juge tour à tour intrigantes ou inquiétantes. Il livre en effet, avec "Vallée du silicium", son premier essai. Un essai clairement techno-critique, mais qui réfléchit à des visions positives de notre avenir technologique. Un essai qui est une suite logique à son œuvre fictionnelle ; car la science-fiction de qualité, comme la sienne, dit toujours beaucoup de notre réalité et de ses problèmes. Il ne peut d'ailleurs s'empêcher d'y glisser quelques morceaux de fiction.
Un essai techno-critique, donc, même si ce n'est pas une "matière" en soi. Un essai sociologique, philosophique, politique. Un premier essai, nous l'avons dit, et cela dans tous les sens du terme, car tout n'y est pas parfait. On y retrouve sa plume de romancier, qui s'égare dans des rêveries parfois brumeuses ; cela est excitant dans un roman, où l'on s'attend à être emmené au loin, voire mené en bateau. C'est selon moi plus embêtant quand il s'agit de suivre un fil de réflexion clair, comme dans un essai de ce type.
Damasio ne perd pas non plus ses marottes. Il aime jouer avec les mots. Cela offre des réflexions étymologiques très intéressantes, sur ce que l'irruption de nouveaux mots dit de notre époque. Cela donne aussi quelques moments de grâce. Mais il retombe parfois dans ses travers. À trop aimer jouer avec les mots, on tombe dans le gimmick qui peut sonner faux. À trop vouloir jouer avec la ponctuation, on complexifie un propos qui n'en a pas forcément besoin. Il perpétue ces problématiques, qui m'avaient déjà dérangé dans ses Furtifs – où je trouvais qu'il se parodiait parfois lui-même, et dans lequel il avait voulu caser tant de sujets que l'on s'y perdait souvent. Par bonheur, sa Vallée se tient beaucoup mieux à mes yeux. Peut-être grâce à une durée plus contenue, à une structure plus claire.
Une fois que j’ai dit cela, il faut préciser que la vision de Damasio sur le sujet est originale : de ces arts de la poésie déstructurée et du jeu de mot copywrité à l’extrême, il fait un combat. Car sa vision, qu’il n’évoque pas dans le livre, mais qu’il énonce dans des prises de parole par ailleurs, est que seul.e.s les auteurs et autrices qui osent le plus pourront surnager dans la masse des textes écrits, sans génie mais avec efficacité, par les IA qui arrivent. Alors peut-être est-ce moi qui ait l’esprit trop étriqué, pour l’instant ? C’est tout à fait possible. Je pense comme lui que, si l’IA peut avoir un bénéfice pour les écrivain.e.s, c’est de les pousser dans leurs retranchements. Voilà : avec Damasio, même quand on parle de la forme, on parle du fond. Et c’est tout de même très beau.
Mais quid du fond et du propos de cet essai, justement ?
Ce livre est du genre de ceux qui m'a donné envie de beaucoup surligner, souligner, annoter. Il ne dit pas toujours que des choses que vous ne saviez pas déjà ; mais même si vous saviez, il le dit avec une finesse d'esprit dont vous n'auriez pas été capable. Damasio y manipule beaucoup de concepts et d'idées, à l'aide de chapitres thématiques, où il narre ses rencontres avec des autochtones de la Silicon Valley et de la Baie de San Francisco. Il y exprime sa vision critique ; y rejette des assertions simplistes ; y insiste sur la nécessité de construire un futur technologique désirable ; y milite pour une éducation aux technologies.
Allez, déplions tout cela ensemble. Au fur et à mesure, j'y ajouterai, humblement, mes propres critiques.
Intelligences amies
L'une des idées fortes que Damasio exprime dans son ouvrage, est que la troisième grande révolution de l'ère de l'information est bientôt là. Après l'avènement d'internet, puis celui du smartphone, voici venu le temps de l'IA générative. Non pas dans sa forme actuelle, mais dans celle d'IA pleinement personnalisées, qu'il appelle "intelligences amies". Des IA qui nous accompagneront au quotidien dans toutes nos tâches, selon lui. Il a bien raison d'écarter d'un revers de la main le métavers, la réalité virtuelle et autres gadgets en tant que révolutions potentielles.
En revanche, je dois dire que je ne partage pas entièrement son avis sur la forme que prendra le phénomène. Car il y a quelque chose d'infiniment plus intrusif, dans ces IA personnalisées, que ce que nous vivons actuellement. Du moins, plus visiblement intrusif, la chasse à nos données personnelles étant ouvertes depuis bien longtemps. Que certaines personnes passent à ces modèles d'intelligence amie avec excitation, je pense que cela arrivera en effet. Comme ceux déjà obsédés par la domotique ou la mesure de leurs données de santé. Mais cela restera, à mes yeux, limité. L'échec commercial relatif des assistants personnels vocaux est un premier indice. Et puis, qui a vu le film Her (❤️) en se disant que c'était une évolution attractive de notre rapport à la technologie ? Sam Altman, le patron d'Open AI, visiblement. Mais clairement pas moi.
En revanche, que l'IA générative ait à terme un impact sous-jacent sur notre utilisation des autres outils technologiques – de manière plus discrète, justement – ça c'est autre chose et c'est très probable. Cela a même déjà commencé. Il manque cependant pour moi, dans le livre, l'évocation des limites techniques à cette vision. Imaginons que chaque individu, rien que dans les pays les plus riches, ait sa propre intelligence amie, utilisée au quotidien. Quid des gigantesques quantités de données nécessaires pour entraîner tous ces modèles ? On parle déjà des limites de ressources de données pour entraîner les IA, alors que nous n'en sommes qu'aux balbutiements de la technologie. Et avec quelle énergie ? Sam Altman, encore lui, explique qu'il va falloir trouver d'autres sources d'énergie pour alimenter ses modèles d'IA d'ici à quelques années seulement, comme la sacro-sainte fusion nucléaire… Bref, pour moi, cette forme de l'IA reste de l'ordre de la SF à ce stade.
Ni technophobe, ni technophile. Mais technocritique ?
Damasio le dit de manière très claire dans son ouvrage : "une authentique technocritique ne peut se contenter d'être réactionnaire ou négative. Elle doit aussi esquisser ce que serait une technologie positivement vécue." Je le rejoins sur ce constat. Si je vous parle de tech avec TFTT, c'est parce que ce milieu me passionne. Même si je suis bien lucide sur le fait que j'y évoque plutôt mes inquiétudes. C'est l'angle que j'ai choisi, et je le trouve important, j'y reviendrai.
Quoi qu'il en soit, il est évident que tout dans la tech n'est pas à jeter, loin s'en faut. Elle peut bien améliorer nos vies sur toute une série de sujets, et elle l'a d'ailleurs déjà fait. Cependant, voir à l'extrême inverse les techno-solutionnistes de tout bord nous présenter la tech comme seule solution à l'ensemble de nos problèmes me semble infiniment "aliénant, asséchant et dangereux", comme le dit Damasio lui-même, à propos des technologies de contrôle de notre santé.
Damasio donne ainsi des clés pour construire une relation positive mais critique avec la technologie, et notamment avec l'IA, dans le cadre du modèle que j'exposais précédemment. Il nous dit : "à nous de construire cet art de vivre avec l'IA, en appliquant à cette relation tout l'arsenal éthique, psy, philo et socio que nous mobilisons pour nos relations embroussaillées avec les autres vivants." C'est tout simple, quand y pense. On vit après tout une époque où l'on questionne plus que jamais nos rapports aux autres. La toxicité dans le couple, au travail, dans nos familles, est devenue un sujet clé qui sous-tend des discussions et mouvements salutaires, par exemple. Et si on peut apprendre à débusquer les mécanismes négatifs imposés par un autre être vivant, il doit pouvoir en être de même avec des mécanismes technologiques. La problématique n'est pas la même quand il s'agit de combattre l'armée de psychologues cognitifs d'une grande entreprise de la tech, certes. Mais ce parallèle a en tout cas beaucoup nourri mes réflexions sur le sujet ces dernières semaines.
Dans un même ordre d'idée, Damasio évoque des visions extrêmes comme le transhumanisme, et le projet farfelu d'Elon Musk, Neuralink : "si le transhumanisme croit qu'il manque à l'homme quelque chose que seule la techno pourra lui apporter, j'ai la tranquille et furieuse conviction que l'être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie pleine, intense et féconde. Tout est déjà en nous." Damasio tire cette conviction d'un échange avec un spécialiste à San Francisco, au sujet des interfaces hommes-machines. Cet individu explique que la meilleure méthode pour créer des interfaces avec la technologie reste, plutôt que d'aller coller des morceaux de métal dans la tête des gens, de… discuter. Le langage. Ce n'est sans doute pas pour rien que l'IA générative se construit sur la base de modèles de langage ! Il ne faut donc pas céder aux sirènes les plus technophobes et technoflippées : Musk, aussi fou soit-il, ne parviendra pas à nous transformer en cyborgs, et l'IA ne va pas nous anéantir comme Skynet dans Terminator.
Damasio rejette dans le même temps les visions technophiles simplistes qui déclarent que "les technologies sont des outils, à nous d'en faire bon usage." Car les outils offerts par la tech ne sont pas neutres. Ils ne sont pas que des supports, ils portent aussi des visions du monde. Ceux qui disent ainsi que tout dépend de l'usage oublient (volontairement ?) les biais impliqués par les créations des dits outils. Des biais de genre et ethniques qui minent l'inclusion et la diversité, des personnes et par extension des idées. Des biais sociétaux plus larges qui impliquent une certaine vision de la vie, généralement basée sur l'idée de productivité. Et des biais politiques de plus en plus visibles, quand on assiste en direct au nervous breakdown d'Elon Musk. Bref : "à la lumière d'une méthode se trahit toujours une vision du monde", exprime l'auteur.
C'est là que mes opinions divergent avec Damasio, cela dit. Car il semble conserver, pour justifier cet équilibre entre "phobie" et "philie", un enthousiasme béat envers les possibilités ouvertes par son concept "d'intelligences amies", que je ne partage pas. Il dit ainsi : "par trouées, nous pouvons entrevoir un art de vivre avec la technologie qui nous ouvre le monde plutôt que de nous le filtrer". C'est beau. Mais est-ce vrai, dans un modèle techno-capitaliste duquel je ne vois pas, à ce stade, la sortie ? La tech pourra-t-elle être le chaînon d'un "art de vivre" tant qu'elle ne sera trustée que par des multinationales, dont le seul but final est le profit à tout prix, sans éthique et sans contre-pouvoir ? Si ce n'est pour quelques "élus" maitrisant déjà parfaitement ces outils, je ne le crois pas.
Mais quel que soit notre niveau d'optimisme, une seule chose pourra nous permettre de créer un rapport positif, ou du moins plus équilibré et apaisé, avec la tech qui vient : l'éducation.
La clé du bouquin : le besoin d'éduquer toute notre société à la tech
Damasio conclut son essai par une idée pivot : il nous faut, toutes et tous, nous éduquer à la technologie. Peu importe notre âge, nos métiers, nos opinions. La tech peut nous "empuissanter", comme nous emprisonner, tout dépend de qui maitrise qui. Il est donc nécessaire de voir le "commun des mortels" mieux s'approprier les outils mis à notre "disposition" par la tech, pour les rendre économiquement et sociologiquement non (ou moins) dangereux. L'IA, bien utilisée, pourrait ainsi être le meilleur outil pour régler certains problèmes induits par l'avènement des GAFAM. Elle pourra (et peut déjà) gérer nos problèmes d'infobésité, par exemple. Mais aujourd'hui, qui sait bien l'utiliser, à part ces fameux "élus" que j'évoquais plus haut ?
Pour parvenir à cela, il faut dès le plus jeune âge éduquer aux mécanismes des plateformes, des algorithmes, des IA, des loisirs en ligne et leurs méthodes très questionnables. La modification de l'éducation qui doit venir, elle est là. Elle doit se faire en dehors des offres des grands de la tech, qui ne perpétueront que des objectifs mercantiles. C'est le cas de Microsoft ou Google en France, avec leurs cours d'apprentissages de l'IA dont le but in fine reste principalement d'habituer le plus grand nombre à leurs outils propriétaires. C'est le coup de la suite Microsoft Office ou Google Workspace mais pour l'IA, rebelote. Cette éducation, elle doit donc se faire via le tissu associatif, dans l'entre-aide, et par l'intermédiaire des sachants. Loin de moi de me considérer comme un sachant au vu de mes limites techniques, mais je crois que le travail que j'entreprends avec TFTT existe aussi dans cet optique. C'est ce qui explique pour moi cet angle plus critique que neutre.
Mais cette éducation, elle doit aussi se faire au sein de nos structures étatiques et publiques, pour en garantir une réelle portée et l’indépendance la plus totale possible. Comme le dit Damasio assez frontalement : "la techno doit passer de matière-poubelle décérébrée à un statut aussi crucial que le français et les maths pour émanciper nos collégiens et nos lycéens par la connaissance et la pratique lucide des réseaux." Sur les écrans, comme sur le reste, rien ne sert d'interdire, il faut accompagner. Mais quand on voit les propositions soumises à Macron, les annonces de Choose France, les réformes de Blanquer creusant les inégalités de genre sur les matières scientifiques ou bien les obsessions très « ancien monde » de Gabriel Attal pour l'autorité et les uniformes… nous ne sommes pas sorti.e.s de l'ornière. À moins que ?
Damasio ne chôme pas, en tout cas : il propose, en guise de conclusion, des axes d'apprentissage, et même ce qui pourrait être la base d'un programme !
L'ouverture vers un avenir technologique et /ou désirable ?
L'idée qui, à titre personnel, m'a le plus touché dans le livre, n'est pas sa conclusion. C'est cette idée de la nécessité d'investir l'avenir, technologie incluse, de manière positive. Car nous avons besoin d'imaginaires positifs pour parler de notre futur à tous. Damasio est un romancier de l'imaginaire, il le sait bien. Il le dit lui-même, en parlant des auteurs de SF plus largement : "si nous avons une responsabilité politique, elle est de battre le capitalisme sur le terrain du désir."
Car si nous ne le faisons pas, nous laisserons ce futur être façonné par des individus aux imaginaires d'une tristesse sans nom. Musk, Bezos et consorts ont tous été abreuvés à la mamelle de la SF américaine du siècle dernier, et leur vision du monde est nourrie par des imaginaires cyberpunk et post-apocalyptique, pas franchement joyeux. On est clairement dans de l'auto-réalisation quand on parle de Neuralink, nous le disions. Ou même, si on en prend les éléments les plus ridicules, du Cybertruck de Tesla au bunker de Zuckerberg à Hawaii.
C'est cet imaginaire tristou qui a enfanté des idées complètement déconnectées comme le métavers ou l’Apple Vision Pro. Le futur full-tech que ces psychopathiques grands patrons de la tech nous servent à toutes les sauces, n'est au final qu'une vision infiniment peu fun du cyberpunk. Du transhumanise low cost. Avec l’avènement de l’iPhone, le cyberpunk est tout simplement mort. Un smartphone ainsi quasi-greffé à la main, on ingère des contenus algorithmés et séquencés pour venir taper aux bons endroits de notre cerveau, et ainsi nous provoquer un tant soit peu de plaisir. Un design de la dépendance qui nous aliène, nous assèche, là encore.
On préférera à ce "techno-capitalisme" une vision différente, "biopunk" comme l'appelle Damasio. Un mix entre ce que la tech peut nous apporter de bon et un retour salutaire à la terre. Un concept malheureusement assez peu défloré dans le livre. En tout cas dans la partie purement "essai", puisque la nouvelle de fiction présente en fin de livre vient justement la nourrir de manière intéressante. Une notion de biopunk que l'on pourrait voir comme une version moins marketing, parce que plus radicale, du "solarpunk" que j'avais déjà évoqué pour TFTT. Une notion que Damasio évoque également plus largement dans cette très intéressante intervention en groupe chez Blast, au sujet de la lutte (écologique, notamment) par l'imaginaire.
Mais pour moi, la question d’un imaginaire du futur sans les formes les plus mercantiles de la technologie serait également intéressant à creuser. Cet imaginaire existe peu, hormis dans le traditionnel trope post-apocalyptique vu et revu, et qui ne m’intéresse plus, tant il porte une vision intrinsèquement anxiogène. Mais pourquoi ne pas imaginer un monde qui sorte doucement des technologies non-essentielles ? Qui aille vers une forme de sobriété ? C’est un point trop peu soulevé par Damasio à mon humble avis, que l’on sait engagé sur les sujets environnementaux par ailleurs. Le sujet de l’impact environnemental de la tech est tout de même brièvement évoqué dans le livre, mais disparait un peu magiquement quand il s’agit d’évoquer les IA du futur.
Quoi qu’il en soit : il nous faut donc construire ce futur désirable. Par l’imaginaire, mais pas que. D'autres, moins romanesques mais pas moins rêveurs que Damasio, comme Etienne Klein, le disent aussi bien : "2050 et 2100 sont laissées en jachère intellectuelle et en lévitation politique." Cela doit changer.
Une petite parenthèse avant de conclure : Damasio parle aussi des lieux eux-mêmes, dans son livre. Une Silicon Valley déshumanisée. Sujet sur lequel je vous conseille le docu "The Last Town", produit par ARTE. Une San Francisco vidée et zombifiée, qui correspond tout à fait à mon expérience personnelle de la ville. Étudier ce qui se passe au plus près de ces géants qui produisent la tech est peut-être la meilleure preuve que nous devons nous défendre contre leur vision de la société, et en développer une nouvelle, plus porteuse et humaine.
Voilà pour cette relecture critique, que je terminerai sur ces mots, puissants, de Damasio. Mots qui regroupent un peu tout ce que j'ai pu dire ici, et tout ce que lui a exprimé dans son ouvrage :
"ce qui manque à notre temps, c'est un art de vivre avec les technologies. Une faculté d'accueil et de filtre, d'empuissantement choisi et de déconnexion assumée. Un rythme d'utilisation qui ne soit pas algorithmé, une écologie de l'attention qui nous décadre, des pratiques qui nous ouvrent au monde plutôt que nous le réduire à un flux vidéo, une relation aux IA qui ne soit ni brute ni soumise, qui se souvienne que le seul critère valable pour déployer ou couper la relation est la liberté qu'elle nous offre et la fertilité des échanges qu'on en retire."
Cela peut paraître un peu utopique, tout cela. Mais n'a-t-on pas dit qu'il fallait battre le capitalisme sur le terrain du désir ?
Alors : est-ce que je conseille la lecture de cette "Vallée du silicium" d'Alain Damasio ? Pour les connaisseurs des écrits du monsieur, je pense que c’est une suite pertinente et logiquement plus politique que ces ouvrages fictionnels. Qui pourra aider certains à basculer vers la techno-critique pleine et entière, justement. Si vous n'avez jamais rien lu du bougre, en revanche, je dirais que se pencher d'abord sur les concepts qu'il aime manier et évoquer à longueur d'interviews me semble préférable. J'ai déjà partagé de nombreux liens dans cet article, je pourrais en conseiller d'autres, un peu plus anciens. Mais si les axes de réflexion évoqués ici vous interpellent, alors accrochez-vous et lisez Vallée du silicium.