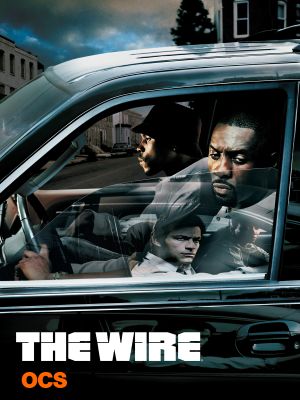Initialement, je voulais centrer ma critique sur une comparaison avec un jeu d'échec. L'opposition du Noir et du Blanc qui peut trouver des échos tout aussi bien raciaux que dramatiques (gentils/méchants), la complexité du stratagème qui sied tout aussi bien à la réalité d'une ville comme Baltimore au jour le jour qu'à la toile d'araignée dressée de main de maître par David Simon et enfin les références multiples à la notion de hiérarchie, centrale dans The Wire comme elle l'est dans le jeu. Le mot même de jeu, "The Game" entendu à mainte reprise dans The Wire, évoqué comme une réalité surplombante, un système complexe fait de complémentarités, de frictions et de conflits, paraissait se prêter à cette petite analogie.
Seulement voilà, malgré les avantages esthétiques, peut être même explicatifs, qu'aurait eu cette comparaison, elle aurait été insuffisante pour ne serait-ce qu'entrevoir tout ce que la série a pu mettre en place.
Si The Wire était un jeu d'échec elle ne pourrait se jouer sur un seul échiquier, c'est ce que montre admirablement le zoom arrière au fur et à mesure des saisons. Du coin de rue, au quartier jusqu'à des considérations politiques nationales, le recul que prend la série traduit aussi bien le cheminement du local au global (par le biais du crime le plus souvent, mais pas seulement) que le vertige de différentes réalités qui s'entrechoquent — quand elles ne s'ignorent pas. On est moins en face d'une critique virulente de la société que dans la contemplation de sa complexité démesurée. La variété des points de vue, des prismes n'est là que pour renforcer cette démarche, et l'authenticité évoquée à juste titre dans tous les commentaires (ou presque) sur la série n'est que la constatation que l'entreprise The Wire n'était pas une tâche hors de portée de l'homme qui veut peintre le tableau de son époque, mais qu'il faut juste placer le pinceau entre de bonnes mains.