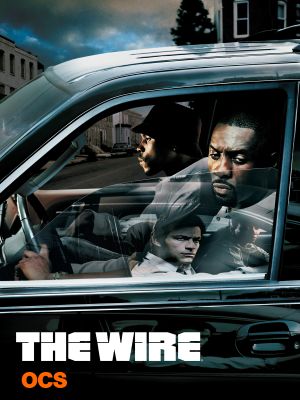"The world goin' one way, people another, yo."
Intronisée comme « meilleure série de tous les temps » par les critiques et étudiée par les courants universitaires de tous horizons (sociologues, philosophes, urbanistes, économistes…), The Wire est une critique radicale de la société américaine dont l’approche, exhaustive et profonde, est régulièrement comparée à celle de Dickens ou Balzac. Difficile de résumer ce qu’est la série, je préfère pour cet exercice m’effacer et laisser la parole à David Simon (son créateur), en vous présentant le pitch avec lequel il a convaincu HBO de signer le financement de son projet: « At the end of the 13 episodes, the reward for the viewer who has been lured all this way by a well constructed police show is not the simple gratification of hearing handcuffs click. Instead, the conclusion is something that Euripides might recognize: an America at every level at war with itself ».
A travers la description de la désindustrialisation et de ses effets, des dysfonctionnements institutionnels, des inégalités de race et de classe, The Wire dresse un tableau réaliste et politique d’une ville condamnée par un système imperméable au changement. Pour se faire, elle est nourrie de l’expérience personnelle de ses deux réalisateurs. Parler de The Wire nécessite forcément d’aborder les parcours de David Simon et Ed Burns. Le premier est confronté à sa propre impuissance lors de sa première expérience de quatre ans en tant que journaliste au Baltimore Suns, reportant inlassablement les meurtres d’une ville où ceux-ci n’ont tristement plus d’importance (« You don’t feel the tragedy anymore »). Il se lance ensuite dans le journalisme d’investigation, intégrant durant une année le département des homicides de la police de Baltimore afin de se rapprocher du milieu qu’il dépeindra plus tard avec tant de génie. Son acolyte, Ed Burns, a quant à lui consacré sa vie professionnelle à la police de Baltimore (département narcotique et homicide) avant de se reconvertir en professeur, expérience ô combien importante et déterminante pour l’écriture de la série.
The Wire ne vend pas d’espoir et ne cherche pas à faire plaisir au public. C’est le portrait d’un Baltimore en pleine désintégration et le récit du combat désespéré des individus contre le système. L’exploration du dysfonctionnement des institutions (éducative, judiciaire, policière, politique ou médiatique) et de l’intégration problématique entre race et classe prend le pas sur la trame narrative policière, qui n’est très vite qu'un background au service d’un propos bien plus ample. A travers ses chroniques de policiers fatalistes, de gangstas surdoués, de profs victimisés ou de drogués désabusés, The Wire raconte les conséquences sociales désastreuses d’un modèle de société qui atteint ses limites.
La série brille d’abord par sa profonde dimension critique en illustrant avec finesse les mécanismes de reproduction sociale. The Wire matérialise l’Hyperghetto de Loic Wacquant (« structure sociospatiale devenue instrument de fermeture ethnoraciale ») et embrasse les théories de Bourdieu et de ses disciples sur l’impuissance de l’individu face à des forces qui le dépassent. Un écrasement économique évidemment, mais qui va bien au-delà. Illustration parfaite de cette justesse: cette fameuse scène « du repas » (link: https://www.youtube.com/watch?v=uhlW6SRu5rA) où le Major Colvin tente une impossible rencontre entre les deux mondes en emmenant des enfants ayant grandit dans le ghetto dans un restaurant bourgeois de Baltimore. La sensibilité de la description du sentiment d’insécurité de Namond et son crew ferait passer Abdelatif Kechiche pour un vulgaire sbire d’Europa Corp. Comme le dit bien mieux que moi l’auteur, « les logiques de marginalisation sociale apparaissent comme le fruit de mécanismes structurels (liés aux institutions et au capitalisme) davantage que du ressort des individus, contrairement à une croyance très largement répandue aux Etats Unis (y compris chez les pauvres) ». En bref, The Wire remet en cause les fondements libéraux selon lesquels la pauvreté (et par extension l’exclusion sociale) est le fruit d’une volonté individuelle.
L’une des expressions que j’aime le plus quand il s’agit de parler de The Wire est celle de la criminologue Ruth Penfold-Mounce qui décrit la série comme une social science fiction. Sa force repose effectivement sur sa capacité à voir dans chaque situation/personnage un potentiel objet d’expérimentation sociale (mais pas seulement, ce qui donne un double niveau de lecture à chaque élément de l’oeuvre). Simon & Burns se posent donc en dignes représentants d’Howard Becker, qui considérait à juste titre que les sciences sociales ne peuvent pas être considérées comme le seul outil pertinent d’analyse de la société, le cinéma, le théâtre, et l’art en général apportant leur lot de clés de compréhension du monde.
L’on pourrait alors considérer l’oeuvre de Simon d’ethnographique, mais il reste modeste lorsqu’il s’agit d’associer son oeuvre à une science, car il a trop conscience de l’effet de distortion que crée la caméra: « You’re not telling the perfect truth anymore ». Ce n’est pas un hasard si le nom de Frederic Wiseman revient souvent comme principale inspiration du mastermind de la série. Mais alors, c’est quoi, The Wire ? Un « docu-drama » selon ses propres mots, un nouveau format à la croisée des chemins. Cette volonté de se situer en permanence à la frontière entre le réel et la fiction permet donc à The Wire d’être un laboratoire géant, qui parvient à saisir la complexité des situations et à retranscrire leur dimension systémique. La série devient un creuset de propositions politiques et sociétales fortes, et propose des micro-modèles utopiques tout en exposant l’envers du décors. En parlant de ces utopies, je pense bien entendu à l’expérience d’ «Hamsterdam » menée par le Major Colvin (encore lui), et son approche géographique de la lutte contre le traffic de drogue: des « zones libres » sont mises en place afin de canaliser la violence dans des quartiers inhabités ou le trafic est dépénalisé, pour ainsi protéger la population d’une sanglante guerre quotidienne. La « social science fiction » permet donc d’explorer virtuellement les modalités, les enjeux, les conséquences et les limites d’un tel projet. Le format populaire de la série permet d’ouvrir le débat et de sensibiliser une audience large la ou les ouvrages académiques se limitent à un microcosme d’intellectuel en cercle fermé. La force de The Wire, c’est également d’avoir su démocratiser un sujet sans en avoir sacrifié la complexité.
La forme est toute au service de son propos, permettant d’éviter dolorisme, voyeurisme, et esthétisation de la misère tout en s’inscrivant dans des codes cinématographiques capable de maintenir l’intérêt du public. Le rythme, très lent, est en rupture avec les règles qui régissent habituellement les productions télévisées. Ici pas de twist débile ni de crescendo artificiels, puisque ces procédés narratifs ne feraient qu’éloigner le spectateur du propos. La force de la série est de parvenir à être à la fois plot-driven et character-driven, à faire exister un monde dans sa globalité. Les seconds rôles n’ont de secondaire que le nom, et aucun personnage n’est réduit à une fonction (narrative ou thématique). C’est cet ensemble qui fait que la série parvient à être aussi attachante malgré son épaisseur thématique: l’œuvre ne se résume pas au propos, elle l’incarne avec humanité. Tout est fait pour renforcer la proximité entre le spectateur et l’univers, et la démarche des réalisateurs de confier une partie des rôles à des habitants de Baltimore en est l’ultime témoignage. La caractérisation est exemplaire d’efficacité et parvient à rendre chaque personnage vivant et attachant sans jamais tomber dans le didactisme et la surexposition par les dialogues. Revoir The Wire accentue mon mépris pour le traitement grossier des personnages dans la grande majorité des productions TV actuelles (coucou House of Cards), où les personnages sont réduits à la condition de papillon épinglé dans un cadre d’entomologiste. J’ai toujours considéré que le génie au cinéma reposait sur la capacité de dire beaucoup avec peu. Lors de sa Master Class au Forum des Image, David Simon prononçait cette phrase qui devrait servir de guideline à tous les réalisateurs: « Everything has to justify itself. It’s either there for a reason, or it’s not ».
La richesse de l’œuvre tient également au fait qu’elle est parfois capable de s’éloigner de son propos pour partir dans des plaisirs coupables qui permettent au spectateur de respirer. L’aspect naturaliste peut de temps à autre laisser place à une esthétique plus libre et décomplexée, convoquant par exemple les codes du western lors du duel entre Omar (surréaliste gangster homosexuel et chouchou attitré de Barrack Obama) et Brother Mouzone (trafiquant de dope tout droit sorti de la Nation of Islam).
En bref, le slogan de l’époque « It’s not TV, it’s HBO. » n’a jamais été aussi pertinent qu’à l’époque de la diffusion de The Wire. C’est une grande œuvre, qui changera probablement définitivement votre rapport à la télévision (ou l’a déjà fait). C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, parce que vos yeux saigneront ensuite en se posant sur les productions régies par des contraintes d’audience malsaines et abrutissantes.