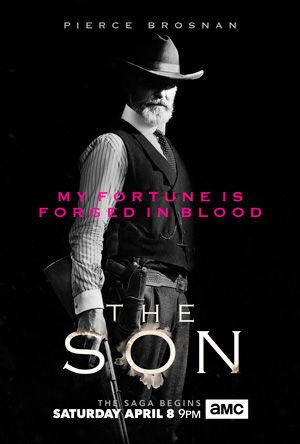The Son 1849-1905-1988, passe sous silence ce qui faisait l'attrait du visionnage : la ruée vers l'or (1849), la guerre américano-mexicaine et ses conséquences (1846-1848) le conflit Nord/Sud (1861-1865), la construction de la première ligne de chemin de fer en 1863, pour la venue en masse de colons, en passant par l'âge d'or des Cow-boys, (1870), les guerres légitimes indiennes, la construction des forts avec ce que cela implique de rapports à l'isolement (1860-1889), le dernier acte dramatique à Wounded Knee,(1890) ou encore l'histoire du pétrole avec l'émergence de marchés pétroliers (1901) l'abondance et la chute à venir (1945 et 1970). La série pouvait aussi traiter d'une grande épopée chorale, mais elle ne se résume malheureusement qu'à une saga familiale réduite à des conflits familiaux redondants d'une grande platitude, auto centrée en lieu et place d'un portrait plus nourri des enjeux de l'époque, de la naissance du Texas et plus largement de la conquête de l'Ouest américain.
De la période adolescente, où Eli McCullough aura vécu avec les Comanches, le portrait de ces tribus amérindiennes ne sont que petits groupes parsemés, sans ouvrir le récit sur leur propre histoire et culture, les cantonnant à un portrait sans envergure voire cliché. Même si l'armée américaine, les conflits entre tribus ou l'abus de confiance dans le partage des territoires, les maladies, le massacre des bisons ou les changements d'habitat qui ont contribué à leur extinction, s'invitent dans quelques scènes, celles-ci sont bien trop rares et sans relief pour avoir un quelconque intérêt. De cette expérience et de son choix identitaire, jusqu'à ses 70 ans, devenu un patriarche installé, la solidarité laissera place aux considérations plus concrètes de propriétaire terrien sans que nous soit décliné tout son cheminement, entre 1849 et le début des années 1900, nécessaire à la compréhension.
La corruption dans un Etat régit par ses propres règles, malgré l'annexion du Texas aux Etats-Unis, en 1845, ou le folklore des rebelles mexicains avec un clin d'œil peut-être, au peu commode et expert en sabotage, Pancho Villa, ne sont que simples représentations sans enjeux, si ce n'est de pointer le racisme et les crimes perpétrés en toute impunité.
Les décors de l'Ouest et ses grandes étendues sauvages déçoivent par leur absence. Les scènes d'actions et les dialogues manquent de puissance et de verve. Les visions oniriques qui ne se rattachent à aucune croyance, ou encore des personnages qui disparaissent comme ils sont venus, laissent perplexes. Les plans statiques, les flashbacks incessants, ou les passages d'écran noir en guise de transition, sapent le rythme déjà défaillant.
De la quête de reconnaissance, à la dictature familiale, en passant par les amours contrariés ou l'épouse délaissée pour un aspect féministe bien timide, ce ne sont que des retournements de personnalité passant d'un acte à son contraire et une caméra s'attachant à les filmer comme ils sont, posés et engoncés dans des valeurs d'une grande vanité.
En ressort un léger malaise et une maladresse évidente sur la volonté de dénonciation d'un Etat qui s'est construit dans le sang, tant le rapport à la famille et à l'héritage semble être une raison suffisante à ces caractérisations pour le moins faciles et à des exactions qui en deviendraient presque légitimes.
On est bien loin d'une grande fresque historique aux multiples chemins de traverse, nécessaires tant au divertissement qu'à la culture et à la réflexion.
Seule une petite incursion en 1988, nous rappellera, si besoin est, que la spoliation et le déni de l'individu sont toujours d'actualité.
On peut alors relire Méridien de sang de Cormac McCarthy, ou La collection des Blueberry de Charlier et Giraud, si on hésite à s'attaquer au roman de Philipp Meyer...