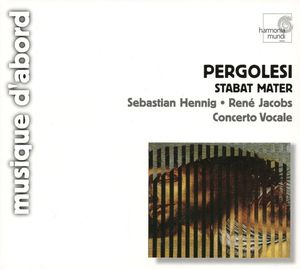Pergolèse est au crépuscule de sa vie, à 26 ans - si tôt me direz vous, atteint de la tuberculose. Sa carrière fulgurante et éphémère n'a pas laissé aujourd'hui beaucoup de traces, dans une époque, la sienne, marquée par des figures musicales immenses comme Bach et Vivaldi ou Rameau en France et dans notre époque, où la musique classique est parfois boudée (sans parler de la musique religieuse). Mais pourtant, il a laissé cette dernière oeuvre, testamentaire à la postérité. On la connait tous, souvent utilisée dans les films, solennelle, grandiose, pieuse et intimiste à la fois.
Le Stabat Mater est un sujet de musique religieuse récurrent à cette époque. En latin, le texte traite des souffrances de Marie voyant son fils marcher vers la mort. Une souffrance toute intérieure, un cheminement féminin et douloureux. Pergolèse, ainsi, préfère une musique intimiste. Il choisit quelques cordes, et deux voix de femmes pour interpréter cette douleur. Pourtant, il reprend aussi de nombreux motifs d'opéra, notamment des arias. Cela donne ainsi une grâce tragique à son oeuvre, qui demeure, non pas une oeuvre religieuse froide et pieuse, mais une oeuvre incarnée. Un parti pris qui lui vaudra des critiques.
Et pourtant, c'est simplement magnifique, aérien, divin, d'une profonde tristesse mais d'une légèreté à l'italienne, sous les trilles des archets, et les notes de la soprano et de l'alto. L'oeuvre est simple, simple à comprendre, simple à écouter. Elle n'a rien de savant. Elle est dépouillée, en un sens d'une infinité pureté. Les phrases de violons et d'alto soutiennent les deux chanteuses et les phrases en alternance s'enchainent avec une aisance rare.
Il faut croire que les hommes au bord de la mort, tout comme Mozart et son requiem, lorsqu'ils composent une musique pour le dieu qu'ils s'en vont rejoindre son comme touché par une grâce, mus par une profonde piété.
C'est beau.