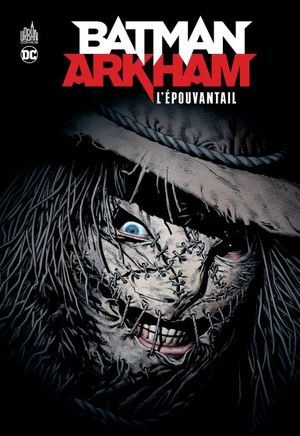Dans un récit sobrement intitulé « L’Épouvantail » et publié pour la première fois en 2005, Bruce Jones et Sean Murphy reviennent longuement sur les origines du super-vilain de Gotham City. Rejeté par ses parents, adopté par une arrière-grand-mère psychorigide et castratrice, le jeune Jonathan Crane traverse une enfance douloureuse, aux repères brouillés et aux épreuves traumatiques. « Bien sûr, cela dépassait les sévices corporels ou être privé de dîner », annonce-t-on en guise de mise en garde. Et pour cause : on le retrouve bientôt terrorisé, enfermé dans une vieille chapelle reconvertie en volière, en proie à des oiseaux manipulés par la vieille femme. Cette dernière, à la fois pieuse et sadique (ce qui n’a rien d’oxymorique ici), n’hésite pas à le punir au seul prétexte qu’il lit James Joyce. Surtout, elle lui apprend, bien involontairement, que la peur et le contrôle constituent deux forces parmi les plus puissantes au monde. Dans un carnet de notes découvert plus tard par Batman, la tutrice de Jonathan Crane indique au sujet de celui qui allait devenir l’Épouvantail : « J’ai peur de la terrible vengeance que fomente son esprit retors envers moi. » Tout le récit se conçoit ainsi comme une invitation à explorer les fêlures du personnage, nées de l’histoire tumultueuse de ses parents et de la conduite malveillante de son arrière-grand-mère. Et le lecteur de découvrir comment le ressentiment et la peur se sont inscrits chez lui en seconde nature…
Dès 1941 et sa première apparition dans « L’énigme de l’Épouvantail » (Bill Finger et Bob Kane), l’édification de cet « être chimérique fait de toile de jute et de paille mais doté d’un esprit machiavélique » est intimement liée à ses traumas – depuis, ces liens de causalité ont été largement débattus dans les cercles sociologiques et psychologiques. On qualifie volontiers Crane d’illuminé. On se moque de sa tendance à se soucier davantage de ses bouquins que de son apparence. Il décide alors de retourner ces brocards contre ceux qui les énoncent, et de s’en servir comme d’un tremplin vers la fortune. Mais s’il voit le jour durant l’âge d’or des années 1940, le professeur d’université spécialiste des phobies doublé d’un super-vilain ne s’impose réellement au cœur de la métropole de Gotham City que bien plus tard. Il faudra par exemple attendre 1967 pour que les gaz anxiogènes et son attirail vestimentaire ne viennent le caractériser définitivement. Raison pour laquelle la plupart des récits présents dans ce recueil ont été publiés après 1980. Dans « Les 6 jours de l’Épouvantail » (1981, Gerry Conway et Don Newton), l’Épouvantail pousse les habitants de Gotham à craindre Batman. Dans « Frayeur à vendre » (1986, Mike W. Barr et Alan Davis), on le décrit comme « le pharaon des phobies, le roi de la répulsion », tandis qu’il use de psychoactifs chimiques et s’en prend notamment à Robin.
« Crise d’identité », d’Alan Grant et Norm Breyfogle, voit le jour en 1990. Le récit ne vaut pas seulement pour son évocation de l’Épouvantail, mais aussi pour son effeuillage de Tim Drake, qui aspire alors à endosser le costume de Robin. Dans un avertissement qui sonne comme un autoportrait, Bruce lui indique : « Une fois en costume, on devient plus qu’humain. On devient un symbole. Et on n’a alors plus le choix, il faut se montrer à la hauteur de ce qu’on incarne. Le masque cache notre peur. Personne ne sait ce qu’on pense. En fait, il sert à deux choses. Effrayer nos ennemis et nous rendre plus forts. Mais aucune tenue ne peut nous dissimuler de nous-mêmes. » Ce commentaire sur la manière dont le super-héros tend à phagocyter son alter ego humain se double d’une réflexion sur la peur qui entre forcément en résonance avec tout ce que peut incarner l’Épouvantail, ici aux prises avec la reporter Vicki Vale. Dans « Crise d’identité », Jonathan Crane parvient à pousser d’honnêtes citoyens aux crimes les plus violents. « C’est comme si des gens choisis au hasard avaient cédé à une envie de meurtre au même instant. Cela n’a aucun sens. » Tim, profondément meurtri par le sort funeste réservé à ses parents, occupe une place prépondérante dans un récit parfaitement maîtrisé. Le nouveau Robin note que « cette tenue a des pouvoirs magiques », qu’« elle vous galvanise, dissimule vos faiblesses et vous pousse à donner le meilleur de vous-même », voire qu’« elle fait de vous un héros ». Alan Grant et Norm Breyfogle se servent évidemment de ces introspections pour sonder, en miroir, la dualité Bruce Wayne/Batman.
« L’Épouvantail » (1995), de Doug Moench et Kelley Jones, comporte plusieurs points d’intérêt. Cette fois, c’est l’Épouvantail qui se voit mis en parallèle avec Batman, au regard de leur exploitation commune de la peur face à leurs ennemis – le déguisement du Chevalier noir faisant de lui un « vampire », ou une « chauve-souris » géante et purificatrice, comme on a pu le lire ailleurs. Jim Gordon déclare par ailleurs que « tous les politiciens camouflent les problèmes derrière des écrans de fumée », propos qui s’inscrivent dans une dénonciation abrupte des institutions démocratiques, perçues comme dévoyées. Doté de dessins plus modernes et sombres, le récit voit Jonathan Crane renouveler un leitmotiv : s’en prendre à ceux qui l’ont mis à l’épreuve durant sa jeunesse. Ici, ce sont des footballeurs qui font l’objet de son courroux. « Ils me terrorisaient à la moindre occasion. Mais aujourd’hui, les rôles sont inversés ! La peur a élu domicile dans leurs esprits ! » Une fois de plus, c’est de cette vulnérabilité originelle que le psychologue tire son besoin de vengeance, cette insatiable volonté de projeter sur d’autres la peur et la détresse qui l’ont longtemps animé. En 1997, soit deux années plus tard, c’est au tour de Peter Milligan et Duncan Fegredo de puiser dans cette peur de quoi creuser plus avant le super-vilain, tout étonné de voir une jeune étudiante en droit, Becky Albright, oser témoigner contre lui. Tandis qu’il sème la panique à Greenvale, il s’épanche : « Quelle délectation de profiter de cette toile gigantesque pour y peindre mes terribles cauchemars ! » La comparaison avec la peinture est édifiante : Crane est un artiste dont les couleurs seraient les phobies et le tableau, la ville de Gotham et ses habitants. C’est le ressort dramatique principal de cet excellent Batman Arkham : la peur tient lieu de puissant incubateur, de force motrice affectant profondément, et souvent durablement, les individus qui y ont été exposés.
Sur Le Mag du Ciné