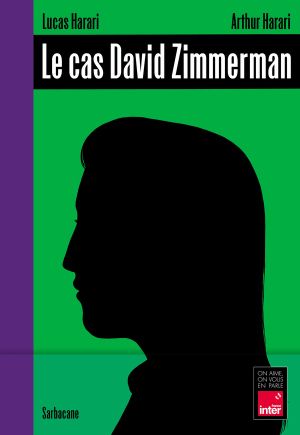Avec ce nouveau roman graphique, son troisième après L’aimant (2017) et La dernière rose de l’été (2020), Lucas Harari surprend énormément tout en gardant son style et ses obsessions.
David Zimmerman est un jeune homme de 34 ans (comme Lucas Harari au moment où sort l’album) qui travaille comme photographe et vit en colocation avec son meilleur ami (Harry, 36 ans, peintre) dans un appartement parisien. Il semble que la séparation d’avec son ex-copine soit relativement récente, car David n’a visiblement pas encore fait le deuil de leur histoire. C’est ainsi qu’Harry (un ami qui lui veut du bien…) lui force un peu la main pour qu’il l’accompagne à une fête pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Sur place, David réalise que son ex est présente, ce qui le met mal à l’aise. Est-ce la raison pour laquelle il s’intéresse à une autre jeune femme ? Il aura bien le temps de réfléchir à la question par la suite.
Toujours est-il que l’ambiance est montée et que David a pris un cachet fourni par Harry et certainement aussi bu de l’alcool. Il suit cette fille qu’il a reconnue, pour l’avoir croisée à un mariage où il venait faire des photos et où il avait trouvé injuste qu’elle se fasse engueuler à cause d’un incident dont elle n’était pas responsable, mais pour lequel elle avait pris la porte sur un coup de tête. Là, David l’emmène chez lui pour une étreinte amoureuse.
La banalité de la situation initiale bascule quand David se réveille. La fille n’est plus là et surtout il constate qu’il occupe son corps à elle. Bien entendu, il suppose que la fille, du moins son esprit, est partie avec son corps à lui. Le voilà dans un corps de fille (J’ai perdu mon corps), à se demander pourquoi et comment ?
Bien évidemment, il imagine toutes les raisons possibles, du mauvais rêve dont il va rapidement s’éveiller à une intervention extra-terrestre. Il lui faudra un certain temps pour admettre la situation et décider que la seule attitude possible consiste à chercher un moyen de retrouver son corps.
Une bonne partie du roman graphique nous voit suivre David chercher des pistes, ce qui l’amène dans un premier temps à enquêter sur lui-même et apprendre quelques éléments surprenants selon la façon dont ils sont exprimés par les autres.
Et puis, à force de chercher, le hasard lui permet d’apercevoir, en pleine manifestation perturbée par des mouvements de foule et des jets de gaz lacrymogènes, un détail de sa tenue vestimentaire évanouie avec la « fille ». Après quelques péripéties, il peut enfin s’expliquer. Mais, tout se complique, parce que si la personne en face de lui utilise son corps à lui, elle a visiblement été victime d’un autre « échange » entretemps. D’autre part, ni David ni cette autre personne qui dit s’appeler Samia ne savent quand, comment et pourquoi les échanges se produisent. Il faut donc poursuivre les investigations, avec le petit avantage de pouvoir les mener ensemble, les deux ayant le même type d’expérience traumatisante.
Ce faisant, Lucas Harari explore le lien que nous faisons entre le corps et l’esprit. On pourrait chipoter en avançant que si les corps ont été échangés, cela devrait comporter le cerveau, alors qu’ici chacun garde visiblement ses propres souvenirs, sa propre personnalité. Ainsi, chacun éprouve un véritable traumatisme de garder sa personnalité dans le corps d’une personne de l’autre sexe, ce qui ouvre largement le champ d’exploration. Par contre, le dessinateur ne va pas jusqu’à faire sentir à son personnage masculin (David) la très particulière condition d’une femme sous le regard des hommes. A vrai dire, la situation ne s’y prête pas, car David ne pense qu’au moyen d’en savoir davantage sur ce qui lui arrive et de faire le chemin inverse. Il limite ainsi les rencontres, justifiant au passage son nom qui littéralement signifie « Menuisier » si on le coupe en deux (Zimmer Man) tout en sachant que Zimmer signifie chambre. David devient donc l’homme qui demeure en chambre pour ne pas affronter l’extérieur et qui cherche à refaçonner son image. A noter au passage que son nom s’écrit avec un seul n et non pas à l’allemande (Mann), ce qui pourrait correspondre à un choix pour assimilation. Cela irait bien avec ce qu’on observe lorsque Samia et David visitent la mère de celui-ci (qui, elle, parle de délaissement de la judéité). En tant que lecteur, la situation tire alors vers la comédie avec Samia qui se fait passer pour David et David qui se fait passer pour une amie. Mais, Samia est très mal à l’aise et nous sommes bien au-delà d’une simple situation de travestissement. A noter au passage que c’est assez déstabilisant à la lecture (et même sur la durée des 350 pages de l’album) d’observer un personnage masculin désigné par un prénom féminin et l’inverse.
Au vu de son épaisseur, on ne s’étonnera pas que Le cas David Zimmerman ait occupé Lucas Harari plusieurs années. Il avait son idée de départ et la fin, mais butait régulièrement sur certains enchainements. C’est ainsi qu’il s’est fait aider par son frère Arthur (le réalisateur de Onoda) qui connaît bien le travail de scénariste. Le fait qu’Arthur soit son frère a beaucoup aidé Lucas pour la partie enquête sur lui-même. L’album doit beaucoup à leur complicité (envoi régulier de photographies prises dans Paris), leur façon de travailler qui ressemble énormément à ce qui se fait pour le cinéma (Lucas explique volontiers que dans sa tête, une BD en projet ressemble énormément à un film). Il apparaît également que Lucas aime intégrer dans son œuvre des éléments sous forme d’allusions ou de références : un lieu conçu par ses parents tous deux architectes (aucun doute sur l’origine de son goût pour les lieux architecturalement remarquables), des références musicales (il cite en fin d’album d’où viennent les paroles des chansons utilisées lors des ambiances festives), d’autres cinématographiques (avec notamment cette illustration de couverture avec une silhouette noire se découpant sur un fond vert, masculin d’un côté, féminin de l’autre, qui lui a été inspirée par Vertigo d’Hitchcock : quelque chose qui faisait partie de son projet d’origine et qui tranche énormément avec le contenu de l’album, mais contribue à intriguer) et puis cette façon de nous faire visiter Paris qui ne peut que rappeler Tardi et ses Aventures d’Adèle Blanc-sec (il ne s’en cache pas et s’en amuse avec une très discrète allusion sous la forme d’un nom sur une boîte-aux-lettres), tout en restant dans son style, qu’on apprécie plus particulièrement sur les dessins de grandes tailles, dont il utilise à bon escient pour créer une ambiance personnelle assez noire, avec une touche de fantastique. Bien évidemment, il se délecte à dessiner des lieux reconnaissables, aussi bien dans Paris (gare de l’Est par exemple) qu’en banlieue (autre exemple, avec les Mercuriales, tours jumelles reproduisant à Bagnolet en taille plus modeste, celles du World Trade Center).
A noter que Lucas Harari utilise une nouvelle fois un procédé qu’il affectionne, en limitant la plupart du temps, l’espace entre ses cases à fin un trait noir. Cela accentue l’impression oppressante qu’il construit avec tous les éléments de son intrigue. Les couleurs qu’il utilise ici sont celles avec lesquelles il se trouve le plus à l’aise et qui donnent une bonne idée de Paris et banlieue.
Le final est particulièrement marquant et ne pourra que rappeler quelque chose aux rares lecteurs du roman Bonobo de la Coréenne Jeong You-jeong, puisque, à la suite d’un drame poignant, David se voit confronté à un choix crucial quant à son avenir. L’épilogue nous fait comprendre quel a été son choix et ce qu’il lui vaudra d’endurer mais également d’espérer. Par contre, ni nous ni David ne saurons jamais ce qui a provoqué les échanges ayant bouleversé son existence, observation classique pour un tel élément fantastique.