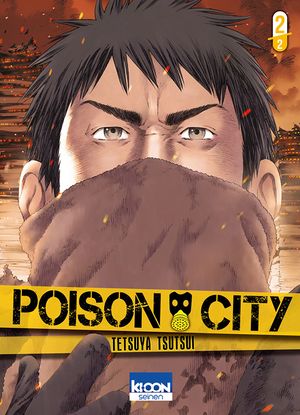Parmi les sujets des épreuves de philosophie du bac’ 2015 se trouve le sujet suivant : « L’artiste donne-t-il quelque chose à comprendre ? » Une interrogation qui résonne lorsque l’on parcourt les tomes de Poison City (Prix Asie de la Critique ACBD 2015). Au fil des pages, on comprend ce que Tetsuya Tsutsui et son personnage Mikio Hibino – qui partage un certain nombre de points communs avec Tsutsui (débuts difficiles, refus de l’autocensure…) – veulent nous faire comprendre. Si les artistes s’autocensurent pour échapper aux censeurs, ne pas causer de tort à leur éditeur, alors que reste-t-il du manga ? Qu’est-ce qu’être mangaka dans ce cadre ? Poussée au maximum, une telle logique revient à faire du mangaka un encreur qui décalque des photos, laissant à d’autres le soin de s’occuper du scénario, pour éviter de heurter les sensibilités (Shingi Matsumoto et Standing Joe dans le tome 1). Certes par rapport au sur-travail des mangakas que l’on évoque souvent la situation apparaît plus confortable. Mais ne perd-on pas quelque chose au passage ? Une telle division du travail, spécialisation permet-elle de rendre les œuvres meilleures (sous le regard bienveillant des experts de la commission chargés de désigner les ouvrages nocifs) ? Il est permis d’en douter et de craindre une offre uniformisée, orientée du côté de la mesure, la correction… avec un résultat fade. En ne voulant pas heurter on risque de n’intéresser personne.
Ce premier élément s’articule avec le poids (étouffant) des autorités, représentées par la commission pour une littérature saine, qui défend la « coolture » japonaise. Son travail consiste à traiter des ouvrages signalés pour les classer en ouvrages nocifs (qui sont interdits aux moins de 18 ans ; pour en faire l’acquisition il faut présenter une pièce d’identité) ou déconseillés (interdits aux moins de 15 ans). Les attributs de la commission peuvent aussi lui permettre d’envoyer un auteur nocif en séminaire de rééducation (version light de Orange Mécanique)… L’accent est surtout placé sur la censure visant les manga pour nous montrer des situations abracadabrantesques, du calcul du taux de nocivité en passant par les jugements prononcés et les raisons invoquées. Il y a de quoi se frotter les yeux devant les arguments qui nous sont présentés. Un rapprochement avec la logique argumentaire de la NRA (et/ou de Donald Trump) ne serait pas infondé par moments… Surtout, la censure dont il est question dans Poison City, même si elle prend des dimensions assez énormes (effet d’exagération/d’amplification) n’est pas détachée de la réalité puisque Tsutsui lui-même a vu une de ses œuvres (Manhole) censurée dans la province de Nagasaki. Les tomes 1 et 2 contiennent respectivement 7 et 4 pages sur cette affaire, à l’origine du manga.
Il existe pourtant des moyens de contourner la censure. On peut jouer avec les règles. La solution ne vient pas du Japon mais… de l’étranger ! C’est en effet un américain (Alfred Brown) qui apprend à Mikio comment faire pour ne pas voir son œuvre entrer dans la catégorie des ouvrages nocifs. Ce même Alfred Brown achète les droits de Dark Walker pour publier la série aux Etats-Unis. Pourtant, Mikio refuse de suivre la piste ouverte par Alfred, parce que cela reviendrait à modifier la nature de son manga, à faire des contorsions qui le dénaturerait. Il a déjà donné (cf. Short Horrors). Il continuera donc à faire Dark Walker comme il l’entend, à en payer le prix, mais pour lui il est hors de question de censurer plus encore sa série. On peut d’ailleurs remarquer que la possibilité de s’exporter si elle assure à l’auteur des revenus (lointains) n’est pas approfondie plus que cela : faire du manga d’abord pour l’étranger n’est jamais envisagé par Mikio. Les frontières comptent toujours en 2019.
Ne pas être en contradiction avec soi-même. Cet élément que n’aurait pas renié Socrate est endossé par Mikio qui voit sa situation financière fragilisée. Il maigrit, doit se passer des services d’un assistant, travailler toujours plus… Comme il n’a pas de famille dont il doit s’occuper il peut engager le combat (avec le soutien minimal (?) de son éditeur), perdu d’avance, avec les censeurs sans regret. Il mènera son manga au bout et il constituera le meilleur des testaments, la meilleure des marques de son passage, de sa volonté de défendre la liberté d’expression avec ses armes. Le crayon contre le tampon (de la censure). David contre Goliath. Son cas illustre d’ailleurs la situation plus générale de l’industrie du manga, trop faible pour se mobiliser, se faire entendre et peser sur les décisions politiques, qui se fait donc taper dessus et sert de bouc émissaire commode.
Face au mangaka se dresse la toute puissante commission des experts pour juger les ouvrages sains, nocifs, etc. Rien que l’apparition du terme nocif fait tiquer. Et quand on entend les membres qui composent cette commission, une seule envie nous parcourt : les gifler les uns après les autres. Si Yukiwo Toda n’est pas à mettre dans le même sac (il est dramaturge, romancier de profession est on voit au fil des pages que son appartenance au champ littéraire, artistique, le pousse à se désolidariser de ses collègues), les autres forment un beau groupe de vainqueurs aux propos méprisants, qui se congratulent et portent aux nues Osamu Furudera (ancien ministre et professeur de sociologie…), le leader de ces censeurs tous plus agaçants les uns que les autres. Un beau gaspillage de capital humain.
La tension entre la commission et Mikio atteindra son sommet dans le tome 2 avec une conclusion extrême, qui m’a semblé aller un peu trop loin dans la volonté de taper sur la censure. Pour faire bref, en voulant (ré)éduquer les auteurs déviants, pour en faire à nouveau des « membres productifs de [la] société » (« une des missions les plus importantes du gouvernement ») la commission (la société ?) se révèle in fine plus inhumaine que le contenu des mangas qu’elle condamne. Les « soins » apportés à l’individu entrave sa liberté, son autonomie. Une telle réhabilitation a-t-elle la moindre valeur ? Peut-elle être justifiée ? Poison City nous suggère avec force que non et que tous les moyens mis en œuvre seront peut-être balayés (Shingo Matsumoto) mais cet espoir semble bien fragile et incertain car, même si la loi à l’origine d’une telle épuration de la littérature manga voit ses fondements démontés, elle demeure…
La société japonaise qui apparaît ainsi dans le manga ne fait pas rêver et il faut souhaiter que les JO de 2020 ne se dérouleront pas dans un tel contexte. Elle n’apparaît pas plus forte ni meilleure et le propos servi vaut pour l’avertissement et la mise en garde : attention à ce que d’autres sociétés ne connaissent pas cela. Surtout que Tetsuya Tsutsui nous rappelle que les Etats-Unis sont passés par là dans les années 1950 et suivantes avec la mise en place du Comics Code décédé aujourd’hui aux Etats-Unis… (l’article renvoie aussi vers la loi du 16 juillet 1949 qui vaut le coup d’œil)
En même temps que le portrait d’une société peu entraînante apparaît, les questions et interrogations ne manquent pas de surgir. Les 15 + 1 chapitres qui composent Poison City ne sont pas avares de ce point de vue : comment en est-on arrivé là ? La question de la liberté d’expression et de son articulation avec les autres libertés ne manque pas d’émerger, tout comme la condition de mangaka, l’accent placé sur les médias, journaux et les effets non-voulus de leur activité qui ont parfois des conséquences assez terribles (si bien qu’à côté de la commission, les médias méritent aussi de monter sur le podium de ceux qui posent problème…)
Quelques mots, au passage, sur Dark Walker (DW’): derrière le manga d’horreur – et l’infection qui progresse et finit par contaminer de plus en plus de monde, laissant nos deux héros bien seuls – se cache une mise en abyme de ce qui arrive à Mikio Hibino. Cet élément apparaît dès le début, le synopsis du manga DW’ s’appliquant au Japon que le mangaka a sous les yeux. Le parcours de Tôru et de Haruka fera donc écho à ce qui arrive à leur créateur. De ce point de vue le jonglage entre les deux univers (Japon de 2019 et univers de DW’) est réussi, agréable à suivre. Ce manga d’horreur, pour ce que l’on peut en voir, est bien sympathique ! Poison City est le premier manga de Tetsuya Tsutsui que j’ai lu en entier. Son style de dessin ne m’a pas déplu même si j’ai préféré l’allure des personnages de DW’, notamment leurs visages, par rapport aux autres.
Une phrase pour commenter l’édition française : la traduction de David Le Quéré est très agréable à suivre (une inversion est à signaler en page 7 du tome 2), même si le passage sur le beurre dans les épinards m’a fait une impression bizarre (l’effet du contexte japonais) ; je regrette juste que quelques noms (de personnes, de médicaments…) ne fassent pas l’objet d’une note de traduction.
Si on enlève la couverture des tomes de Poison City, on découvre des paysages urbains qui sont présents d’un tome à l’autre, sauf qu’ils subissent une forte dégradation. Une atmosphère à la Je suis une Légende (entre autres) plane… symbole d’une chute annoncée ? L’optimisme ne règne pas au fil des deux tomes et cela m’a fait terminer sur un sentiment partagé. Au fil des pages j’ai oscillé entre deux pôles : une sympathie pour Mikio Hibino et les réflexions conduites autour du métier de mangaka ; une certaine circonspection par rapport à ce qui se passe. T. Tsutsui ne cache pas sa position et on comprend rapidement que le manga va développer son point de vue. Reste qu’à trop taper dans la même direction j’ai trouvé que la dramatisation était poussée trop loin. C’est le cas non seulement de la fin mais aussi des experts qui sont parfois (souvent ?) trop caricaturaux (mais ils ne sont peut-être pas si éloignés que ça de la réalité ?) ce qui nuit à l’immersion. L’ode à la liberté d’expression rate parfois son objectif.
Finalement, s’il fallait résumer Poison City en une phrase, elle serait de Yukiwo Toda : « La sévérité de la censure reflète la lâcheté d’une société. » Le propos – et le manga – seront-ils toujours d’actualité dans 70 ans ? Rendez-vous en 2085 pour le savoir…