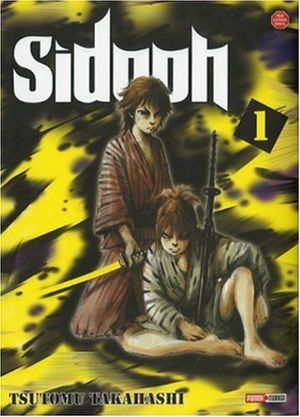De Sidooh, il fut ardu d’en dire des choses. Un volume entier m’était rapidement passé sous les yeux, et je ne trouvais rien à en dire. Une critique, c’est une réplique à un propos tenu par une œuvre, et si je n’avais rien à rétorquer, ce n’était pas que j’avais été soufflé ou que les arguments me manquaient, mais parce qu’on ne m’avait rien dit. On ne sait trop où on va avec Sidooh et nous serons guère mieux lotis lorsque nous serons arrivés. Sidooh est un bus dans lequel on monte sans savoir pour quoi et qui ne sait pas vers où il roule ; mais il y roule avec assurance, simulant par là l’allure d’un parcours dessiné par avance.
Oh, Sidooh ; où veux-tu en venir et où veux-tu m’emmener ? La lecture n’est pourtant pas désagréable, mais on ne sait trop pourquoi on persiste à l’entreprendre. Pour avoir encore récemment lu Bakuon Retto du même auteur, je puis assurer ici que les dessins, fidèles à ce qu’ils étaient alors, ont décidément tout pour plaire. J’ai cru y voir ici la juste jonction entre le trait de Akio Tanaka et le style de Hiroaki Samura, le tout cherchant à tendre vers un Vagabond de synthèse pour ce qui est du dessins. Et pas que du dessin finalement.
Les modalités de narration sont en effet relativement analogues entre les deux œuvres. Une rapide entrée en matière, un parcours initiatique précoce jonché de déconvenues, la condamnation à mort du personnage principal tôt dans le récit…. et puis il y a le katana ; ça aide à faire des parallèles malgré les quelques siècles qui séparent la chronologie des deux œuvres. Sidoooh serait alors un sous-Vagabond ? C’est une question franche que je pose alors. Car à chacune de mes interrogations concernant l’œuvre et ses motivations, je n’ai guère entendu que l’écho pour me gratifier de ses réponses. La lecture, j’insiste, n’est pas désagréable en soi, mais elle est déroutante. On se laisse emporter comme on laisserait voguer son embarcation en suivant le courant… mais on ne sait trop ce qu’on fait sur cette rivière qui nous emporte en premier. La finalité nous échappe.
Sans doute cette finalité nous paraît plus nébuleuse que jamais alors que l’œuvre est faite de gratuités indues. La scène de l’orgie de demoiselles dans la prison m’est apparu comme un fan-service aussi vulgaire qu’injustifié. Rien, scénaristiquement ou bien relatif aux canons de la logique ne permet de déterminer le « pourquoi » de cette scène. De cette scène, et de tant d’autres qui suivront.
L’œuvre cherche à se donner un sens du bizarre sans même vraiment savoir pour quelle raison. Certes, le rendu est déroutant, mais il l’est pour la finalité de l’être ; sans qu’aucun dessein ne lui soit attribué. Nous devrions être ébahis des étrangetés ici présentées comme nous le serions supposément devant un film de Jodorowsky, mais ça n’a absolument aucun propos. Les mantras « Gudan », « Morumi », les assassinats occasionnés sans peine ; tout ce qui de près ou de loin se rapporte au Byakushin, tout ça n’est que variables aléatoires compilées les unes sur les autres dans un récit qui se construit au gré du hasard.
Deux orphelins veulent devenir plus fort ? Ce serait ça le leitmotiv ? N’importe qui y verra là le prétexte tout trouvé pour amorcer une histoire qui s’empressera d’errer aussitôt qu’elle se sera manifestée.
Les lecteurs de cette critique, à lire à mes impressions, s’imagineraient qu’ils auraient ici affaire à un récit quelque part expérimental dont le lyrisme aurait échappé à la bête sourde que je suis. Mais qu’on ne s’y trompe pas et qu’on ne se fourvoie pas sur ce que j’ai à en dire, Sidooh n’est pas une histoire qui se lit hors des cadres narratifs conventionnels, ce n’est pas une expérience scripturale réussie ou raté ; rien qu’une histoire tout ce qu’il y a de plus banale qui prend malgré elle un caractère impénétrable du fait qu’elle ne sait trop quoi nous raconter ni comment le faire. Toutefois, elle articule convenablement. Le drame étant qu’aucun son ne nous parvienne.
De Shamo non plus, Tsutomu Takahashi n’a pas emprunté que les dessins. Le fait pour Shotaro de vouloir devenir samouraï rappelle l’initiation de Ryô au karaté. Le contexte carcéral ainsi que le viol de Gentaro – moins incommodant que celui de Ryô, il faut bien le dire – permettent là encore de mieux accentuer les similitudes entre les deux œuvres pour ce qui fut de leurs débuts respectifs.
Les chapitres se lisent d’autant plus facilement qu’ils se lisent avec une rapidité déconcertante. Les plans sans dialogues, les répliques courtes, tout ça parsème un récit d’une narration quasi-muette du fait qu’elle n’ait précisément rien à dire. Le dessin aide pour beaucoup à ne pas s’en formaliser puisque le panorama qu’on nous délivre est plaisant au regard. Mais le panorama, trop souvent, s’accepte comme une diversion visant à nous détourner de la faiblesse du contenu de chaque chapitre. La manœuvre est habilement menée, mais si l’on se risque à voir à travers, alors on contemple à quel point l’œuvre et nue. Et je vous parle là d’une nudité décharnée.
Sous couvert de réalisme, seul l’absurde s’accomplit avec un sérieux de pitre. L’arène de Byakushin relève de l’absolu fantasque et ne trouve sa place nulle part.
Après trois longs tomes où il ne s’est passé que bien peu de choses, mais étalées sur d’innombrables chapitres, enfin nous assistons au premier combat au katana. Et, une fois le spectacle délivré, nous ne pouvons qu’en conclure que monsieur Takahashi ne s’est décidément pas suffisamment inspiré des dessins d’Akio Tanaka ou de Hiroaki Samura pour ce qui est des chorégraphies de combat. Ni suffisamment, ni même a minima par ailleurs… car les combats, même une fois esthétisés à outrance, ne délivrent aucune dose d’intensité. La scénographie y est, mais les idées beaucoup moins. Derrière les excès des graphismes, il n’y a en réalité que bien peu de choses à se mettre sous la dent. La forme, jamais ne couvrira suffisamment bien le fond.
Tout se passe trop facilement malgré l’adversité de façade. La difficulté n’est que simulée en massacrant des personnages tertiaires du côté des protagonistes. On infiltre facilement les antagonistes, on les élimine d’autant plus facilement en garnissant la conclusion d’un combat final. Et le tout, alors que les protagonistes n’auront jamais trop pris la peine d’être développés : ils sont des assassins avec des airs. À chacun son air, mais ça ne va que rarement au-delà de l’apparence.
Sans surprise, la petite bande s’émancipera sans peine de Rugi après que celui-ci les ait trahi – ce que chacun aurait pu venir voir depuis un kilomètre.
La surprise tient cependant au fait que Kiyozou ait été éliminé par son auteur. Il fallait moins ça d’agneau sacrificiel pour un peu mettre fin au sentiment de facilité abondamment diffus dans le manga.
La suite n’est qu’une série d’errements guignolesques pour justifier que la vengeance n’adviendra pas demain. Les arcs qui s’ensuivent sont stériles et visent à aménager une intrigue qui se poursuit là encore sans savoir où aller et ce, bien que la destination lui ait pourtant été signalée. Rugi passe le temps d’un coucou occasionnel, histoire de rappeler que c’est après lui que le scénario en a. En principe. Car en attendant, les esthètes répandus à raison de quelques millions sur chaque planche s’emploient à donner quelques coups d’épée ici et là sans trop qu’on sache vraiment pour quoi une fois que l’on prend du recul sur la situation. Nous sommes au Japon durant la deuxième partie du 19e siècle, dès lors, nous ne pouvions pas passer à côté du Shinsengumi. Même Hijikata Toshizô sera de la partie. Elles sont là, ces figures historiques, parce que le cadre historique y prédispose ; le sens de leur engagement reste toutefois à déterminer. Il en va de même pour la guerre dans laquelle s’engagent des protagonistes qui, décidément, ne savent pas quoi faire pour tromper l’ennui d’un récit en panne d’inspiration depuis son premier chapitre. La narration s’occupe comme elle peut et bavarde plus qu’elle ne dit.
De par son manque d’ambition et même de propos, le tout aggloméré à quelques esquisses agréables aux yeux, Sidooh m’a finalement rappelé Le Nouvel Angyô Onshi, les extravagances fantasmagoriques en moins. Sidooh a tout pour plaire sur le papier mais, dans ce papier, trouve malgré tout le moyen d’être assez apathique pour ne rien vraiment suggérer quand on le lit. Que la bagatelle dure depuis si longtemps assoupit plus encore les lecteurs des débuts qui, depuis trop longtemps, naviguent désespérément à vue sans l’espoir d’apercevoir un rivage.