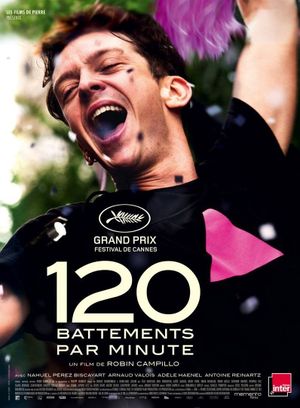Tout commence par une séquence où des ombres, filmées en gros plan, murmurent dans l’obscurité, à côté d’une scène où des patrons de lobbys pharmaceutiques exposent fièrement l’avancée des nouveaux traitements créés dans leurs laboratoires. Très vite, le groupe tapi dans les coulisses s’impose devant les projecteurs et prend la parole pour dénoncer la manipulation de ceux qui prétendent lutter contre le SIDA. A l’aide d’un montage parallèle, on est instantanément mis face aux protagonistes qui analysent leur action et son efficacité, quelques jours après l’intervention. Ce procédé qui permet de présenter les personnages est à l’image du film de Robin Campillo : 120 battements par minute est une expérience de cinéma pure et dure, inédite, qui relate comment les militants d’Act up ont lutté pour améliorer la situation des opprimés, ceux qui ont été contaminés par le virus au début des années 90. Comme le laisse entrevoir cette scène d’introduction, Campillo va éviter l’écueil qui consisterait à proposer un film linéaire et lambda retraçant l’histoire de l’association. Outre des effets de montage, il n’ajoute aucun artifice et calque ses mouvements de caméra sur les descriptions de la scène qu’apportent les militants. Le débat n’est qu’accompagné d’un son, bref, un battement qui rythme les prises de parole diverses et éclectiques, à l’image de l’assemblée qui constitue cet amphithéâtre lors des RH, réunions hebdomadaires.
Immersion.
Dès lors, le film se rapproche du documentaire mais aussi du théâtre. L’ultra-réalisme et l’effacement des effets de style donne au spectateur l’impression d’être assis en compagnie de toutes ces figures, ces personnalités qui brillent par leur altérité et la cohérence de leurs interventions, accompagnés de légers claquements de doigts pour approuver ou non les prises de parole. Alors qu’ils n’étaient que des ombres, on découvre progressivement qui sont les activistes et le film brille par la pertinence des débats, qui permettent aussi de s’attacher à différents portraits de militants. Chaque son dans l’amphithéâtre renforce une authenticité bienvenue et cette absence d’extradiégétique n’est pas sans rappeler la pièce de Joël Pommerat, ça ira qui utilisait les mêmes subterfuges pour relater les débats politiques qui animait la cour de Louis XVI. Des scissions visibles dans le groupe apparaissent, et rendent étonnamment l’ensemble des personnages captivants: Campillo échappe au manichéisme lambda visant à diaboliser certains membres et à prendre parti pour telle ou telle idée. Au contraire, leur capacité à coexister jusqu’à la fin malgré les tergiversions pousse à l’admiration.
Petit à petit, il devient possible de mettre des noms sur des visages qui écoutent, s’observent et avancent, jusqu’à passer à l’acte et pénétrer dans un laboratoire pour obtenir des réponses sur le résultat d’un traitement. Encore une fois, la caméra s’efface pour suivre les mouvements des personnages qui s’appliquent à coller des affiches et repeindre de faux sang les vitres de l’usine. Comme lors de la première séquence, les paroles prennent forme et ce que laissait entrevoir la réunion passe du stade de projet au concret. Aucune violence n’est à déplorer et ce même si la gêne éprouvée est réel pour le spectateur face à l’intrusion du bureau et sa dégradation partielle, preuve du succès de l’action. Cette efficacité visuelle causée par un parti pris pragmatique dans la réalisation participe pleinement au sentiment d’immersion au sein de ce groupe, sentiment renforcé par de longues séquences où les mêmes personnages se retrouvent de nouveau dans l’obscurité, loin des radars, pour danser sur fond d’un thème « house », qui devient indubitablement l’hymne de ce mouvement. L’alternance entre ces séquences presque oniriques, où une poussière devient une bactérie à l’aide d’un fondu enchaîné, et d’autres extrêmement terre à terre participe à la création d’une véritable expérience de cinéma, où l’équilibre entre ces deux pôles participent à l’harmonie globale de ces 2h20. Campillo devient le modélisateur d’un univers méconnu et authentique dans lequel les personnages ne sont guidés que par un intérêt commun : la lutte et l’entraide pour vivre.
Fraternel.
Outre l’histoire d’Act up, le metteur en scène se focalise sur deux des membres de l’association, à savoir Sean, électron libre, engagé et volontaire, et Nathan, néo-membre, observateur et intéressé. L’arrivée de ce dernier au sein d’act up provoque une émulation et ne laisse pas indifférent Sean. La découverte réciproque d’une personnalité diamétralement opposée donne à voir des scènes caustiques où le film brille de nouveau par son écriture. Nathan, n’étant pas atteint de la maladie, a du mal à trouver ses mots pour faire comprendre à Sean les sentiments qu’il éprouve. S’il prétend vouloir l’aider, c’est parce qu’il ne peut se résoudre à imaginer son ami s’éteindre progressivement, tant son énergie est essentielle au sein d’act up. Pourtant, la dégradation croissante du corps du jeune homme et sa résignation ascendante appuie le propos du film, et ce malgré quelques dialogues préventifs inappropriés. Le dénouement tragique inévitable est à l’image du couple, naturel et dénudé de toute forme d’héroïsme exacerbé. Loin des stéréotypes de Kechiche et du symbolisme simple et grossier dont était synonyme la relation qui unissait Adèle et Léa Seydoux, Campillo opte pour une histoire épurée, allant à l’encontre des codes de la romance classique. Lorsque Nathan injecte le poison dans le corps de son compagnon, il n’y a pas d’adieu, Sean râlant même en constatant qu’il n’est pas encore mort quelques minutes avant. L’exécution faite, Nathan retourne se coucher, dort, et finit par pleurer, presque paisiblement, avant d’accueillir un par un les membres d’act up autour du cadavre. Tout le monde finit même par s’étonner lorsque la mère de Sean veut ajouter le terme « courage » sur l’oraison funéraire de son fils, tant le film ne cherche pas à diviniser ces personnages, comme si cette solidarité spontanée et ces sentiments fraternels étaient logiques et immédiats. Une lutte humaine à laquelle il devient foncièrement difficile de ne pas adhérer tant le film brille par ses partis pris liant de manière synchronique forme et fond. Une réussite dans le genre.