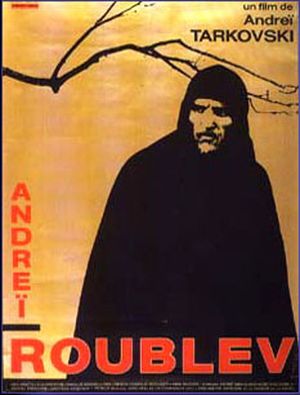Vingt-quatre ans de la vie d'un homme, peintre et ascète au début du XVème siècle. Où l'amour et la croyance apprise au monastère d'Andronikov sont mises à l'épreuve de la division d'un continent qui n'était pas encore une nation. Andreï Roublev affirme sa conviction de la bonté du peuple, et que tous sont "une seule terre, une seule foi, un seul sang". Une seule foi ? Dans la Russie de l'époque coexistent la pratique des moines, la religion dure de Théophane le Grec qui vit solitaire et séparé comme les pères de l'Église, les renversements blasphématoires et carnavalesques du bouffon, et la fête des anciens slaves célébrant la venue de l'été et la déesse de l'amour. Un seul sang, encore que séparé comme les deux princes dont l'un, le cadet humilié, trahira en livrant la ville de Vladimir aux hordes tartares, qui ont remplacé les chevaliers teutoniques de l'Ouest comme danger majeur d’invasion. Longtemps, Roublev résiste au sentiment de dissension, il résiste à Kirill, pour qui Dieu a créé le pope et Satan le bouffon, il résiste en refusant de peindre le Jugement Dernier, qui ajouterait à l'aliénation générale au moment où le pouvoir aveugle ceux qui sont trop libres, les tailleurs de pierre. Au terme de trois heures en noir et blanc, Andreï Tarkovski donne au spectateur tout l'art du peintre ; et à cet art, d'un seul coup, toute la couleur du cinéma. Cette apparition provoque comme un tremblement de terre : c'est bien sûr une coda apportant à Andreï Roublev la sérénité lyrique qui lui semblait étrangère, en même temps qu’un adieu plein de regrets et de grandeur. Il fallait ces dernières minutes pour que l'œuvre révèle un optimisme jusque là caché et une morale de défi, cette sorte de preuve par neuf pour que soit indiscutable le triomphe du créateur. Les fondus enchaînés, les détails soulignés sur les icônes outragées par le temps trouvent enfin la Trinité, contemplée d'abord par le bleu des tissus puis d'un seul tenant, Trinité en laquelle Tarkovski voit l'expression majeure d'un idéal de fraternité, d'amour et de sainteté. Ainsi s’achève l’ode humaniste qui aura porté la méditation poético-plastique du cinéaste à sa plus haute plénitude.
Un peintre, à l'écran s'entend, ce n'est pas un contorsionniste évoluant sous le plafond de la Chapelle Sixtine, ce n'est pas non plus un monsieur dont on surprend le coup de pinceau de l'autre côté d'une vitre ou par-dessus son épaule, alors que quelques minutes en tête-à-tête avec les Demoiselles d'Avignon en apprennent autant sur son mystère. Un peintre ne saurait non plus se réduire à une ressemblance surprenante entre le monde dans lequel il vit, ou tel qu'il le voit, et ce que ses toiles proposent. Andreï Roublev relève d'une autre idée, à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus riche : l'affrontement d'une réalité historique et d'une sensibilité personnelle dont l'œuvre constitue la synthèse, et non l'addition ou les reflets. Avant de donner à voir le miracle de la création, Tarkovski devait faire la chronique d'une époque et raconter une aventure intérieure. Une chronique avec ce que cela suppose de discontinu, de fragmentaire, pas parce que cette période et la vie du personnage ne sont connues que de façon très incomplète, mais car la réalité dépeinte est extérieure au héros, qu’elle lui est imposée, l'agresse et le meurtrit, qu’il la subit sans que jamais il puisse agir directement sur elle. Ces moments sont arrachés à l'histoire de la vieille Russie, non aux "Mémoires" littéraires qu'aurait pu écrire Roublev. Ce dernier est d'ailleurs souvent absent, pas pour de simples interludes de mise en situation ou d'explication, mais pour des temps dramatiques très forts, chargés, indépendamment de lui, de leur propre signification, à l’instar de ce prologue stupéfiant où un aéronaute, Icare russe du temps d’Ivan le Terrible, avec quelques siècles d'avance donc sur Pilâtre de Rozier, s'envole, conquiert le ciel pendant un instant avant de se tuer en se fracassant sur le plancher des vaches. Si Roublev est souvent le témoin des faits, l'image que l’on en a ne prétend pas être la sienne. Elle est celle que le cinéaste historien crée et impose. Confortable comme un galop cosaque et légère comme un chant sacré, l’œuvre évolue sans cesse sur deux plans, le réaliste et le symbolique, sans que jamais la thèse étouffe le naturel de la narration.
Parallèlement à la suite des événements, que le sens du rythme et du cadre comme la matérialité des présences transforment en fables mythologiques, court masquée, comme occultée par eux, une autre ligne dramatique, de celles qui auraient suffi à faire un film psychologique classique si elle avait été suivie de bout en bout. L'intransigeance aboutit à l'impuissance artistique, l'amour de tous les semblables débouche sur le meurtre qu'il est impossible d'empêcher ou de ne pas commettre, le silence devient refuge. La réussite d'un jeune garçon qui s'improvise fondeur de cloches relance le défi créateur. Le désir et l'action, l'individu et l'Histoire peuvent alors se rejoindre. Mais ce n'est pas cette moralité optimiste qui seule ici compte, c'est aussi et surtout l'attitude de Tarkovski à l'égard de son protagoniste. Avant que cette crise aboutisse à la prison du mutisme et de l'inactivité, il choisit de le montrer soit discourant, soit en proie à l’ardeur d'une révélation. Ses paroles sont autant de professions de foi en l'homme, en l'art, que le réalisateur reprend à son propre compte. Ses vertiges devant la cruauté, la mort injuste, le désir sexuel, sont magnifiés par la beauté extrêmement composée de l'image, la violence inattendue des plans, le souffle d’une exceptionnelle puissance qui les anime. Que Roublev parle ou souffre, le réalisateur s'identifie à lui. Il tire sa propre démarche de celle du peintre et y trouve sa justification. La Trinité devient le signe de l'accomplissement non plus de Roublev seul, mais aussi de Tarkovski, comme si le vieux moine peintre d'icônes, qui avait en commun avec lui l'amour de sa terre et des hommes, avait réussi par-delà les siècles à transmettre son secret au cinéaste. Mais celui-ci n'est pas dupe : le secret reste à réinventer, à chaque fois, et par chacun. C’est ainsi qu’il exprime la grandeur de l’humble combat mené par Roublev pour dissiper les ténèbres de son époque et laisser à ses semblables un message d’espérance. Et c’est à ce prix seulement que s’accomplira la prophétie dostoïevskienne selon laquelle la beauté sauvera le monde.
Car Roublev traverse son temps en proie au doute, refusant de céder aux canons officiels, préférant maculer de boue le mur blanc d'une église plutôt que de la peindre comme il ne l'entend pas. Ses exigences artistiques et culturelles sont celles des réfractaires à l’obscurantisme jdanovien. Il rejette les règles de sa confrérie car il souhaite décrire les douleurs de son peuple, l'arbitraire, l'injustice, la misère. Il veut d'un art en rapport avec la réalité humaine, qui s’interroge, qui libère, qui conteste les dogmes. Son apprenti Kirill, allant demander des leçons de peinture à Théophane, le surprend tranquillement couché sur un banc, méditant-rêvassant sous les voûtes d'une cathédrale tandis que, sur le parvis, un saltimbanque est ignominieusement supplicié. Roublev repousse le culte de la personnalité et s'oppose farouchement à Théophane qui, lui, se satisfait qu'on crée pour Dieu, non pour les hommes. Andreï ne pactise pas avec l'enfer. Mais la problématique de Tarkovski ne s’arrête pas là : une foi résolue sa crise personnelle, une fois rompu le vœu de silence, Roublev se retrouve confronté à ses problèmes d’avant. Lui aussi a peint un monde idéal, d'espoir, d'amour et de clarté, un monde à venir dont le cinéaste fait tout pour persuader le spectateur qu’il sera terrestre, et qu’il a représenté en se conformant aux nécessités idéologiques d'une orthodoxie. Il n'exprime pas le poids insupportable de la vie qui est la sienne, mais cherche la graine de la foi chez les hommes de son temps. Il se fait porte-parole, porte-lumière, et le cinéaste affirme à travers lui la vocation de l'artiste-phare, du poète-voyant. Même s'il s'est tu longtemps, même s'il a "péché", il est resté l'homme d'une église. Il est montré comme un créateur libre de refuser les thèmes qu'il conteste, d'incliner selon son inspiration ceux auxquels il croit, ou de ne pas peindre du tout. Le jeune fondeur, en revanche, établit son œuvre au creux d'une ruse, d'un combat constant avec les pouvoirs. Complémentaires, l’un comme l’autre nourrissent cette réflexion vivante et "soufferte" sur la vocation de l’art au bien qui sous-tend le film entier.
Tarkovski plaide ainsi pour les vertus de l'imagination, du rêve, de l'audace, contre les calculs, les règles, les prudences de la bureaucratie, rogneuse d'ailes. Combien de poètes le régime soviétique n'a-t-il décapités ? On peut y songer en voyant tituber les tailleurs de pierre dont le prince fait crever les yeux une fois leur tâche achevée. Le cinéaste ne triche pas avec la dialectique de l'art et du pouvoir qu'il retrouve, cruellement, au sein même de l'activité créatrice. Il l’enrichirait même plutôt en contradictions. Ainsi le fondeur n'hésite-t-il pas à faire appel au bras séculier, à la police du seigneur quand ses ouvriers épuisés refusent d'appliquer une couche d'argile supplémentaire sur le moule. Pas d'accouchement sans douleurs ni injustices : l'artiste serait-il tenté, par la logique même de l'œuvre, de se comporter en tyran ? L'énorme chantier mis en place pour la fusion de la cloche, les troupeaux humains qui s'y agitent, tiennent à la fois d'un hymne collectif à la joie de créer et des bagnes staliniens. La liberté de l'art n'est pas une chose simple et Tarkovski ne la simplifie pas. Mais pour faire le procès d'une dictature intellectuelle qui, avec ses doctrines et ses oukases, ignore, nie ou écrase les puissances de la vie (la sève et la terre, l’amour et le sexe), il se fait le chantre d'un spontanéisme, d'un vitalisme qui sont aux frontières du mysticisme. Il exalte l'inspiration, célèbre le hasard, valorise l’intuition (la bonne argile découverte lors d'une chute et d'une glissade, l'alliage composé au petit bonheur…). Il emprunte à Dokjenko le cheval comme symbole de la terre et de la vie. Il pétrit la glèbe, multiplie les images d'arbres et plus encore de racines. Quand l'iconostase de la cathédrale de Vladimir a été brûlée, elle évoque à s'y méprendre une forêt de bouleaux. Au dénouement, le tonnerre éclate et la pluie ruisselle. La peinture redevient boue, l'icône bois, et la nature se réinstalle. L’insistance de Tarkovski à filmer des éclaboussures, des écorces, des feuillages, du limon, des choses vues de très près dans un film dont l'espace est par ailleurs constamment dilaté, ouvert sur des perspectives cosmiques de forêts et de fleuves, relève d’une contiguïté avec son discours sur la création : c'est de la terre et de l'eau que le peintre tire la matière de son œuvre. Une création qui n’est pas montrée comme éternelle, soumise à l'usure des éléments, mais qu'il suffit au cinéaste de privilégier pour qu'ils soient réinvestis culturellement, dans un cycle naturaliste sans fin.
Sur le plan formel, Andreï Roublev occupe dans l’œuvre de Tarkovski une place opposée à celle du Miroir, film de l'intérieur de la peau, du cœur et du cerveau, où l’auteur racontera la vérité intime de ce qui paraît ailleurs comme message, comme discours, et selon une approche toujours parabolique. Le récit avance sur de larges tableaux, et son cadre est mis en abyme dès la séquence du bouffon par le rectangle allongé qui désigne et cerne depuis la cabane l'arrivée des trois moines sous la pluie. Cette figure a la forme même du regard cinémascopique, soulignant le spectacle dans le film, l’immensité de la fresque. Seule une épopée en effet pouvait dire ensemble un sol, un peuple et un homme, parce qu'elle est précisément le genre de la fondation. À elle appartiennent la vision brughelienne des tailleurs hagards dans les bois, les massacres ethniques, le cheval noir qui se roule sur le dos après la chute du serf volant, la face martyrisée du pope hurlant dans la basilique sous la torture des barbares, l’orgie nocturne de la fertilité où garçons et filles nus se livrent à des rites païens le long d’une rivière... C'est à beaucoup de ces images inoubliables que le film dut d'être violemment critiqué en URSS et de risquer la destruction, sur une accusation de réalisme et de crudité peu convaincante en ce qu'elle ne fait pas la part de l'amplification épique, des effets de section au montage, des nombreux ralentis, par exemple de celui qui transforme en ange l'apprenti Foma à l'instant où une flèche le transperce. Tarkovski maintient dans sa ligne directrice le travail de l'esprit guidant celui de la matière, la naissance d'une œuvre face à la naissance d'un monde. Il filme avec la même intensité les vastes paysages, les manifestations les plus communes ou les plus extrêmes de la nature, les bâtiments de culte et les demeures des humbles, les animaux, les visages des prêtres, des soldats, des paysans et des simples d’esprit. Partout la mise en scène rend sensible une présence surnaturelle mais qui ne fait appel qu’au regard du cinéaste sur le monde réel pour devenir perceptible. Le rapport organique à la terre natale, l’appétit démesuré de contemplation, l’existence invisible mais impérieuse d’une morale supérieure, la dimension spirituelle présente en chaque être, tout concourt à faire d’Andreï Roublev une authentique épiphanie moderne.