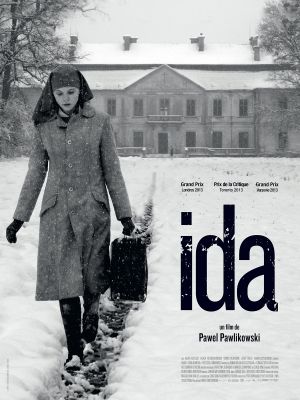Pawlikowski parvient avec Ida à un haut degré de maîtrise. Entre académisme (proche d'un Tarkovski pour sa mise en scène ou d'un Dreyer pour son économie de moyens) et volonté de s'éloigner des formats classiques (avec ce cadrage qui coupe les corps et les visages, proche du Forman des amours d'une blonde) il semble enfin se trouver et parvient sans aucun doute à atteindre la justesse (si simple de prime abord, mais ô combien difficile d'accès).
Ce film aux airs d'ascétisme cache au fond de lui d'innombrables nuances, voire de dualités, qu'il parvient subtilement à marier (comme dans son précédent my summer of love, mais en mieux). La dialectique opère tout d'abord au niveau formel avec le jeu constant entre horizontalité/verticalité (la croix qui traverse la blancheur virginale de la neige avant de s'ériger devant le couvent; les corps érotisés allongés sur le lit répondant aux bustes droits lors des prières adressées à Dieu; …), ou encore entre ciel (Dieu, le paradis) et terre (que l'on creuse pour retrouver ses morts), clair/obscur, noir et blanc, silence et Coltrane. Par ailleurs, à travers les deux protagonistes, issus d'une même famille mais si loin l'un de l'autre, s'opposent moralement la vertu et la débauche, religieusement la foi et l'athéisme, socialement classe aisée et vœux de pauvreté.
A travers ce réseau de dualismes, Pawlikowski montre en filigrane l'état d'une Pologne tiraillée entre des pôles contraires (communisme et religion, assassinat en masse et recherche d'une paix spirituelle), cherchant la cohérence d'un discours, une identité une et indivisible.