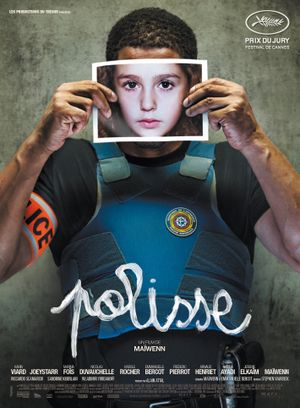C’est un film en dents de scie, inégal, tout en énergies et tout en ratés. C’est-à-dire que le film ménage des instants intenses, puissants et rentre-dedans (l’accouchement d’une adolescente qui s’est faite violer, le volage dans les plumes entre Viard et Foïs, Kiberlain en larmes…), pour, la seconde d’après, (re)tomber dans la routine d’un récit qui ne tient pas la distance du flux tendu (et un flux tendu de deux heures, faut savoir le tenir ma cocotte, sinon on s’emmerde). Suivant à la semelle le quotidien de la brigade de protection des mineurs, Maïwenn et sa co-scénariste Emmanuelle Bercot croient bon de développer des intrigues parallèles pas spécialement intéressantes (divorce, anorexie, amorce d’une histoire d’amour…) qui nagent en eaux tièdes et parasitent la force de leur vision, supposée vériste, sur le travail difficile de ces femmes et de ces hommes faisant corps ensemble contre une adversité, une horreur à multiples visages, et qui, bizarrement, passent leur temps à gueuler et à se chamailler (au boulot comme dans le privé).
On passera sous silence plusieurs scènes trop appuyées, limite démago, tels ces enfants roumains se mettant à danser dans un bus sur du Breakbot (ils ont du goût dans la police) alors qu’ils viennent d’être arrachés à leurs parents, ou encore ce présumé coupable intouchable qu'on protège en haut lieu, ou encore cette mère et son petit garçon dont elle doit se séparer, et ce petit garçon de hurler et de pleurer longtemps devant la caméra pour on ne sait quelle raison, sinon celle de provoquer une émotion à tout prix, martelée jusqu’à l’os dans le crâne du spectateur (attends, je vais filmer la morve aussi, ça fait trop réaliste).
Et de réalisme, parlons-en : trop de réel tue le réel, ou trop d’impro tue l’impro, c’est comme on voudra, et Polisse donne davantage l’impression d’observer des acteurs prodiguer des cours d’improvisation plutôt que de jouer vraiment un personnage (Bercot et Elkaïm, par exemple, ne sont jamais justes), style "Bon là, on fait une soirée jeux, alors on y va, lâchez-vous et on voit ce que ça donne ; là, on va devoir se prendre la tête ; là, on va danser en boîte de nuit, tiens Joey, tu veux faire un pas de danse tout pourri pour faire genre ?", etc. On n’y croit pas toujours parce que ça sonne souvent creux, voulu, calculé (la discussion politique à la cantine, celle sur les hommes et leur bite au restaurant).
Faut dire aussi que chacun a hérité d’un rôle-poncif, d’un joli cliché éloigné du prétendu réalisme affiché par le film comme un étendard glorieux, hyper-vendeur : l’écorché vif, l’intello, la bobo qui mange des croissants bio, le chef cool, le super chef pas cool, la rebeu de service (et le black, il est où le black ?), la lesbienne alcoolique en cuir (et pourquoi pas un gay en talons aiguilles accroc au poppers ?) et le beauf qui a une photo de Johnny (ah beh non, ils n’ont pas de goût finalement) dédicacée sur son bureau et porte des maillots de foot (tu parles d’une grâce…). Le seul à littéralement crever l’écran, à ne pas en faire "trop", c’est Joeystarr, et parce que ce mec est déjà, a toujours été hors limites, dans l’excès.
On aurait presque envie que tous les autres dégagent pour que Polisse se concentre uniquement sur lui, son visage cassé, son histoire, son regard, ses gestes et sa présence (mais c'eut été un autre film). Du coup, le film se regarde à moitié emballé (tandis que l’autre rumine), et c’est vraiment dommage parce qu’on voudrait l’aimer en entier, Polisse, même pour ses bévues et même pour ses défauts. La fin, complètement ratée, maladroite (le montage parallèle est assez grossier), sensationnelle dans le mauvais sens du terme, vient clore le film comme si elle s’amusait à résumer celui-ci en deux minutes et en deux mots : exagéré et bancal. On a dit que Polisse secouait les tripes ; disons plus simplement qu’il provoque une bonne aérophagie propre à ravir les amateurs d’expériences molles.