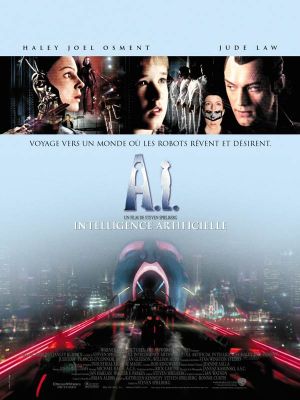Décrié par beaucoup, A.I. est l’un des plus beaux moments de cinéma qu’a pu nous offrir Steven Spielberg. Suivant le pas d’un jeune robot en quête d’amour, le cinéaste mêle son aura populaire humaniste à une sphère cette fois-ci, plus intime et mélancolique dans laquelle le précipice de la mort n’est jamais loin.
Dans un monde où les robots sont créés pour palier à des économies énergétiques, environnementales et la survie du monde moderne, David est unique. Unique en son genre parce qu’il est le premier robot à être programmé pour aimer. Non pas pour être aimé mais pour aimer, pour rendre à un couple un amour disparu que leur propre progéniture ne peut plus leur donner. Le film de Spielberg est un être schizophrène, projet désarticulé de Stanley Kubrick (qui devait initialement le réaliser) et de Steven Spielberg qui commence par de la science-fiction cérébrale, intime et sociale dans une famille en reconstruction avant de basculer brusquement dans un conte de fées déchirant évoquant Le Magicien d’Oz et surtout Pinocchio.
Au-delà du fait que le décorum visuel soit somptueux et d’une inventivité féconde, s’appropriant notre modernité contemporaine à celui de l’imaginaire d’anticipation, le cinéaste offre un véritable bijou de mise en scène qui s’attaque à la thématique du regard. Alors que l’un de ses autres films de science-fiction Minority Report se triturait les méninges avec intelligence sur le poids des images, les conséquences de nos actes, la valeur de notre pensée, A.I. différencie sa propre réalité et sa « fausseté » entre l’étroite frontière entre les humains organiques et les robots « méchas ». Mais au lieu de jouer la carte de l’esbroufe esthétique pour initier une confusion des genres, Steven Spielberg se veut plus imaginatif dans son design ou plus concis dans son dispositif de mise en scène pour que l’émotion imprègne mieux l’imaginaire du spectateur mais aussi celui des personnages.
Le réalisateur jouera beaucoup avec le cadre, les miroirs, les flous, l’espace pour agencer la plénitude du film du cinéma de genre à l’image du premier plan qui nous dévoile David : une lumière blanche aveuglante rejaillit comme si un alien allait apparaître. Suite à des problèmes liés à la jalousie du « vrai » fils du couple et à la méfiance du mari, il est rejeté par « sa mère adoptive » dans une forêt au lieu d’être détruit alors qu’il commençait à être aimé par sa « mère ». Il tentera ensuite de réconcilier ses problèmes d’abandon en cherchant la fée bleue pour devenir un « vrai petit garçon » au milieu de paysages aussi délabrés que futuristes envahis par des méchas rejetés de la même manière. La science-fiction de Steven Spielberg est humaniste mais ne perd pas de vue qu’elle existe toujours sous le prisme de la peur et du manque de l’humain.
Derrière la création, derrière ce questionnement quasi religieux qui s’insère dans l’œuvre avec puissance et justesse, il y a toujours une sorte d’alibi, une cassure chez l’humain qui le pousse à vouloir créer ou à détruire : la perte d’un fils est l’épicentre du film. Tout est lié à l’amour avec un grand A : David qui est un robot pionnier, un fils de substitution à bien des égards, ou Joe qui vit pour donner du plaisir aux femmes. Il y a cette servitude émotionnelle qui lie les humains aux robots. Mais cet amour est souvent dysfonctionnel : par cette forme de rejet, par cette peur de l’inconnu, par cet inconscient de la différence. A.I. s’érige comme une expression terriblement angoissée de rejet, de solitude et d’amour sur l’incohérence de notre monde.
Comme en témoigne toute cette séquence dans ce sanctuaire de la mort des robots, qui ressemble trait pour trait à un stade pour « bikers » dans lequel on torture et tue les méchas sous les applaudissements effrénés d’une foule en délire. Sauf que lorsque le jeune David, avec son allure de petit garçonnet, arrive sur le bûcher pour être victime de ces atrocités, le public semble perdre toute notion de réalité, sur qui est humain et qui ne l’est pas. C’est là que tient toute la force centrifuge de A.I., dans cette manière d’accompagner la croyance même aveugle de ce jeune « mécha » qui ne se pose jamais la question de sa condition, dans un monde violent dans lequel les Hommes tentent tant bien que mal d’échapper à leurs propres problèmes : la mort physique de l’humanité mais aussi et surtout, l’effondrement de leurs sentiments.
A.I. est ambitieux, personnel et révélateur, une œuvre qui parle de la souffrance sous l’égide de la naïveté. David veut devenir un enfant et seulement un enfant. C’est en s’écartant de l’habituelle quête existentialiste des robots que A.I. pousse sa profondeur dans des contrées jamais jalonnées sur la misère humaine. C’est un film sur l’enfance, qui oscille entre le béatement enfantin de Spielberg et le cynisme de la violence humaine de Kubrick, pour conforter autant qu’il désarçonne. La fin, quant à elle, a fait grincer des dents mais est d’une beauté et d’une tristesse infinie sur l’image du monde solitaire qu’est l’enfance.
Article original sur Cineseries le mag