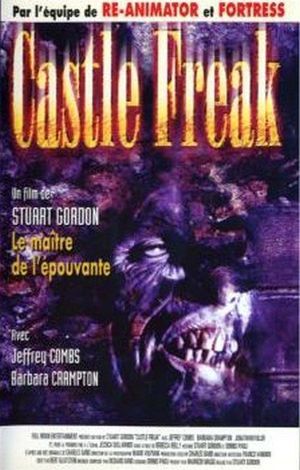L’intérêt de Castle Freak réside dans l’ambiguïté de sa créature, sorte de Quasimodo tout à la fois victime d’un sort défavorable et d’une femme qui le tourmente, et bourreau d’une famille et de son entourage, quoique cette famille disposât déjà de ses propres démons. Le monstre devient ainsi l’allégorie de la culpabilité et de la résurgence d’un passé traumatique : l’accident de voiture, l’alcoolisme du père, les accusations de la mère qui ne parvient à pardonner… Le film s’inspire de divers contes populaires, emprunte la peur du miroir à Blanche-Neige, la relation entre jeune femme et bête à La Belle et la Bête, la suspicion du père criminel à La Barbe Bleue, tout en mobilisant un imaginaire strictement italien présent dans les décors, dans les interactions constante entre Américains et la population locale, dans l’approche néoréaliste faite de plans longs, de gros plans nombreux et d’une mise en scène du désespoir que n’aurait pas reniée Pier Paolo Pasolini. La comparaison s’arrêtera là, puisque Stuart Gordon, honnête artisan et habile faiseur, ne saurait disposer de la puissance symbolique et religieuse dudit cinéaste, peinant à conférer une envergure mythologique à sa créature en dépit d’apparitions marquantes, en particulier ce saut depuis une fenêtre jusque dans la cour, qui produit bien quelques frissons.