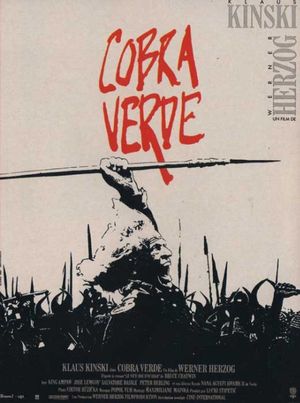Dans ce dernier opus de sa collaboration tumultueuse avec Klaus Kinski, Werner Herzog nous livre paradoxalement son film le moins maîtrisé et le plus révélateur de ses obsessions.
Le film suit Francisco Manoel da Silva, dit Cobra Verde, un bandit brésilien devenu marchand d'esclaves en Afrique. Mais au-delà de cette trame narrative, c'est surtout le portrait d'une hubris dévastatrice que dresse Herzog. La performance de Kinski, plus incontrôlable que jamais, transforme le personnage en une créature quasi mythologique, dévorée par sa propre démesure. Cette approche qui aurait pu être fascinante finit par desservir le propos : l'acteur semble tellement absorbé par sa propre folie qu'il en oublie de construire un personnage cohérent.
La mise en scène elle-même semble contaminée par cette hystérie ambiante. Si certains plans gardent la puissance visionnaire caractéristique de Herzog, l'ensemble manque cruellement de la rigueur formelle qui faisait la force d'Aguirre ou de Fitzcarraldo. Les séquences s'enchaînent de façon chaotique, comme si le réalisateur avait perdu le contrôle de son propre film - peut-être une métaphore involontaire de sa relation avec son acteur fétiche.
Le film prétend porter un regard critique sur le colonialisme et l'esclavage, mais cette ambition s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. En se focalisant exclusivement sur la figure grotesque de Cobra Verde, Herzog rate l'occasion d'une véritable réflexion sur les mécanismes de l'oppression coloniale. Les Africains restent cantonnés au rôle de figurants exotiques, reproduisant ironiquement le regard occidental qu'il prétend dénoncer.
Herzog a toujours cherché à capturer le sublime dans sa dimension la plus sauvage, mais ici cette quête tourne à vide. Les paysages africains, aussi spectaculaires soient-ils, ne parviennent jamais à transcender leur simple fonction décorative. Le réalisateur semble prisonnier de ses propres obsessions visuelles, incapable de leur insuffler un véritable sens.
Pourtant, cet échec même est fascinant en ce qu'il révèle les limites du cinéma herzogien. En poussant ses thèmes récurrents (la folie, l'hubris, la nature sauvage) jusqu'à leur point de rupture, Cobra Verde expose involontairement les failles d'une certaine conception romantique du cinéma d'auteur. La relation toxique entre Herzog et Kinski, qui atteignait ici son paroxysme, devient une métaphore parfaite de l'autodestruction artistique.