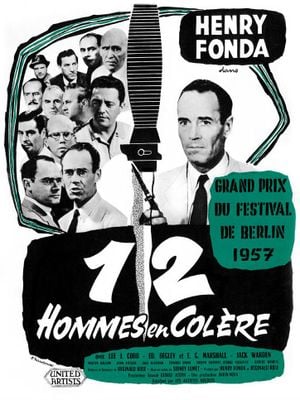Je retiens une séquence : l'un des votes, on voit les mains et seulement les mains se lever pour rentrer dans le champ. Sur la dernière (la personne qui vient de changer d'avis), la caméra descend (travelling haut-bas) pour découvrir le visage du nouveau "converti" à l'innocence de l'accusé.
Douze hommes en colère n'est pas exempt de défauts : on devine la fin du film cinq minutes après le début, et le côté "huis clos strict", avec très peu de plans hors de la salle de délibération, peut être gênant pour certains spectateurs.
Paradoxalement, ce huis clos permet à Sidney Lumet d'exprimer toute sa virtuosité. Le studio est utilisé à la perfection, avec des plans magistraux pour exposer les débats. Grâce à lui, on voit le doute se répandre peu à peu dans l'esprit des protagonistes.
L'intelligence du film est aussi de ne pas se tenir à un simple débat pour/contre : il y a des respirations, les jurés se racontant des épisodes de leur vie civile, avec la superficialité d'usage lorsqu'on a affaire à un inconnu. Les jurés émanant de la société civile, les moments de tensions vont aussi se créer, à cause des différences d'opinion, mais aussi de milieu social, de pays d'origine...
Enfin, et c'est peut être le plus désespérant, on constate qu'en 1957 comme en 2012, il vaut mieux être riche aux États-Unis pour être bien défendu. Le boulot de la défense est fait par les jurés, pas par l'avocat commis d'office...