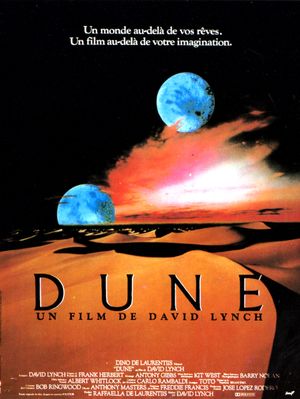Que pouvait-on espérer, après la suppression de plus de la moitié du film original, après coupes et remontages arbitraires ayant échappé à l’expertise du cinéaste ? Dune est raté, ça ne fait aucun doute. David Lynch ne veut plus en entendre parler, on le comprend. Il a demandé à ce que son nom soit supprimé du générique, a renié sa paternité, indiquant qu’un autre était le père véritable de ce rejeton bâtard, né en dehors du mariage entre un artiste et son œuvre. De ladite œuvre, il ne reste que des bribes, des poussières d’épice jetées par poignées sans directive sinon celle du rythme, de l’efficacité coûte que coûte. C’est de la poésie morcelée et qui échappe sans cesse, vole au vent : des images obsessionnelles, comme la main ouverte sur fond uni ou le regard perdu dans l’infini, rappellent qu’il y a derrière la caméra un artiste véritable, et que ce que nous avons sous les yeux n’est autre qu’un brouillon informe, incomplet. En résulte un flottement d’ensemble qui empêche les éléments de l’intrigue de se fixer ; cette volatilité constitue néanmoins une qualité, malgré elle, puisqu’elle traduit d’un point de vue formel le morcellement de l’intrigue, son éclatement spatial et temporel, la mobilité des corps propulsés dans des décors à la rencontre de la peinture, de la maquette et du numérique. Un bouillonnement artistique, en somme.
La version prévue par David Lynch était-elle supérieure ? Nous ne le saurons certainement jamais, et là n’est pas la question. Car ces quatre heures, ces cinq heures de long métrage initiales, les choix du studio, les remontages successifs, les versions alternatives, tout cela témoigne d’une chose : un monument de la littérature aussi complexe que la saga Dune ne saurait tenir dans un film. Dit autrement, le cinéma ne constitue peut-être pas le médium adéquat pour adapter la mythologie aride et complexe de Frank Herbert, que seul un tissu complexe fait de mots et de phrases semble pouvoir animer, ressuscité à chaque nouvelle lecture. Denis Villeneuve nous le dira.