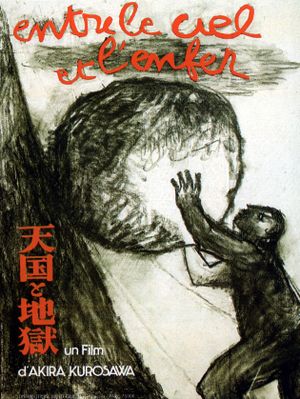Pour mesurer l'importance (subjective) d'un film, on fait la plupart du temps le bilan à la fin du visionnage, dans l'immédiat plus ou moins réduit, dans les instants qui suivent. Vite, vite, apposons une note, quand ce n'est pas déjà fait avant la fin, et éventuellement un commentaire la conditionnant. On peut aussi laisser le film infuser, passivement, de manière volontaire ou involontaire : en l'occurrence, sans l'avoir absolument cherché, ce film ne m'a pas lâché pendant les jours voire les semaines qui ont suivi.
Premier constat : il me faudra revoir Entre le ciel et l'enfer pour appréhender le film à la hauteur de ce qu'il semble proposer. J'ai le sentiment de ne pas avoir été réceptif voire attentif à l'ensemble, d'être passé à côté de points importants. Il y en a tellement… Mais tout en ayant conscience de cela, le film laisse une marque indélébile. Et ce à tous les niveaux : découpage narratif, brassage des thématiques, discours en sous-texte, composition soignée des cadres, univers graphique léché, etc. C'est tout simplement impressionnant.
Les trois temps du récit qui le découpent en trois parties homogènes mais très distinctes les unes des autres sont le moteur de la dynamique narrative : leur articulation confère au film tout son rythme. Tout d'abord, focalisation sur le personnage de Gondo, sa place au sein de l'entreprise, sa place au sein de la société japonaise, et le dilemme moral (et évolutif) auquel il sera vite confronté. Puis vient l'enquête policière sur les traces du ravisseur, laissant Gondo de côté. Et enfin un tour dans les bas-fonds des quartiers populaires, portant la morale (ou plutôt l'enseignement) du film. Ces trois parties se renforcent mutuellement, chacune d'entre elle apportant un nouvel éclairage sur les deux autres, et entraînent le film dans des directions étonnantes, réjouissantes (du point de vue de l'analyse, évidemment, pas de celui de la description des milieux sociaux...).
Il y a dans chacune de ces trois perspectives au moins un élément (visuel et thématique) extrêmement marquant.
Dans l'appartement de Gondo, c'est le poids du dilemme moral qui s'accentue alors que son fils n'est plus en danger. Un dilemme écrasant dont l'ampleur est constamment rappelée à l'écran à travers les corps des acteurs, tous prostrés, le visage fermé et tourné vers le bas, symbole d'une impuissance totale. Les regards ne se croisent presque jamais, les personnages se parlent alors qu'ils regardent dans des directions souvent opposées. Ils sont tous dans la même pièce mais semblent cependant tous murés dans leur individualité, dans leur condition, comme séparés et prisonniers de barreaux invisibles.
Lors de l'enquête policière, c'est la séquence du train, remarquable dans la gestion de la tension et de l'attention que cela suscite ensuite. Kurosawa sait aussi bien filmer la tension propre à un questionnement moral, dans toute sa lenteur et son intériorité, que celle propre à l'action la plus pure. Tout s'emballe très vite, et le film bascule soudainement du calme relatif à l'agitation absolue. Les personnages parcourent l'ensemble du train et le montage s'accélère pour former une séquence transitoire riche en suspense.
Et lorsque l'on s'embarque dans la misère des quartiers pauvres, c'est à nouveau un choc d'un autre genre. Après un épisode festif dans un bar occidental très mouvementé, empli de musiques diverses et de volonté ostensible de s'évader, celui relatif au coin des drogués n'en est que plus percutant. La part d'humanité de ces zombies au ventre (et aux veines) vide semble inexistante. Kurosawa filme des corps et des coins tous également crasseux, dans une noirceur absolue. L'apparence de l'instigateur du rapt est en outre d'une efficacité et d'une sobriété remarquables : il suffit de générer une série de reflets aussi lumineux que menaçants dans le noir de ses lunettes pour en faire une figure quasi-démoniaque. La simplicité du procédé le rend d'autant plus ingénieux.
Si l'on devait synthétiser et trouver les dénominateurs communs à ces trois axes, la volonté non pas de dénoncer mais de documenter l'impossible rapprochement entre les différentes classes sociales du Japon d'alors serait sans doute pour moi l'aspect le plus marquant. Loin de tout principe de démonstration, c'est plus sur le terrain de l'illustration allégorique que Entre le ciel et l'enfer évolue. La scène finale est à cet égard totalement dénuée d'ambiguïté : le rideau se ferme entre les deux hommes avec la même violence d'un point de vue diégétique, en excluant avec force toute possibilité de dialogue, et d'un point de vue extra-diégétique, en entérinant le caractère littéralement inconcevable de la réconciliation entre deux membres de classes opposées.
Akira Kurosawa prend également le temps et le soin de décrire les motivations des deux principaux pôles antagonistes.
Pour Gondo, cela consiste à expliciter les conditions de sa position sociale durement acquise (semble-t-il, par opposition à celle de sa femme par exemple) et tout ce qu'elle représente en termes de richesses qu'il peut perdre. Toutes les responsabilités qui accompagnent la gestion et la possession de tels volumes pécuniaires, qu'un seul homme ne saurait assumer. Toute l'humiliation, l'offense, l'insulte, voire l'outrage qu'une simple maison de luxe peut passivement générer et entretenir sur les populations qu'elle domine dans tous les sens du terme. Mais la critique ne s'arrête pas aux portes de la richesse, puisque durant les deux derniers tiers du film, le personnage de Gondo retrouvera une certaine popularité auprès de ceux-là mêmes qui l'abhorraient avec vigueur du temps de son opulence : est-ce que l'on condamne l'homme pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a ? Le fait qu'il ait été déshérité annulerait ainsi tout ce qu'il a été, de manière inconditionnelle ? On sent bien que derrière cette haine arbitraire, le retournement du jugement moral soulève beaucoup de questions autour des expressions de la richesse comme autant de signes de provocation, active ou passive, consciente ou inconsciente.
De l'autre côté, il y a le ravisseur, que l'on ne nommera même pas. Il incarne progressivement le double rigoureux de Gondo, et ce rapprochement trouvera son point culminant en termes d'intensité dramatique lors de la séquence finale. Richesse et pauvreté, exposition et dissimulation, opulence et restriction, hygiène des appartements huppés et ravages de la drogue dans les bidonvilles : tous ces reflets contradictoires finissent par s'unir et coïncider sur la vitre qui sépare les deux hommes lors de la séquence finale. Kurosawa renvoie dos à dos tout ce qu'ils représentent respectivement, mais en insistant sur ces visages qui se fondent l'un sur l'autre dans l'espace ténu qui pourtant les sépare, la relation qui les unit paraît aussi forte que tout ce qui les désunit. Et tandis que l'ensemble du film avait construit l'image d'un malfaiteur froid et calculateur, parfaitement maître de ses actes et de ses émotions, un être ivre de haine, de ressentiment et de vengeance, son impuissance nous explose à la gueule à travers un cri de douleur infinie. Une impuissance teintée de désespoir confirmant de manière définitive le gouffre qui cloisonne leurs existences, dans le fracas du rideau qui tombe. D'un côté, un homme seul face à son reflet, pétrifié dans son incompréhension. De l'autre, un homme seul face à ses démons, privé de son droit de s'abstraire de sa condition.
http://www.je-mattarde.com/index.php?post/Entre-le-ciel-et-l-enfer-d-Akira-Kurosawa-1963