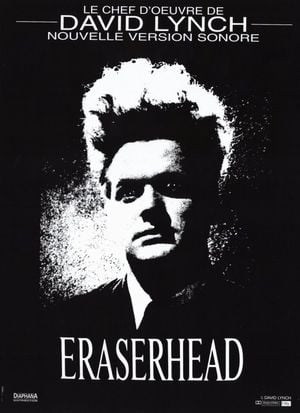Première incursion dans le cinéma grandeur nature pour David Lynch, Eraserhead s’offre au spectateur comme une virée dans des ténèbres encore insondées.
Henry Spencer, père esseulé d’une difformité prématurée, descend les marches vers un enfer de solitude. Le programme pouvait être plus léger, Lynch prend le parti-pris de pousser les curseurs de son imaginaire au plus loin que la technique à laquelle il accède le lui permet. Le body-horror, les hallucinations, les visions hors du sol planétaire et des personnages issues d’une mythologie encore inconnue se succèdent pour provoquer une issue qui transcendera la vie-même de Spencer. Dans un bain de lumière qu’on associera rapidement à une réalité assez tragique et finaliste.
Au-delà de la lutte de Spencer, abandonné de tous, c’est aussi une lutte menée par David Lynch lui-même que l’on peut déceler dans Eraserhead. Celle de l’extirpation de sa vision d’artiste vers les dimensions plus grandes du cinéma. "Eraser" signifie "une gomme" en anglais, étrange alors d’associer cet ustensile qui efface à une première oeuvre cherchant par définition à poser un quelque chose initiateur sur le papier d’une filmographie en devenir. Pourtant Lynch cherche moins ici à se départir de ses précédentes percées artistiques (quelques courts-métrages notamment) qu’à nous présenter sa table rase. Celle qui sera l’origine de ce qu’il ne pouvait anticiper, cette oeuvre qu’on lui connaît et qui est parmi les plus fascinantes du cinéma de notre époque.
Eraserhead est ainsi une oeuvre déjà lynchienne, si tant est que cela ait un sens précis, sans pour autant tutoyer des sommets qu’il se permettra de gravir avec des oeuvres comme Lost Highway, Mulholland Drive et Twin Peaks : The Return. Pourtant il ne se retient pas pour retranscrire ses visions cauchemardesques. Il tape ainsi avec violence, même trop, pour provoquer des percées qui fuiteront à nouveau dans ses prochains films. Car tout ce qu’il pourra accomplir semble déjà là dans Eraserhead. Toute sa façon de faire du cinéma, ses motifs et ses images sont concentrés dans ce petit big bang sur pellicule.
Et même si le film use d’une main appuyée pour étaler son désespoir, lui conférant une certaine frontalité dont le tour est vite opéré, Lynch parvient ainsi à se libérer de sa table rase, de ce néant qui précède tout premier film, avec une vigueur enviable, anticipant même le thème assombri d’une paternité prise au piège qui se retrouvera dans Shining sortant trois ans plus tard.
A mes dépens et en véritable impie du cinéma, je découvre ce film en ayant à peu près tout vu de ce qu’il aura fait ensuite (moins Dune). Cette concordance des choses permet tout de même de visionner Eraserhead avec en tête sa dernière image de cinéma à l’heure actuelle : le cri de « Laura Palmer » rejettant le monde dans une nuit sans fin. Une de ses premières images étant dans Eraserhead un Henri Spencer recrachant une vie prématurée. Une bouche pleine d’une naissance désespérée se voit répondre, des décennies plus tard, par une autre bouche, cette fois-ci pleine de bruit et donc de vide, juste avant que les lumières ne soient ravalées dans le noir. En espérant que la boucle ne soit pas ainsi bouclée.