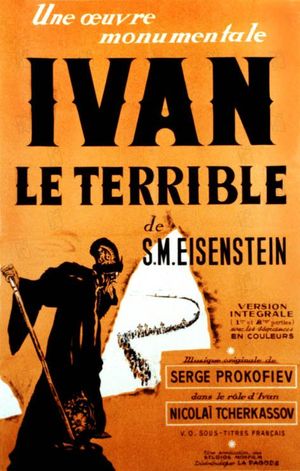On sait que quoi qu’il fasse, Eisenstein est contraint de répondre à des commandes. Ainsi de ce vaste projet d’un biopic sur Ivan le terrible, qui va certes restituer les efforts du tsar Ivan IV de Russie, à la fin du XVIème siècle, pour unifier son pays, mais surtout faire en écho le portrait de Staline. Obsédé par la grandeur de son pays, devant affronter des ennemis frontaliers et des traitres en interne, le personnage historique résonne sur bien des points avec les délires du dictateur.
Eisenstein s’attèle à la tâche, pour ce qui sera son ultime film, prévu en 3 volets, et qui sera interrompu après le deuxième.
La majesté du sujet impose un changement de ton : on ne retrouve plus le montage frénétique des débuts de sa carrière, la nerveuse restitution des mouvements populaires. Ici, le cérémonial l’emporte. Dans des intérieurs démesurés, sous des costumes fastes, accompagnés de chants grégoriens à la gravité sentencieuse, la cour des grands s’impose. Les portraits sont outrés, de la puissance du tsar aux traits retors des fêlons, les éclairages proches du conte fantastique.
Tout est ici question d’atmosphère, et de ce fait, le film est beaucoup plus lent, gagne en densité, suspendu aux décisions et aux angoisses d’un personnage à qui il incombe d’incarner une nation toute entière.
Certaines scènes d’extérieur frappent encore par leur grandeur, et confirment le talent d’Eisenstein dans le registre épique, notamment dans ces attaques de forteresses riches d’explosions et de figurants multiples, et ce splendide plan final qui voit le peuple tout entier converger vers son tsar en une file infinie dans la neige.
Mais c’est bien l’intérieur étouffant, la promiscuité trompeuse des intrigues de palais qui prime. Et sur ce point, le cinéaste atteint une nouvelle intensité, en sondant des personnages plus complexes, en proie au doute et à des enjeux trop grands pour un seul homme. Il se dégage quelque chose de profondément primitif, au sens noble du terme, dans ces portraits expressionnistes.
La dimension éminemment shakespearienne des thèmes et des passions secouant les protagonistes est patente, d’autant plus dans l’histoire d’amour entre Ivan et Anastassia que les conjurés vont s’acharner à détruire. On pense bien entendu à Othello, et la future version de Welles s’impose à la comparaison, tout comme sa version de Macbeth : de nombreux points communs unissent les films ; à commencer par leur éclat visuel, tout en contrastes, l’importance donnée à des lieux disproportionnés, ainsi que la sacralité d’un langage qui garde sa dimension théâtrale pour conforter la solennité historique du récit transcrit.
Son rapport à l’Histoire permet donc à Eisenstein de se tirer d’un mauvais pas : par son esthétique et le souffle qu’il procure à son récit, il transcende largement la commande et le spectre de la propagande. Mais son intégrité sera aussi sa perte : le deuxième volet d’Ivan le terrible sera interdit par Staline et signera la fin de la carrière du cinéaste.
(8.5/10)