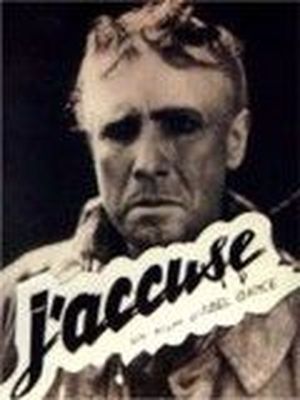J’accuse a bientôt un siècle, et l’on a du mal à croire qu’un tel film ait pu sortir un an à peine après la Grande Guerre, tant il est violemment explicite dans son engagement pacifiste. Œuvre révoltée, indignée et puissamment lyrique, elle conjugue à merveille la force du discours avec les ressorts de cet art nouveau qu’est alors le cinéma.
Organisé autour d’un triangle amoureux, le récit évoque Jean Diaz, poète à ses heures et follement aimé par sa mère, amoureux d’une femme mariée à une brute qui va se retrouver sous ses ordres au front. D’une durée de presque trois heures, le récit prend son temps pour faire dresser le portrait de ses personnages, alternant combat et permissions pour ne jamais perdre de vue ce qu’est la vraie vie, à savoir celle d’un foyer familial qui ne tend qu’à un bonheur modeste. L’évocation des fêtes villageoises du début permettent ainsi de rendre bien plus funeste l’arrivée du conflit : « En ce temps là en France, on savait encore ce qu’était la joie », annonce ainsi le carton avant de très poétiques séquences de fêtes embrumées par des fumigènes.
Les personnages ne seront jamais perdus de vue. Si Jean Diaz a tout du sain, son personnage n’écrase pas pour autant les autres. La femme qu’il aime incarne de son côté toutes les formes de victime, puisqu’elle souffre autant en tant qu’épouse que maitresse, fille d’un père patriote revanchard que mère d’un enfant issu du viol par l’ennemi. Quant au mari, sa rédemption et son amitié avec son rival en font un personnage aussi attachant que complexe.
Les cendres de la guerre sont encore chaudes, et cela se ressent dans ce témoignage. Le réalisateur utilise ainsi des images d’archives pour quelques scènes de combat (et l’annonce explicitement dans certains cartons), tout comme des extraits réels de lettres de poilus qui disent avec des mots simples toute l’absurdité barbare du conflit. Mais à cette dimension documentaire s’ajoute l’esthétique d’Abel Gance, d’un symbolisme très marqué, lorgnant souvent du côté de von Stroheim. Superposition entre l’homme et l’animal pour le caractériser, insertion d’images fantastiques de danses macabres, c’est un cinéma poétique et puissant dans ses évocations, qui exploite avec enthousiasme toute la rhétorique filmique : surimpressions, plans cuts, et même split screen lorsqu’il fait défiler conjointement les vivants et les morts dans cette hallucination visionnaire du personnage principal convoquant toutes les victimes du conflit venus demander des comptes aux vivants profiteurs de guerre.
Il est impressionnant de voir à quel point la dynamique du crescendo parvient à tenir la distance sur la longueur du film : la révolte s’épaissit à mesure que les personnages sont marqués dans leur destinée, et la folie du personnage (« le soldat avait tué en lui le poète ») se mue en un cri de colère qui s’adresse autant aux hommes qu’à Dieu sous la forme d’un soleil ayant contemplé avec indifférence le chaos. Dans un clair-obscur halluciné, la danse macabre est devenue collective, et le chant poétique diatribe nationale, voire métaphysique.
J’accuse a bientôt un siècle, et n’a rien perdu de sa vigueur : celle d’un art jeune et débordant d’énergie, celle d’un cinéma français audacieux, et d’un artiste hors norme.