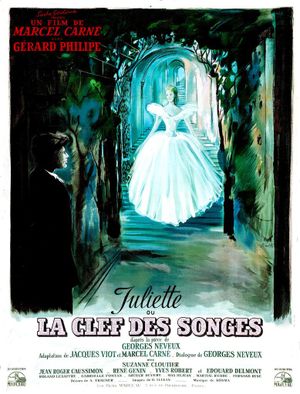Trop de couacs viennent se mettre en travers des bonnes choses, idées ou partis pris esthétiques, pour pouvoir apprécier sereinement ce que "Juliette ou la clé des songes" tente de diffuser.
D'une part, le contexte. Marcel Carné réalise ce film un an après "Orphée" et cinq après "La Belle et la bête" de Cocteau. Du premier, il semble s'être allègrement servi pour alimenter son scénario dd'une plongée dans le rêve. Et du second, il semble s'être inspiré pour tisser le voile envoûtant du fantastique qui enveloppe le récit. Mais le problème majeur, c'est qu'il ne se donne jamais les moyens (scénaristiques, principalement) pour exploiter ces deux aspects et construire une bulle dans laquelle on pourrait s'immerger. Le titre, ainsi que la façon d'amener la séquence proprement onirique, laisse peu de place au doute quant à ce qu'on observe : il n'y a pas vraiment de mystère enchanteur, c'est plus prosaïquement du domaine du conte très terre-à-terre, de manière paradoxale.
Ensuite, l'ambiance irréelle est quelque peu saccagée par un niveau global d'interprétation proche de la catastrophe. Gérard Philipe et son air de benêt, Suzanne Cloutier et son regard d'illuminée... Il y avait bien Jean-Roger Caussimon pour rehausser le niveau, avec son charisme et son élégance seyant bien à son personnage de simili Barbe Bleue, mais cette voix, cet accent... Ça bloque. La description du village dans lequel débarque le protagoniste à sa "sortie de prison" est aussi un peu ratée, comme si tous ses habitants n'étaient que des pantins vaguement similaires. Un village et une atmosphère bucoliques qui rappellent inévitablement un autre Marcel, (Pargnol), avec un court passage dans un chemin de garrigue et des accents provençaux assez caractéristiques. Et, ici encore, des bonnes idées sur le papier qui se révèlent parfaitement ridicules à l'écran (Gérard Philipe qui sautille, moment collector).
Il reste cependant les multiples explications que l'on peut formuler au sujet du sortilège dont souffrent tous les habitants, dont la mémoire semble avoir été subtilisée de manière collective. La lecture la plus tentante, évidemment, en cette année 1951 d'après-guerre, serait d'y voir une allégorie féérique du nécessaire oubli du passé. Oublier les années qui ont marqué l'Histoire récente de France pour mieux (ou tout simplement pour pouvoir) construire présent et futur. Faire abstraction de la guerre et de ses cendres encore chaudes. D'où l'étonnante apparition d'un imaginaire hors du temps dans le cinéma de Carné, qui s'était principalement construit autour d'un certain réalisme (poétique par endroits) et du temps présent. "Sommes-nous plus heureux avec ou sans mémoire ?", questionne directement un personnage du film, en donnant à voir les deux aspects, joyeux et fataliste, de la réponse. Le passage où un marchand de souvenirs (au sens propre, un joli moment) propose des bribes de mémoire artificielle à deux amoureux abonde dans une autre direction, assez pessimiste : il se pourrait bien qu'on se plaise dans un monde rêvé, fait d'illusions, aussi faux soit-il. La conclusion rejoint ce ton-là, merveilleux en apparence mais bien noir en réalité, en enfermant le protagoniste dans une prison aux barreaux définis par sa propre conscience, une fuite (abstraite) en avant qui ne le laissera jamais trouver son salut.
[AB #180]