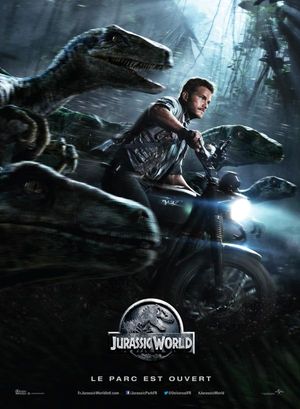Troisième suite du film de Spielberg de 1993, Jurassic World nous propose de visiter un parc d’attraction rempli de dinosaures. Sorte de zoo science fictionnelle. On ne peut s’empêcher, considérant ce scénario, de penser à une certaine forme de cinéma, le cinéma forain, celui des origines, qui d’abord se présentait comme expérience ludique. Attraction, dispositif de foire. Source d’étonnement. Images projetées, mouvantes ; vie recomposée, reconstruite.
Ainsi, on pourrait s’attendre à un jeu méta-cinématographique : public de cinéma regardant, expérimentant le dispositif filmique, face à la foule du parc testant les attractions élaborées dans le but de la divertir.
Le film se présente, soi-disant, comme métaphore de la surenchère des effets, des moyens ; faisant mine de porter sur son contenu un regard critique puisque le monstre du film est une créature génétiquement modifiée, plus grande, plus puissante. Un animal composé d’autres animaux, golem fait d’éléments disparates : L’Indominus Rex.
Le public se fatigue, son attention agacée demande toujours plus de nouveauté. Et la surenchère scientifique, la fuite en avant de l’innovation a d’incontrôlables effets. Le film serait donc un plaidoyer nostalgique en faveur d’un cinéma de moindre taille, de moindre envergure. Cinéma plus humain. Cinéma sans excroissance. Cinéma qui retrouverait son échelle, se resituerait dans un cadre plus réduit, plus raisonnable.
En somme, Jurassic World pourrait se voir comme plaidoyer en faveur du spectateur, du spectateur émerveillé. Le spectateur des années 90, disponible, peu déconcentré. Naïf. Bienveillant ? Le film développerait-il une morale des effets ? Une éthique de l’effet spécial ?
Nous voudrions croire à l’existence de cette charte cinématographique de l’effet spécial, à ce discours nostalgique sur l’importance d’un cinéma qui ne serait pas un cinéma de disproportion. Nous croyons à l’honnêteté de ces intentions pendant les trente premières minutes du film. Vues aériennes et musiques emblématiques de la série. Effet élastique. Apparition des monstres retardée. Procédé typiquement spielbergien : montrer un œil, une dent. Défaire le monstre, le fragmenter, suggérer sa présence mais lui permettre d’échapper à l’œil de la caméra.
De la sorte, la menace acquiert une existence autonome. Se réserve le moment de son surgissement. C’est le monstre potentiel ; présent mais invisible. Menace imprévisible.
Assez vite le doute s’installe. Face, d’abord, à la redondance de l’effet d’amorce qui consiste à montrer et à suivre l’hélicoptère jusqu’à ce qu’il atterrisse dans un lieu donné. Plusieurs scènes de survol se succèdent, commencent et se finissent de la même manière (accentuation de la musique et cut abrupt). Nous devinons l’embarras, le problème d’écriture. L’appel putassier à la fibre nostalgique.
Ces atermoiements trahissent l’embarras. Comment filmer l’île ? Comment en présenter, successivement, les différentes zones ? Comment montrer le parc ? Comment les personnages doivent-ils s’y déplacer ? Où les enclos, les attractions sont-ils situés les uns par rapport aux autres ?
Ces questions ne seront jamais résolues. Ainsi, la confusion géographique restera totale. Impossible de comprendre l’enjeu des course-poursuites, les zones sûres et les zones de danger. Les étapes clefs, les lieux importants. Toutes les fuites semblent confuses et vaines.
Cette confusion pourrait être volontaire, entretenue dans le but de désorienter le spectateur et de créer une atmosphère d’angoisse. Seulement, dans le premier film, l’angoisse était justement induite par l’entrée des créatures dans les zones de sécurité, l’errance des personnages dans les zones de danger. Cette délimitation étant ici illisible, l’attaque est partout pressentie et la lourdeur des effets de suspense, toujours, nous la rend prévisible.
Qui plus est, l’anxiété, dans le premier film venait du caractère furtif et fuyant du Velociraptor. Il se glissait hors du cadre, surgissait, disparaissait, se dissipait, avant de brusquement se réincarner en hurlant. C’était, par excellence, l’être éphémère et fortuit. Le monstre aux apparitions aléatoires qui fonctionnait avec la grosse masse d’énergie brute du Tyrannosaure, vecteur de destruction et de panique.
Dans Jurassic Park 3, l’insistance sur l’intelligence hors norme du Velociraptor semblait relever de l’impasse scénaristique. Comment craindre un monstre avec lequel il est possible de communiquer ? Comment craindre un monstre avec lequel il est possible de négocier ?
Ce qui suscitait l’angoisse, dans Jurassic Park, c’était les similitudes qu’on pouvait voir entre les créatures du film et les animaux des documentaires animaliers. C’était ce retournement vicieux, qui consistait à faire de l’homme, du corps humain, la proie nue d’un être mieux armé que lui. Il s’agissait que nous ressentions cet inégal partage des attributs physiques, qui donne à certains êtres des crocs et des griffes, à l’homme, un corps fragile. Rapport Epiméthéen au danger ; la proie assommée, dévorée, malmenée se trouvait être un homme, nous étions l’antilope désossée dans la savane.
La cruauté de la mise en scène se trouvait condensée dans ce principe d’humiliation, d’impuissance des corps humains.
Les dinosaures frappaient comme une force aveugle, comme une catastrophe naturelle. La peur de la souffrance motivait les proies humaines. Une fois attrapées, les victimes terminaient hurlantes avec du poison dans les yeux ; mutilés, torturés. L’Indominus Rex, lui, annihile ses adversaires. Il les révoque d’un coup de patte. Nous sommes ici bien loin des raffinements de la mise à mort spielbergienne.
Alors, les créatures tangibles, palpables, ces merveilles d’animatronique, amenaient un relief et une texture, un réalisme, qui accentuait cette ressemblance entre les images du film et l’imagerie documentaire.
Rien à voir avec les monstres intangibles de Jurassic World. Ces ectoplasmes de prédateurs. L’impression de fausseté ne vient pas tant de la qualité des effets numériques, que du fait que nous savons qu’il s’agit d’effets numériques. Dans Jurassic Park, nous devinions l’automate sous les écailles de la bête, et ce surplus de matière en renforçait la présence. Mis à part quelques rares passages, quelques rares morceaux de dinosaures robotiques, Jurassic World préfère le dinosaure informatique. La matière fausse.
Un monstre faux, un fantôme sans volonté. Le monstre, d’ailleurs, n’est plus qu’un monstre moral. Le dinosaure n’est plus cette masse aveugle et carnivore, il est devenu créature morale. Animal scénaristique dompté, chargé de punir le méchant. Ainsi, il ne représente plus pour les héros ce risque permanent d’humiliation.
Le monstre modifié, quant à lui, souffre d’un traitement psychologique qui en fait un psychopathe. Et parce que les dinosaures sains choisissent leur camp et punissent l’immoralité, le film fait parfois figure d’un slasher movie dont le malade mental serait l’Indominus Rex.
Scénaristiquement, à vrai dire, Jurassic World est asphyxié par l’existence des trois volets précédents. Cette trilogie initiale représente un bagage encombrant. Comment peut-on croire à l’évasion des dinosaures ? Comment peut-on imaginer qu’après tant d'accidents, les scientifiques, les gardiens, les actionnaires de l’île trouvent le moyen de créer, de toutes pièces, une menace plus terrible ?
Jurassic Park dénonçait, déjà, les éventuelles dérives des manipulations génétiques. Il moquait, déjà, la mégalomanie, la recherche inique du profit. Inévitablement, ce nouveau film est redondant.
Jurassic World, tel qu’il existe, n’a pas de raison d’être.