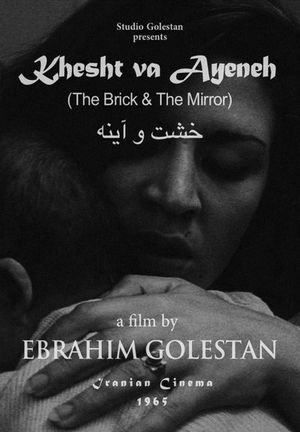Drôle d’objet d’étude, l’un des plus étranges qu’il m’ait été donné à réfléchir.
Les 14 premières minutes : quelque chose de magistral, de sublime, digne des meilleurs films de l’histoire du cinéma. Une ville plongée dans la nuit, à peine éclairée par les modernes néons en alphabet arabe et latin, puis par l’épars et mourant éclairage de quelques stands. Une voix mystérieuse émanant de la radio d’un taxi, un récit venant d’ailleurs, d’un autre temps. Un incroyable travail sur le noir et blanc qui étourdit. Une photographie de la ville égalant la grâce du Mean Streets de Scorsese.
Puis, survient l’élément déclencheur - un oubli sur la banquette du taxi qui déterminera le reste du film. D’une audace rare, à la Béla Tarr, Golestan expérimente. Un immeuble en chantier, une lente dérive dans la pénombre, l’oracle d’une vieille divaguant entre folie et vision rimbaldienne, avec le goût du bizarre à la Eraserhead de David Lynch.
Vertige du noir et blanc. Audace rare. Étourdissement causé par l’image, les angles, la mise en scène, le verbe prophétique.
Puis, le marasme complet : la fin progressive de la magie, le charme qui s’évapore, le violent poison qui se dissipe. Un imbuvable bavardage commence, qui ne s’arrêtera jamais, noyant par ses flots incessants le souvenir premier. Des scènes vaguement copiées sur / inspirées par les premiers Antonioni parsemées au milieu de dialogues d’une écriture si ridiculement maladroite qu’on se demande s’il s’agit du même « père ». Presque deux heures d’une souffrance interminable pour le spectateur.
Enfin, l’une des dernières scènes, d’une grâce soudainement retrouvée, avec cette myriade d’enfants venus d’un conte au départ grotesque devenu soudainement merveilleux.
Golestan a tourné plusieurs courts-métrages mais un seul long-métrage : brick and mirror. Tout s’explique.