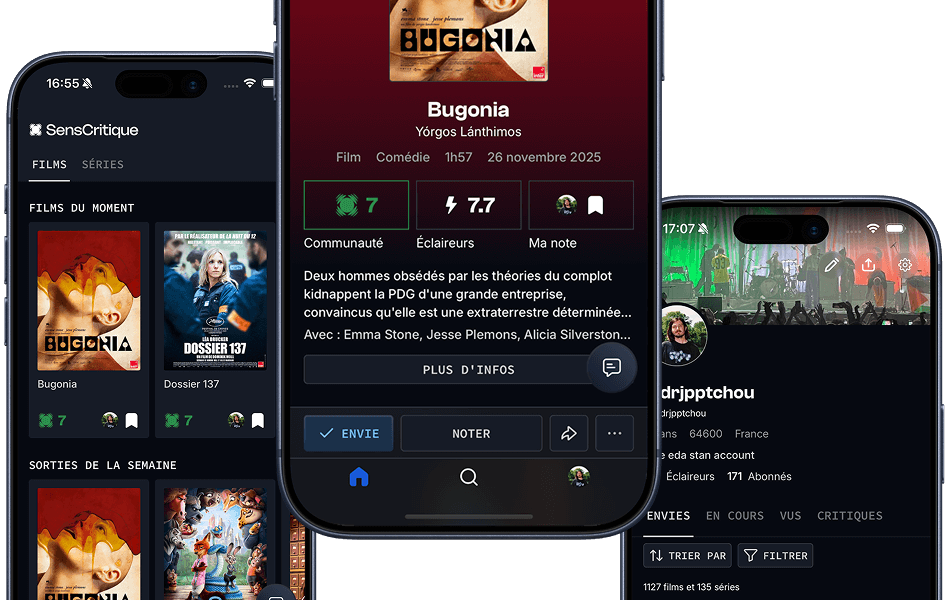André Bazin définit ainsi le sur-western : « Disons que le « sur-western » est un western qui aurait honte de n'être que lui-même et chercherait à justifier son existence par un intérêt supplémentaire : d'ordre esthétique, sociologique, moral, psychologique, politique, érotique... Bref, par quelque valeur extrinsèque au genre et qui est supposée l'enrichir ». (in Qu’est-ce que le cinéma)
A bien y réfléchir, les sur-westerns abondent, de Ford à Mann, en passant par Hawks et Wellman ; et dans cette catégorie, La colline des potences de Delmer Daves est un exemple éloquent. Toute la mythologie propre à l’Ouest s’y trouve décapée par un regard sans concession sur la nature humaine, et une noirceur propre à désactiver toute l’hagiographie que peut susciter le discours américain des origines.
Aux origines, donc, la formule sempiternelle : l’arrivée d’un nouveau venu, ici un médecin, ravagé comme il se doit par un passé qui ne passe pas, dans une ville qui pousse comme un champignon suite à la découverte d’un filon doré. On a beau monter des façades et laisser la science prendre ses quartiers, on circonscrit rapidement les sentiments qui prévalent : l’avidité, bien entendu, mais aussi un penchant pour la violence, la médisance, voire le fanatisme religieux.
La petite communauté qui s’établit sur ces terres hostiles est elle-même minée par cette ambivalence : le personnage de Gary Cooper (dans l’un de ses très grands rôles) ne peut construire sans y infuser les marbrures de son châtiment, notamment dans le lien extrêmement trouble qu’il va établir avec son second, un voleur en cavale qu’il maintient à son service par le chantage. Entre sadisme et protection, il semble incapable de reconnaître la valeur de son action, et reproduira ce schéma avec la belle, arrivée dans son cabinet brûlée vive et temporairement aveugle, martyre de la barbarie ambiante.
Alors que les liens se construisent laborieusement, l’arrivée de l’électron libre Frenchy (Karl Malden, génial, proche d’un Walach chez Leone) vient bouleverser la donne : concentrant sur sa personne presque tous les vices (avidité, violence et concupiscence), il se révèle attachant à certains moments, jusqu’à faire croire au spectateur qu’il accédera à la rédemption avant le personnage principal lui-même : un exemple supplémentaire de la façon ambiguë, c’est-à-dire profondément humaine dont les portraits sont ici caractérisés. Delmer Daves établit sa galerie de personnages avec une grande sensibilité, et esquisse des ébauches d’espoir qui rendront la noire évolution du récit d’autant plus acerbe. Le monde s’édifie, pourtant, avec une force presque unique, celle de l’argent : des concessions du médecin, de la mine d’or établie par le reste de la troupe, des sommes qui vont jusqu’à symboliser par transfert l’amour du protagoniste pour une femme qu’il a laissée partir.
Mais la mécanique tragique est imparable, et le titre n’était pas à oublier : tous les éléments étaient en place, les pions placés sur l’échiquier du pire, le prêtre fanatique, les bigotes, le libidineux ou la masse haineuse. La séquence finale, aussi épique que terrifiante, joue des conjonctions catastrophiques dans une hystérie collective et cathartique. La morale, si tant est qu’on puisse la définir comme telle, rejoint le pessimisme qu’on peut trouver chez Wellman, notamment dans L’Etrange Incident : le pire de l’homme s’y révèle avec fracas. La dernière image, particulièrement éloquente, voit cohabiter un couple devant l’arrière-plan d’un nœud coulant, et la sérénité habituelle qui sied au héros de western laisse ici place au visage défait et bouleversant de Cooper.
Depuis cette colline, aucun surplomb sur la civilisation : l’arbre transformé en potence synthétise, en une métaphore définitive le regard porté par le cinéaste sur les fondements de sa nation.
(8.5/10)