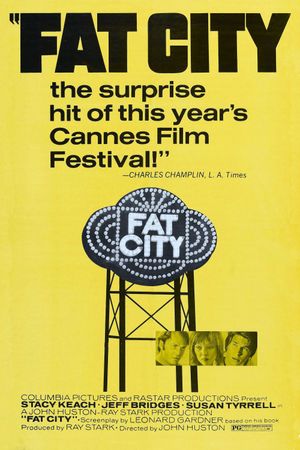John Huston est généralement reconnu comme un des créateurs du film noir. Et si le film de boxe s’est souvent imposé comme un des sous-genres représentatifs du film noir, avec des œuvres comme Nous avons gagné ce soir ou Plus dure sera la chute, c’est sur un chemin complètement différent que nous entraîne le grand réalisateur avec Fat City.
Les quelques plans qui ouvrent le film annoncent vite la couleur et justifient, au passage, le titre original de Fat City, bien meilleur que celui donné en France. Nous voici à Stockton, ville délabrée, où les seules activités semblent être celles des machines détruisant les maisons. Ici, tout est figé, les pauvres hères peuplent les rues et le seul lieu rempli de vie est le bar. Toutes les personnes que nous croiserons dans le film sont des laissés-pour-compte, les perdants, ceux qui ont été oubliés par le Rêve Américain. De toute évidence, même dans cette période où la crise n’est pas encore arrivée (le film date de 1971), l’American Dream n’est pas passé par Stockton, Californie.
De fait, vivre ici signifie bien souvent être prisonnier de l’état d’esprit de la ville. Quoi qu’ils fassent, les personnages paraissent condamnés à l’échec. Lorsque l’on est tombé aussi bas, il semble impossible de se relever. Et même si Billy ou Ernie, les deux protagonistes du film, font des efforts, le résultat est décevant. Ainsi, plus qu’une ville elle-même, Stockton représente tout un monde, celui des abandonnés, des paumés. Lucero, le boxeur mexicain qui viendra combattre Billy et qui est le seul personnage du film à ne pas venir de Stockton, est pourtant exactement dans le même modèle de ces gens qui ont tout perdu, des sans-espoirs, des sans-lendemain.
Car les personnages de La Dernière Chance n’ont pas d’avenir. Aucun d’entre eux ne parle du futur (à part peut-être Ruben, l’entraîneur, mais le futur qu’il évoque est totalement illusoire). Billy ne parle que du passé, de ses anciennes victoires, de son ancienne célébrité, de son ex-femme. Trop jeune, Ernie n’a pas vraiment de passé dont il pourrait s’enorgueillir, mais il ne songe pas à l’avenir non plus. C’est un personnage qui se laisse aller dans le flux des événements : il ne contrôle rien, ne prend aucune décision, ne fait que suivre ce qu’on lui dit. Il fait de la boxe parce que Billy le lui a dit, il se marie parce que sa chérie est enceinte… Il n’a aucune prise sur les actes qui constituent sa vie. Il ne choisit rien.
La boxe, dans ce film, va être débarrassée de tous son romantisme ou son attirail de film noir. Huston se plait à éviter tout ce qui était déjà devenu des lieux communs du genre. Pas de success story du jeune homme qui se trouve être un génie du ring qui s’ignore. Pas d’arrangements en coulisse pour qu’un joueur se couche au troisième round. Pas de bookmaker foireux. Le match, dans La Dernière chance, est la rencontre de deux paumés. Huston parvient même à éviter le manichéisme que l’on pourrait croire inhérent au genre : lors du match final (le seul match à être filmé en intégralité et en temps réel), il suffit de quelques plans sur le visage de Lucero pour que le spectateur se sente aussi proche de lui que de Billy Tully. Le cinéaste prive le combat de tout enjeu, parce que l’on comprend très vite que quel que soit le vainqueur, cela ne changera rien au destin des personnages.
Lucero est d’ailleurs présenté par la caméra comme un second Billy. Le voir avant le match, étendu sur son lit dans une chambre minable, rappelle la scène d’ouverture où nous découvrons Billy exactement dans la même position et la même situation. La scène, à la fin du match, lors de laquelle les deux combattants s’enlacent, en dit long : ils se sont reconnus.
Dans La Dernière Chance, la boxe n’est pas ce qui peut permettre aux personnages de s’en sortir. La boxe est comme tout le reste à Stockton, elle est comme la vie ici : des espoirs qui retombent, des tentatives qui se soldent par des échecs, des réussites qui ne changent rien et ne permettent pas de sortir de la triste situation, ou des échecs qui se cumulent et qu’on tente d’oublier dans l’alcool ou le sexe. Ici, tout retombe, rien ne permet de s’élever durablement. Une scène est significative : Ruben achète à Ernie une superbe tenue flamboyante pour monter sur le ring. Ernie est le futur champion, c’est certain, et il y croit lui-même. Résultat : le temps d’un plan remarquablement ironique, voilà Ernie mis K.O. en 23 secondes.
Pour ce film qui lui tient à cœur, l’ancien boxeur John Huston adopte une réalisation sobre, dénué de gros effets et visuellement très proche du documentaire. Les personnages sont filmés frontalement, pour les mettre à nu. Le choix d’acteurs alors inconnus (Jeff Bridges sortait juste de La Dernière Séance, de Peter Bogdanovitch) renforce encore l’aspect documentaire d’un film où tout semble pris sur le vif. Enfin, la chanson du film, signée Kris Kristofferson, ajoute encore plus de mélancolie et d'humanité à ce film. Elle seconde magnifiquement bien la mise en images, en particulier dans la scène de conclusion.
Car ce qui importe ici est le caractère humain du film. Huston sait rendre chaque personnage attachant. Il ne juge personne, il montre des personnages dans la détresse, qui parfois essaient de s’en sortir mais qui bien souvent retombent et restent là où ils sont. Son refus du pathos ne fait que rendre e film encore plus émouvant. La Dernière chance est bien un film social, un film de déterminisme social même. Le film s’inscrit dans la lignée des œuvres sur les paumés du Rêve Américain, après Macadam Cowboy et avant L’Epouvantail. Il est impossible d’échapper à la Fat City.
Critique originellement publiée dans LeMagDuCiné