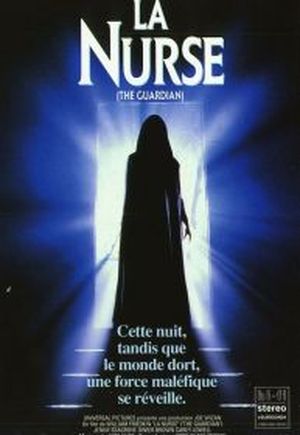Ce qui intéresse William Friedkin dans The Guardian est moins la mythologie celtique, expédiée vite fait bien fait lors d’une ouverture au kitsch explicite, que l’association permanente de la cellule familiale à la nature sauvage, une nature qui s’invite jusque dans le domicile et qui l’environne de ses forêts touffues. Une idée très simple ouvre le long métrage : lesdits « gardiens » peuvent choisir ou le bien ou le mal, suivant l’idée que tous deux sont enfantés par la nature ; le sacrifice du bébé permet ainsi une régénération de l’arbre ancestral, sorte de mémoire vive de la souffrance existentielle que duplique la nourrice, faite de la même écorce. Nous ne sommes pas loin de ce que proposera Lars von Trier avec Melancholia (2011).
En choisissant d’entrée de jeu le postulat du surnaturel, le cinéaste aborde son récit tel un conte initiatique au terme duquel les parents auront surmonté de nombreuses épreuves et enduré la précarité de la vie de leur enfant ; c’est dire que le public visé par le conte change de camp : il s’adresse aux adultes et mobilise ainsi une imagerie volontiers gore empruntant aux réussites du genre – pensons à The Evil Dead (Sam Raimi, 1981) avec sa tronçonneuse – et annonçant un Sleepy Hollow (Tim Burton, 1999), notamment pour l’arbre gothique. La montée en tension du long métrage, formidablement travaillée par Friedkin en dépit de la prévisibilité de l’ensemble, atteint à terme des fulgurances érotiques et esthétiques mémorables, comme la traque de l’architecte par une meute de coyotes ou l’ultime affrontement, tout à la fois purgatoire parental et purgation des passions par le sang.
Une réussite magistrale qui articule le fantastique, le thriller et le pulsionnel, à reconsidérer compte tenu de l’appréciation critique médiocre et des propos tenus par le cinéaste lui-même.