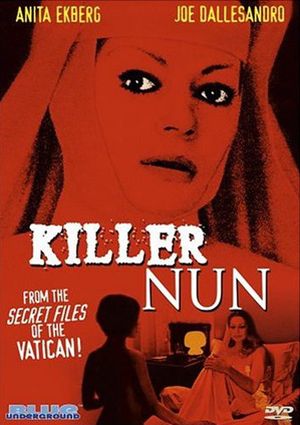Sous ses faux airs de scandale facile, flirtant avec le sacrilège obscène par une esthétique que l’on retrouve volontiers dans les films érotiques de l’époque, Suor Omicidi en revient toujours au visage tourmenté de sœur Gertrude, avec une obstination fétichiste qui traduit une attention portée à l’expression des névroses et des frustrations. Le choix d’un hôpital comme couvent de substitution inscrit d’emblée le récit dans le domaine de la psychiatrie : peuplé de patients atteints de démence, de sénilité ou d’autres situations de handicap, il permet au personnage principal de laisser libre cours à ses addictions à la morphine et au sexe. Le montage se plaît à reproduire la confusion intérieure de la bonne sœur, brouille nos repères temporels en adoptant un montage croisé et en y insérant des flashbacks tout à la fois oniriques et traumatiques, liés aux violences exercées par des hommes sur des femmes. Il n’est pas anodin que le film soit encadré par la même scène, à savoir une confession à propos de mauvaises actions passées, à la seule différence près que la religieuse a entretemps changé et que le confessionnal se soit vidé de tout prêtre chargé d’exempter la coupable ; ce passage de flambeau, doublé de la disparition symbolique du masculin, investit la vie religieuse comme une échappatoire loin des hommes et des tourments qu’ils font endurer au « sexe faible », pour lequel l’heure de la vengeance a sonné.
Néanmoins, de telles représailles n’interviennent que rarement de façon complaisante et clairvoyante, mais relèvent au contraire de l’inconscient ; preuve à l’appui, Gertrude ne garde aucun souvenir de ses crimes, et il faut lui mettre devant les yeux une pièce de tissu ensanglantée pour les lui rappeler. Le réalisateur Giulio Berruti procède par soustraction, emprunte à différents genres, y compris au giallo, pour mieux célébrer la puissance de ces femmes discréditées, jugées démoniaques afin de leur refuser le statut de malade et l’analyse de leurs maux. L’intelligence du propos ne saurait cependant rattraper longueurs et répétitions qui desservent une œuvre somme toute moyenne, bien plus intéressée par la poitrine de Paola Morra que par l’écriture de ses protagonistes.