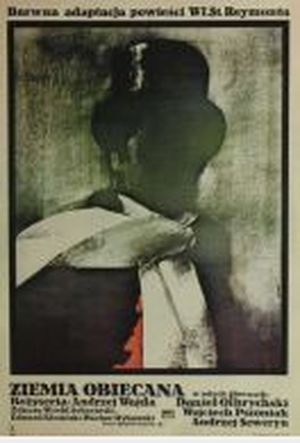On sent Andrzej Wajda comme un réalisateur révolté, ce qui n'a somme toute rien d'étonnant quand on voit qu'il est né dans l'entre deux-guerres et qu'il a pu voir de ses propres yeux l'avènement d'un monde post-WWII où les USA, à grands coups de soft power, ont su étendre la vision capitaliste sur le monde occidental. Wajda venant d'une zone naturellement hostile à l'argent-roi, il ne faut pas avoir un QI de plus de 200 pour conclure de sa méfiance constante envers cette idéologie politique. Bien entendu, cet état de fait ne date pas d'hier et c'est ce que La Terre de la grande promesse va nous raconter. Une oeuvre éminemment ambitieuse il est vrai et aussi fort longue. Longueur toutefois justifiée par un récit narrant la vie de trois jeunes hommes partant à la conquête du monde alors en pleine industrialisation. Nourris de rêves et d'espoirs, on plonge avec eux dans une ville du nom de Lodz, poussiéreuse, humide, froide et sale où à la grandiloquence des usines, véritables merveilles d'architecture austère, voient se succéder des troupeaux de prolétaires résignés, semblant avoir déjà tout perdu.
Il y a quelque chose de dérangeant qui plane dans ce film et ce n'est pas tant le sort de ces opprimés mais plutôt la radicalité de traitement qui nous frappe. Lodz est un acteur à part entière, rouillant et criant d'une voix mécanique discordante. Dans le tintamarre de ces engins de pure prouesse technologique étouffent la voix des êtres dont chaque parole est perdue dans le flot ininterrompu de biens et marchandises créés, fabriqués et vendus. Ces ouvriers n'existent pas en tant qu'homme et femme mais en tant qu'écrou de la grande machinerie capitaliste. Ils vivent dans l'usine et y meurent sans que cela ne bouleverse le moins du monde le quotidien et les horaires à respecter des patrons. C'est là où La Terre de la grande promesse met le doigt juste. Dans cet enfer moderne, le sort des travailleurs importe peu, leurs malheurs, souffrances et leur dernier souffle sont étouffés par le bruit ambiant. A plusieurs reprises, nous serons témoin du peu de considération du patronat envers leurs esclaves. Tantôt, l'un ordonnera aux autres de reprendre le travail alors que git par terre un homme dont le bras a été arraché par une machine. L'instant d'après, ce sont deux corps réduits en bouille et ce dans l'indifférence la plus totale. Rien ne nous sera dit et c'est cette distanciation morale qui fait la force du film.
Hélas, en déployant son envergure scénaristique, le long-métrage ne parvient pas toujours à offrir la fluidité que l'on attendait, devenant parfois un peu trop décousu. On a aussi un peu de mal à cerner pendant un bon moment les objectifs de l'histoire naviguant entre fiction et approche documentaire. Toutefois, le point de convergence de ces deux approches cinématographiques se concluront sur la perte des illusions et la déchéance d'un monde mort-né, aboutissant au final pessimiste que nous attendions et que nous ne verrons pas : les luttes sociales, les confrontations violentes patrons contre employés. Pas besoin de nous montrer ce que nous savons déjà. En cela, en nous montrant tout le cheminement qui se passe avant la lutte, Wajda insuffle un vent de fraîcheur dans le cinéma social.
Grâce à la restauration, vous pourrez aussi compter sur une expérience de régal visuel à part entière dans cette reconstitution très impressionnante d'une période méconnue des Occidentaux. Qui a dit que cinéma et approche historique ne faisaient pas bon ménage ?