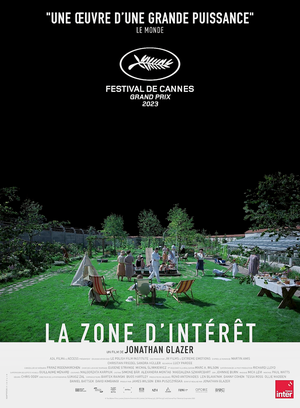The zone of interest s'ouvre sur un écran noir. D'une durée d’environ 5 minutes et accompagné par une musique particulièrement distordue et oppressante, cette ouverture annonce tout de suite l’atmosphère du film : le visionnage sera inconfortable à certains moments et l’expérience passera aussi bien par les images que par les sons.
Et ce malaise se fait ressentir dès le début. Sur les premiers plans de la maison, il est impossible de passer à côté des murs gris la jalonnant. Cette omniprésence nous fait bien comprendre qu’il y a un problème et nous met mal à l’aise. Au-delà de ça, il y a toujours quelque chose de dérangeant : que ce soit la fumée sortant des cheminées ou bien les coups de feu résonnant au loin, tout nous ramène aux camps de concentration malgré le fait que ce qu’il se passe à l’intérieur ne soit jamais montré frontalement.
Au détour de certains plans, le réalisateur prendra le temps de dépeindre l’industrialisation de la mort. Cette idée, bien que rarement évoquée, représentera une idée qui est, elle, omniprésente, c’est l’idée que le mal est banalisé. Que ce soit au détour d’une conversation entre une mère et une fille ou bien au cours d’une réunion entre commandants nazis, chaque moment montre bien cette banalisation grâce à une objectification des juifs (objectification dans le processus de mise à mort qui est industrielle ou dans le fait qu’ils ne servent que d’esclaves aux personnes habitant la maison).
Certains personnages semblent jouir de cette situation à l’instar de la mère de famille qui semble tout à fait satisfaite de la place qu’elle occupe. D’autres se rendent compte de l’horreur de la situation au fur et à mesure qu’elle nous est présentée (la grand-mère se rendant compte de l’horreur des camps, la nuit, lorsqu’elle voit la fumer s’échapper des crématoires).
Si pendant la première partie du film on nous montre presque uniquement la vie banale d’une famille allemande avec des couleurs assez joyeuses contrastant avec l’horreur de l’endroit où se déroule le film, une deuxième partie - s’ouvrant sur un fondu rouge rappelant la violence - présentera le quotidien d’Auschwitz de manière de plus en plus grise et sombre. Comme si le paradis artificiel auquel on a voulu nous faire croire tombait inévitablement en ruine.
Le personnage qui est particulièrement intéressant dans cette seconde partie est le commandant : il nous est montré comme quelqu’un qui n’a rien de vertueux et agissant surtout pour lui-même. En effet, nous remarquerons dans cette partie qu’il devient complétement mégalomane. Tout d’abord, il quitte sa famille non pas par obligation professionnelle comme il a voulu le faire croire à cette dernière mais par opportunisme (nous apprendrons ça au fil d’un entretien téléphonique). D’autre part, lors d’une conversation avec sa femme, le commandant lui confiera que lorsqu’il a aperçu une foule de gens en contrebas de lui, il n’a pas pu s’empêcher de penser aux manières de tous les gazer. Eriger comme une figure de dieu tyrannique, ce personnage semble représenter un archétype des nazis : des figures déshumanisées qui, à cause des différentes actions qu’elles doivent entreprendre, sont complètement aliéné. Cette aliénation est ce qui permet de commettre ces actes là, aussi atroces soient ils.
Malgré tous ces points, je trouve que The zone of interest n’est pas arrivé à me faire sentir le malaise autant que je l’aurai voulu. Certes, le fait de prendre le parti de ne jamais montrer l’intérieur des camps de concentration et d’avoir une caméra qui ressemble à une caméra de surveillance est quelque chose qui est intéressant et très troublant surtout au début du film. Cependant, ce procédé de mise en scène semble s’essouffler au fur et à mesure que le film avance.
Et pour conclure, une scène plus que troublante. Au détour d’un escalier que le commandant est en train de descendre (modélisation d’une descente aux enfers ?), ce dernier s’arrête pour contempler quelque chose au bout d’un long couloir. Et là, nous sommes ramenés à notre présent où l’on voit des femmes de ménages s’occuper d’un mémorial. Véritable bond entre fiction et documentaire, cette scène est difficile à saisir mais ne nous laisse pas indifférent. Cette séquence semble représenter les seules choses qui témoignent encore de ce qui s’est passé dans les camps, dernières choses qui ne sont finalement que des objets, pour nous poser une ultime question : Avons-nous seulement conscience de ce qu’ils représentent ? Et oui, toute l’horreur des camps est représentée dans ces objets mais peut-on en comprendre l’ampleur lorsque nous arpentons ces lieux ?