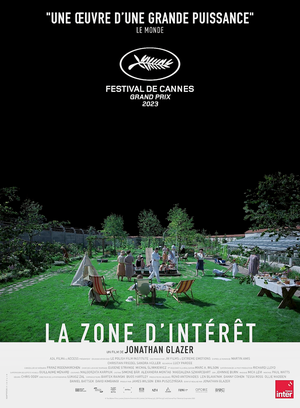La Zone d’intérêt sidère par la rapidité et la fluidité de sa mise en scène, sa richesse documentaire, son montage très court-circuité qui crée un rythme inouï. On a pu reprocher au film de camper sur un concept fort, épuisé au bout de quelques minutes : il est au contraire le geste d’un cinéaste au regard moral très affirmé, cherchant en permanence des solutions pour s’approcher au plus près de la réalité de l’extermination. C’est d’abord un film social, au sens noble du terme : comment les gens vivaient dans cette zone là ? Il ose jouer sur les temps creux de la vie heureuse des Höss, observer la structure dans laquelle vit cette famille qui accomplit "toutes les recommandations du Führer", comme le dit Hedwig dans la scène où le couple discute de la mutation de Rudolf. Et cette dimension s'incarne d'abord par la binarité de la mise en scène, très justement assumée jusqu'au bout par Glazer, qui donne à voir des espaces et des lieux en les chargeant de sens. Mère et fille discutent dans le jardin, un travelling latéral les accompagne, on parle des fleurs, on voit le mur du camp derrière, et soudain la mère parle d'une femme pour qui elle travaillait et qui est "peut-être de l'autre côté". Plus tard, assise à la table, la mère confie qu'elle est fière que sa fille ait accédé, par le nazisme, à une classe sociale supérieure.
L'horizon esthétique de Glazer n'est heureusement pas le contemplatif. En s'écartant justement à de nombreuses reprises de son fameux "dispositif", Glazer fait résonner la télé-réalité familiale avec le projet nazi, il fait des liens, ce qu'on peut attendre d'un cinéaste conséquent. Par sa durée, ses écarts, et peut-être même cette fin dont il est difficile de saisir toutes les clés, le film sort de son côté "Auschwitz comme si vous étiez" pour devenir autre chose. La bande-son n'est pas composée que de sons du camp mitoyen à la maison des Höss. On entend aussi des lettres, des rapports, des documents, reçus et envoyés par le commandant du camp, qui évoquent la bonne conduite du génocide, les mots "productivité", "efficacité", "rendement". Ce sont des projets planifiés dans les moindres détails que l'on entend, et qu'on finit par voir se construire sous nos yeux, Höss assistant à une réunion nazie où l'on discute des stratégies pour tuer plus efficacement. Ces gens vivaient et tuaient selon des plans, des plans qui communiquaient secrètement entre eux, et donc vivre à côté de la machine de mort était possible, voilà ce que le film montre. Sa froideur scientifique est son atout, sa stratégie, pour donner à penser cette communication.
Et puis, c'est un film qui ne refuse pas la beauté, il y a une harmonie des plans, un secret, un rêve même. Les poèmes de déportés qui s'inscrivent à l'écran, la fleur rouge qui devient écran monochrome, et plus globalement l’atmosphère de maison hantée qui sourd des séquences nocturnes. Les morts sont là. Refoulés jusqu’au point le plus aveugle de l’image, mais ils sont là. Höss rentre du camp, la nuit, il traverse chaque pièce, éteint les lumières, remarque sa fille prostrée près d'une fenêtre, elle paraît comme un fantôme terrifiant. Höss abuse d'une déportée dans son bureau, descend au sous-sol de la maison, dédale de couloirs labyrinthiques pour s'y laver le sexe. Höss tout le long du film marche et traverse des couloirs. Le dernier est le plus impressionnant : derrière lui, l'obscurité totale, et de l'autre côté, une brèche temporelle, et peut-être aujourd'hui, l'aujourd'hui du camp, avec ces femmes de ménage polonaise qui nettoient tous les jours les instruments de morts qu'il a inventés. Nettoyer pour rendre visible, enlever chaque trace de poussière, c'est le geste que fait le film, couvrant tous les axes, ne ratant rien de ce que produit une vie planifiée, obéissant "à toutes les recommandations du Führer".