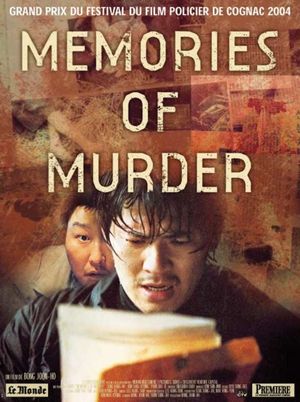Memories of Murder n'est pas simplement un polar policier, un thriller coréanisant les primes œuvres littéraires puis cinématographiques qui ont fait la renommée du genre, en passant d'Agatha Christie au Chinatown de Polanski et le travail actuel de Fincher. Bong Joon-Ho entend bien rester dans cette verve et narrer une sombre histoire de meurtre en série où se dénouent petit à petit les éléments de l'enquête, mais il ne s'arrête pas là. Ici, à la manière d'un roman naturaliste, il dresse un panorama unique, quelque peu inédit dans les salles obscures françaises, le portrait de la ruralité coréenne des années 80, archaïque et désuète. Il détourne l'axiome du thriller habituel où la ville, par sa concentration d'individus abrite les pires malfrats en opposition à l'héritage du genre pastoral qui ceint le monde agraire.
Véritable mosaïque atrabilaire, Memories of Murder nous compte l'histoire de la province de Gyunggi plongé dans la suffocation alors que des jeunes filles se font violer puis assassiner. Le film suit les pérégrinations des trois enquêteurs aux caractères hétéroclites se débattant dans la fange et la complexité de l'investigation. Cependant, il ne faudrait pas omettre les saillies quasi permanentes de l'absurde et du grotesque qui au-delà de n'être qu'un simple ressort comique pour rendre l'intrigue endurable, confèrent au cinéaste une formidable marge de manœuvre pour faire pendiller son récit, entre tension, indolence et vaudeville.
Avec une galerie de personnages, aux abords, caricaturaux, (un policier rat des champs instinctif et bourru, son antithèse citadine monolithique et réfléchi, la figure de l'idiot du village, les clins d'œil "BruceLee-esques" avec moult front kick version savate coréenne) le réalisateur se joue de nos attentes et préconceptions en offrant une vision très fine de l'âme humaine, dans ses défauts, dans ses emportements, dans une grande authenticité. En ancrant cette histoire dans le contexte social et économique concret, poisseux de cette Corée invisible, la tangibilité de l'univers est aussi poétique qu'angoissante, et nous laisse cahoter au gré des évènements.
C'est dans cette structure que l'on reconnait tout le génie du cinéaste, respectant un certain classicisme tout au long de l'œuvre pour achever nos certitudes dans la dernière demi-heure, demasquant même nos macabres divinations. Le choix d'une mise en scène plus que réaliste avec d'emblée ce plan séquence qui nous plonge in medias res dans cet univers, les plans longs qui jalonnent le film en caméra portée, sans parler des coups portés qui ne peuvent qu'être douloureux pour les acteurs impliqués. Tout respire ici l'authentique, renforçant l'aspect documentaire du métrage. Et l'imprévu, l'inexplicable, l’incompréhension jalonnent nos sociétés dont le film ne se fait que miroir.
La photographie désaturée, aux touches grises et verdâtres (où seul le rouge ressort funestement) est d'une réelle splendeur et permet de marquer la nature des scènes, jusqu'à ce dénouement final, inattendu où dans un ultime regard caméra, notre souffrance, notre impuissance jaillissent pour graver un souvenir impérissable dans notre esprit, une profonde tristesse, un vague à l’âme et la sensation unique – et ici tristement – jouissive de cinéphile d’avoir assisté à quelque chose de puissant, de juste et de plus grand que soi.