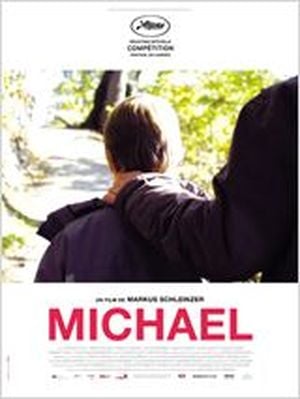« Boîte à scandale. » « Objet monstrueux. » « Caprice pervers. » Sifflé de toutes parts, soi-disant plat préparé pour Cannes, diffusé auprès d'une vingtaine de spectateurs à peine en juillet dernier, Michael subit un sort ô combien prévisible – celui du regard « inacceptable » de son réalisateur. Markus Schleinzer avance pourtant une ambition ordinaire au cinéma. « Je veux explorer la frontière entre le normal et le monstrueux. Je pense que le monstre n'est pas celui qu'on croit » a-t-il précisé avant la projection. Son titre obscur est le prénom de sa controverse, un prénom sur toutes les lèvres de ceux qui aiment à borner le cinéma. Ce n'est pas un nom menaçant, plutôt un nom de tout-le-monde. C'est celui de cet intolérable qui s'installe à l'écran, prend ses marques, gêne, hypnotise, fracasse et touche. Michael est cet employé d'assurances exemplaire, timide et peu gâté par la nature. Michael détient un enfant dans sa cave.
Du malaise instantané qu'arrache le scénario, une image posée, éteinte et routinière tisse lentement les coutures du quotidien. Une vie qu'on aurait tant aimée perturbée, traumatique n'est que jambon-purée et coucher précoce. Une déviance, disséquée sans cesse à la lumière de sévices antérieurs (pour le plus grand plaisir de la télévision), ne trouve là aucune source ni explication. Le négatif de cette existence se suffit à lui-même. Il reflète de façon admirable - pour ne pas dire clinique - la réalité. Très marqué par Michael Haneke, le film étend les plans-séquences, comme pour dissoudre la barbarie dans le temps. Mais à l'instar du réalisateur des 71 fragments, la cruauté dans Michael guette au détour de répliques tranchantes, assenées avec soin ; le temps s'enraye et impose de longues minutes d'inconfort parmi un public médusé. Cette maîtrise du regard, d'un temps haché comme un cauchemar réalise peu à peu la ruse du film : faire du spectateur le témoin consenti du malsain, le captif des images, et enfin le sujet du regard.
Car la terreur véritable qu'inspire Michael ne tient pas tant à sa photographie de l'immoral. Chaque minute en salle sonde plus profondément la raison du spectateur, qui se prend au piège du regard. S'il est bien question de montrer, chaque instant cautionne le besoin de voir. L'œil pesé du cinéaste ne capture que la normalité, teintée d'humour cruel (scène du dîner) et de scènes quasi paternelles (course de voitures) – mais son génie tient autant, si ce n'est plus, à ce qu'il cache. Entre prémices dont on sait les suites sexuelles, hors-champ anxiogènes et écrans noirs, Markus Schleinzer joue avec cet œil de cinéma où voir, montrer et cacher se confondent en un supplice extraordinaire. Lentement, le malaise d'une image se superpose au vertige d'une autre image qui ne vient pas. L'évidence est là - en inversant le processus d'observation, Schleinzer joue de la résistance et de la perversion de nos regards, délibérément rivés dans une attente virtuose. Jour après jour s'opère l'implacable mécanique qui se refermera sur les témoins. Michael transfère la charge du voyeurisme au spectateur ; l'hyperréalisme des séquences relève encore la force du procédé.
Néanmoins, cette perspective du spectateur sur lui-même, marque indélébile du film, n'est que la première étape de la décantation. Chevillée au corps de Michael (36 ans) pour les cinq derniers mois de sa cohabitation avec Wolfgang (10 ans), la caméra arrête des sentiments nettement moins avouables, au-delà de la curiosité. Parmi d'autres exemples, la scène inouïe de la veille de Noël en tête-à-tête témoigne d'un rêve malade, démesuré de Michael : celui d'être aimé de son jeune prisonnier. Sur les traces des colères, des emballements et des blessures de Michael, un risque funambulesque court dans le film de Schleinzer : celui d'une empathie contre-nature - ou plutôt contre-morale - envers Michael. Cet impensable s'avance et se délivre à mesure d'un film qui, du même pas, raffermit son dogme visuel du réel et de l'économie. Ce décalage scelle un final magistral, laissant le spectateur captivé, bouleversé, livré à sa compassion, sa révulsion - et surtout sa propre part de monstruosité.
Voir en Michael les excuses au crime, comme des remarques le soulèvent déjà, n'est définitivement pas la leçon de Schleinzer ; taire l'explication, s'il y en a une, vaut mieux que toutes les plaidoiries à charge. Plus qu'un portrait, ce premier film est un coup de génie, riche, sobre et rude à la fois. Offrant une interprétation hors du commun, l'acteur Michael Fuith ne fait qu'ajouter aux qualités de cette oeuvre rigoureuse, hors-norme. Malgré toute la force de sa gifle, Michael n'en reste pas moins terriblement sensible - et n'a sûrement pas fini de révulser.