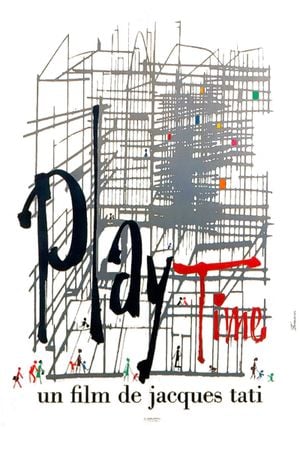Le film Playtime s'inscrit dans la mouvance du cinéma moderne français, qui se caractérise par sa quête d'une nouvelle forme de narration visuelle et sonore, éloignée des canons du cinéma classique. La période de la Nouvelle Vague, qui émerge à la fin des années 1950, est marquée par des expérimentations formelles audacieuses et un désir de rupture avec les conventions esthétiques du cinéma traditionnel. Jacques Tati, bien qu'éloigné des cinéastes du noyau dur de la Nouvelle Vague, s'inscrit pleinement dans cette dynamique de réinvention.
L'une des particularités majeures de Playtime réside dans son approche radicale de la sonorité. Tati, fidèle à sa pratique de la pantomime, privilégie une hiérarchie sonore inversée, plaçant les bruitages et ambiances sonores bien avant les dialogues, et reléguant la parole au rôle de simple effet sonore, sans véritable portée sémantique. Cette inversion de la hiérarchie sonore – où la musique et les bruitages se substituent à la parole – rapproche l’œuvre de celle de Robert Bresson, qui, de manière similaire, donne une place primordiale à l'audition et au bruit dans la construction de ses films.
Le film propose également une véritable polygraphie visuelle, où l’espace est sciemment éclaté en une multitude de plans fixes et vastes, permettant au spectateur d'embrasser simultanément plusieurs actions qui se déroulent dans des zones distinctes du cadre. La caméra, souvent immobile, capte des scènes foisonnantes dans des décors ultra-modernes. Cette approche de la mise en scène se fait à l’aide d’un format 70mm, permettant de capturer la clarté et la netteté de l’image tout en offrant au spectateur une perspective inédite sur l’environnement urbain. Tati pousse à l'extrême cette notion de surcadrage et de profondeur de champ, où chaque plan devient une véritable toile cinématographique à plusieurs dimensions.
La figure de Monsieur Hulot incarne le personnage-type du cinéma burlesque, se déplaçant à travers cet univers de béton et de verre avec une démarche décalée, toujours vêtu de son costume caractéristique : chapeau, imperméable et pipe. Hulot, en tant que personnage passif, joue le rôle de témoin d’un monde absurde, observant sans jamais interagir activement avec ce qui l’entoure. C’est un observateur silencieux des gags et situations absurdes qui jalonnent le film, allant ainsi à l’encontre des personnages d’action typiques des films classiques.
L’utilisation du gag, qui constitue un autre pilier de l’œuvre de Tati, est omniprésente. Un exemple emblématique en est celui où Hulot, dans un restaurant, continue de tenir la poignée de porte après que celle-ci se soit brisée, provoquant une série d'entrées et de sorties dans le restaurant, alors que la porte a disparu. Ce gag repose sur une perspective sonore, où la musique et les sons du film suivent les gestes de Hulot, créant une symphonie burlesque et absurde qui déjoue les attentes du spectateur.
En conclusion, Playtime est une œuvre où se rencontrent le burlesque et le cinéma moderne, où les innovations formelles et techniques se mêlent à une critique sociale acerbe. Jacques Tati, en maître de la mise en scène, transforme l'absurde en une réflexion sur la modernité et l'aliénation dans un monde hyper-technologique, créant une expérience cinématographique unique et profondément audacieuse.