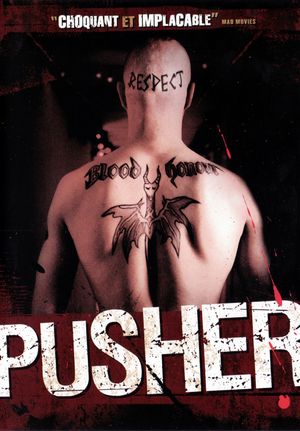Alors que son cinéma est souvent tenu pour un patchwork de Kubrick et Herzog, voir de Lynch [héritage cache-misère ou téméraires convocations formelles, c'est selon], le premier long de Winding Refn évoque plutôt Scorsese, sans que le danois marche tout à fait dans ses pas. Dans Pusher, l’illusion de toute-puissance de ces marginaux s’effrite dès l’intro : ici, non seulement le gangster idéalisé n’existe pas, mais il n’est même plus fantasmé. Succès en Europe, réellement découvert en France sur le tard avec ses deux suites, c’est un film brut, sec et ultra-réaliste proposant une plongée dans l’univers de la petite criminalité via les tribulations d’un dealer, caméra à l’épaule à l’appui.
La narration s’articule donc autour de Frank, trafiquant d’héroïne à Copenhague dont les dettes vont précipiter la chute, puisqu’après la mise en échec d’un gros coup par une intervention policière et la trahison de son ami et second, son fournisseur lui impose un ultimatum qu’il ne peut surmonter.
Frank est un pauvre type, un "raté" comme l’est son ami Tonny [Mad Nikkelsen, dans un rôle moins rentré mais exécuté avec une subtilité sans pareille]. Du monde parallèle dans lequel ils se confondent, aucune perspective ne s’offre à eux ; leur langage, trivial, degré zéro, n’est qu’une stigmate comme une autre de la platitude de leurs aspirations. Avec les lieutenants de la mafia locale, il est simulé, faux et codifié, théâtralisé à l’envie par Milo, le leader serbe.
Cette grandiloquence roturière et feinte, comme la spontanéité préservée entre les deux acolytes, confine à la stérilité et au vide existentiel. Tous les personnages de Pusher sont happés par un tourbillon absurde, évoluent résignés dans une spirale inepte. S’inscrire dans l’engrenage est devenu pour eux la fin en soi, morose et essentielle. En fait, Pusher est surtout un anti-Scarface ; là-bas l’ascension, les fastes et la décadence lyrique, ici l’abîme, irrévocable, et une noirceur hégémonique.
Pusher nous emmène ainsi dans les lieux ou on ne s’arrête jamais, sans céder à une quelconque surenchère, préférant un regard sans filtre ni fioritures donnant à la semaine de descente qu’il filme une allure quasi documentaire. L’immersion est passionnante, la vision qui la cadre simple, juste et directe.
Après avoir été débarqué des Amériques [son Inside Job, commercialement parlant, fait un four], Refn tournera deux suites à son film presque une décennie plus tard. Une fois ce coup-d’essai, coup de maître visionné, on est pressés d’avoir l’occasion de replonger, tant ce premier Pusher, humble mais sûr de lui, fait montre d’une ambition et d’une énergie fulgurantes.
http://zogarok.wordpress.com/2014/10/15/la-trilogie-pusher/