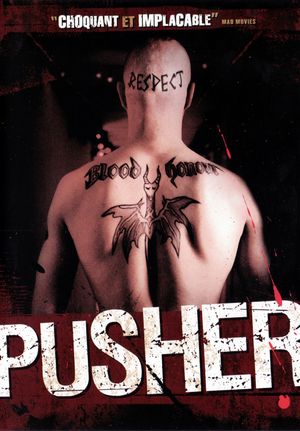Disons le tout de suite, on aura jamais vu des hommes se déchaîner à ce point pour un sachet de lactose que devant Pusher. Il est bien connu que les dealers, à force d’abuser de leur marchandise, deviennent un peu dur en affaire. Refn en profite pour exploiter ce monde de gros durs à fleur de peau en jouant sur un thème qui lui semble cher: la violence.
Il nous plonge dans cette ambiance si particulière aux films où la drogue s’écoule en masse et où les amis s’insultent, font semblant de se planter et finissent par se détacher des doigts au sécateur. Cette ambiance qui nous donne la sensation pesante que les percuteurs peuvent claquer pour une poignée de poudre. Tourné caméra à l’épaule, les visages sont capturés de prêt, on ne peut alors pas contempler la violence de manière détachée, on est totalement cousu à l’action comme si une balle perdue pouvait à tout moment sortir de l’écran pour venir se loger dans notre tête.
Rythmé par une bande son rock aux sonorités de plus en plus hard à mesure que la situation se dégrade, Refn déroule un film en deux parties mettant en scène la petite vie tranquille de Franckie, dealer légèrement endetté puis celle de Franckie, dealer dans la merde jusqu’au cou.
La décadence est intelligemment montrée: Franckie évolue sur un tapis de dettes toujours plus glissant. Les scènes de nuit se multiplient, les spots colorés des night clubs le criblent d’une lumière délatrice et la mort se cache potentiellement à chaque coin de rue.
Lundi matin, la vie était belle. Dimanche soir, son amour avec un nanoscopique “a” s’est envolé et un Fred Astaire en herbe peut à tout moment venir faire des claquettes sur son visage pendant son sommeil.
Sale semaine.