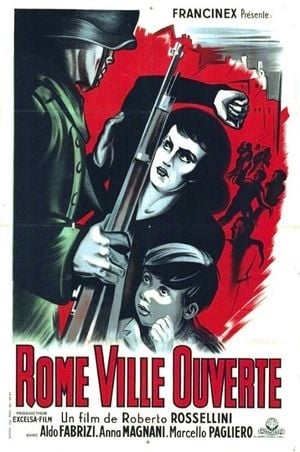Tourné dans Rome tout juste libérée alors que la guerre n’est même pas encore achevée, Rome, ville ouverte marque les débuts du fameux néo-réalisme italien, et quelques malentendus qui vont faire sa légende. Filmant dans l’urgence, avec pour ambition de donner à voir de la manière la plus authentique ce que put être la Résistance italienne, Rossellini ne met en place son esthétique (pas de son direct, aucun décor artificiel, caméra à l’épaule, peu d’éclairages artificiels…) que par nécessité, alors qu’on aura tendance à y voir une intention mûrement réfléchie, voire militante vers une évolution du cinéma qui conduira plus tard à la Nouvelle Vague.
Le film vaut surtout pour cette énergie frénétique à vouloir restituer, avant que ne disparaissent les traces, la mémoire encore brûlante d’une ville suppliciée. Et de le faire avant tout à hauteur d’individus. La galerie de portraits (la future épouse, sa sœur, le communiste, le prêtre…) est d’autant plus touchante qu’elle est modeste, et les montre en prise avec la guerre (la famine, les rafles, les bombardements) comme la vie : un projet de mariage, le jeu des enfants dans les rues…
C’est là que se joue la singularité du film : faire de la guerre un quotidien, et montrer la façon dont on cohabite avec lui : par la facilité qui vire à la collaboration (les traitres ne le font jamais par conviction, toujours par confort ou vengeance) ou l’engage dans la Résistance.
« On croyait qu’on ne verrait la guerre qu’au cinématographe », affirme un des personnages lors d’un très beau dialogue sur un pallier ; le voilà, inconsciemment, héros anonyme et clandestin, petit grain de sable dans les rouages de l’occupant, et sur lequel Rossellini décide de faire un zoom.
Cette empathie traverse tout le récit, et donne chair à ces modestes combattants qui, de temps à autre, laissent émerger la comédie si chère au cinéma italien, comme d’autres manifestations de résistance d’une certaine énergie vitale : le prêtre face à une statue de femme nue, ou un vieux qu’on assomme à coup de poêle à frire pour le faire passer pour un moribond. Autre force vive, celle des enfants, qui connaissent la ville comme leur poche et la sillonnent au profit des résistants.
La dynamique ne peut cependant occulter le danger de tels élans, dont l’un deux sera brutalement figé en pleine rue. Toute la dernière partie, vraiment éprouvante, va ainsi immobiliser l’action dans un espace scindé en trois : le salon des nazis, le sas du bureau du SS et la salle de torture dans laquelle sera interrogé le protagoniste, presque sous les yeux du prêtre. Avec une âpreté qu’on retrouvera dans L’Armée des ombres de Melville, la violence dans la durée fait son œuvre pour souligner la stature du martyre. L’humanité prend ici tout son sens : c’est l’alliance du prêtre et du communiste face à l’épreuve de la souffrance, le premier s’humanisant encore davantage face au second qui fait figure de christ supplicié, le tout face à des enfants spectateurs du mal dans sa plus pure expression.
Le néoréalisme ne milite pas sur le plan esthétique : il répond à un besoin impérieux de témoigner. Il parvient, avec une vigueur qu’on ne connaissait pas jusqu’alors au septième art, à porter un regard d’une authenticité bouleversante sur l’adversité du temps du présent et le sublime que l’homme peut atteindre face à elle.
(7.5/10)