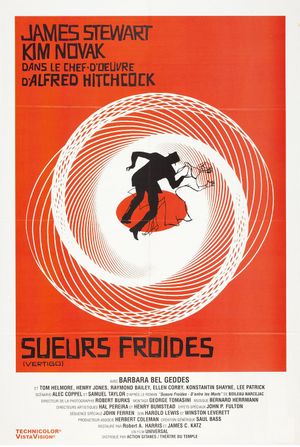On sait que "Vertigo" a désormais supplanté "Citizen Kane" au titre du "plus grand film de l'Histoire du Cinéma" décerné par la critique US : même si je préfère moi aussi le thriller dépressif d'un Hitchcock vieillissant à l'exercice de style brillant du jeune Orson Welles, il s'agit là évidemment une reconnaissance de l'effacement du rôle politique du cinéma en faveur d'une vision plus "entertainment", basée qui plus est sur les ressorts inépuisables de la psychanalyse freudienne. "Vertigo" déploie toujours aussi efficacement 55 ans plus tard les méandres de l'intrigue vénéneuse de Boileau-Narcejac, tout en déplaçant le cœur du film vers une névrose obsessionnelle qui est évidemment la sienne, celle de la possession impossible de la femme (blonde, froide, vêtue avec un mélange de rigueur et de fétichisme, comme on le sait...). La merveilleuse scène-clé qui voit Scottie, la voix brisée, interroger Judy sur la manière dont elle a été - une première fois, par un autre - transformée en Madeleine est l'une des plus émouvantes de tout le cinéma hitchcockien, et toute la douleur qui a jusque là été maintenue tant bien que mal en arrière plan explose d'une manière insoutenable. Car, si "Vertigo" est l'un des meilleurs hitchcocks, c'est qu'il conjugue de manière exceptionnelle le formalisme génial du Maître (pas une image, pas un plan qui ne soit parfaits, tant esthétiquement que par la manière dont ils servent à la fois la narration et le sous-texte "psychanalytique") et la souffrance aiguë de l'impuissance amoureuse et physique. La remarquable interprétation de Kim Novak, qui réussit à sublimer les stéréotypes de son personnage pour y glisser un désir et un désespoir inédits dans la filmographie d'Hitchcock, contribue en outre à l'enrichissement d'un film qui dépasse finalement le point de vue unilatéral d'un homme malade, pour atteindre dans ses dernières scènes la grandeur de la tragédie. [Critique écrite en 2013]