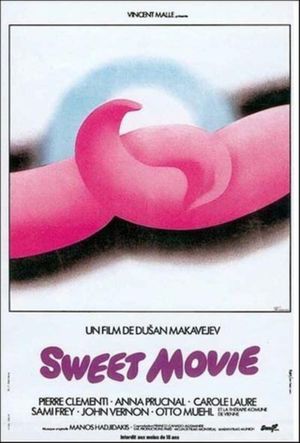Un parcours carnavalesque, halluciné, à travers les seventies hurlantes. Tout y est : la structuration idéologique du discours, l'esprit d'expérimentation, les couleurs, les formes, le son, le rire... On sort du périple éprouvé, presque à l'image Carole Laure, qui est au fond notre double filmique sublimé, sublime, consentante, complice, victime, atterrée, choquée, etc...
Ce film vaut d'abord par un certain rapport à l'image. D'abord, il y a des plans absolument magnifiques, absolument rares, qui valent à eux seuls de voir le film. L'image est à la fois extrêmement créative, non-figurative si on veut, parce que libérée de la nécessité de faire propre, de livrer un produit, et en même temps troublante parce que l'effet de réel y est terriblement fort. L'engagement physique et psychologique impressionnant des acteurs, y compris des enfants, nous dit qu'au delà du délire d'un réalisateur, il y a une époque, toute une forme sociale qui vivait selon des codes qui permettaient ces images.
Partant, le film a en quelque sorte valeur de témoignage documentaire sur cette frange extrême des années soixante-dix qui restera à jamais celle qui définit la décennie. Ce n'est pas tant l'histoire dans son propre plan narratif qui arrête l'attention, que le pur fait qu'une telle histoire s'écrive, se joue, se filme. Tout est complètement factice, si l'on veut, et pourtant il est difficile de ne pas croire que tout est littéralement vrai. On se demande : une fois qu'on a dit "coupez !", qu'est-ce qui va vraiment disparaître des éléments qui constituent l'histoire ? De ce qui nous choque ? Et c'est de ce point de vue qu'il est si naturel d'insérer les images d'archives où les cadavres de la seconde guerre mondiale (charniers staliniens ?) sont retrouvés et examinés. En un sens, Makavejev nous livre les archives des combats de son temps, les corps marqués par les révolutions des années 60. Révolutions des mouvements contestataires, de l'art, de la politique, de la psychologie, bien sûr. Révolution aussi du côté du marketing des corps et de l'art. Il nous les livre bruts, à nous de faire les théories.
Il y a ceux que ça indigne, parce que cela peut sembler gratuit, inintelligible dans le propos, et parce que, mon dieu, il y a les enfants, la gerbe, la merde... Mais j'avoue que ça me fascine totalement, cette incroyable liberté. D'autant que le propos du film n'est rien moins qu'angélique. Jusqu'au dernier plan sur le visage de l'enfant qui émerge de son body-bag, énigmatique, rien n'est montré qui ne soit au moins ambigu. On ne fait l'apologie de rien. Les formes économiques ou politiques de la guerre froide, les formes sociales, traditionnelles ou expérimentales, et les formes artistiques elles-mêmes : tout le monde en prend pour son grade, et Makavejev ne s'intéresse guère au salut. Cet enfant, mort et ressuscité, qui nous regarde immobile, c'est bien plutôt -- et bien plus tôt que chez beaucoup d'autres -- le visage de cette question : quel monde laissons-nous à ceux qui viennent ?