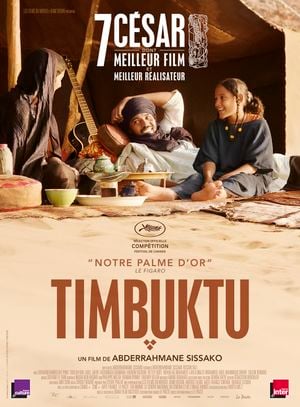Le réalisme d'un drame dans une fiction en forme de fable
Un très beau film qui malgré quelques clichés sans lourdeur traite avec intelligence et subtilité l'invasion des extrémistes islamistes au nord du Mali. Tout y est suggéré, rien n'est démontré ou alors avec une grande pudeur, ce qui fait que ce film peut être montré à tout le monde (contrairement par exemple au "12 years a slave" de Mc Queen) et en filigrane c'est une défense de la liberté d'expression artistique qui forme le propos de fond du film : la musique, la danse... Mais aussi la couleur des vêtements... Puis la liberté tout court, la liberté de se déplacer, de flâner, d'être soi-même...
Le portrait dressé parfois avec humour des djahidiste est sans caricature, sans diabolisation : ce sont des êtres humains avec leurs faiblesses, leurs frustrations qui sont dessinés, malgré l'absurdité et l'illegitimité de leurs propos et actes.
Là où McQueen aurait choisit un traitement réaliste de type documentaire, Sissako utilise les codes narratifs de la fiction, y compris les ellipses, mais aussi la poésie, l'art de l'image : la photographie est superbe, les plans cadrés comme il le faut et le choix de leur contenu chargé de sans, sans qu'on soit obligé de les surligner de dialogues explicatifs vains, car tout est là, dans l'image. Je pense à ces statues abimées par les tirs d'entrainement des djihadistes, ou encore par ce plan d'une gazelle qui court pour échapper aux même envahisseurs.
C'est la magie du cinéma africain, qui, comme celui de Souleymane Cissé ("Yeleen") ou encore celui de Ousmane Sembene ("La noire de..."), savent filmer sans dialogues inutiles, en réalisant pourtant cette prouesse de montrer que l'Afrique est une terre sur laquelle la parole est au centre de la vie sociale.