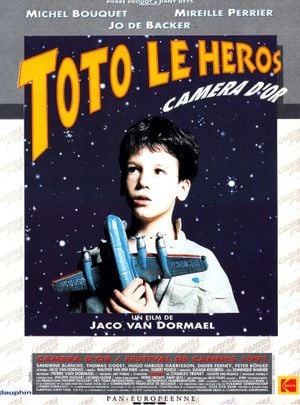Incursion dans le genre de la biographie imaginaire, guère exploité par le cinéma français, Toto le héros corrobore l’idée selon laquelle les films belges montrent une audace et surtout une ambition inhabituelles en France, où sortit, autour du même thème et à peu près à la même époque, La vie est un long fleuve tranquille. D’un côté une comédie pas antipathique avec Benoît Magimel, de l’autre un récit nettement plus entreprenant, avec Michel Bouquet : ce n’est pas faire injure au premier que d’utiliser l’expression ne pas jouer dans la même catégorie.
En présentant sa vie comme « l’histoire d’un type à qui il n’est jamais rien arrivé. Rien », Thomas Van Hasebroeck ment. Alors comment se fier à lui ? Parce qu’en réalité, Toto le héros a le mensonge et l’imagination pour thèmes principaux. De là une autre différence avec le film de Chatiliez : pour le spectateur de celui de Van Dormael, croire à l’échange des deux nouveaux-nés revient à n’accepter qu’une version. La notion de point de vue est interrogée — ce qui est logique s’agissant de cinéma, mais échappera toujours à un certain nombre de réalisateurs. Et, partant, celle de vérité. Le film ne présente qu’une esquisse d’enquête policière, mais fait enquêter ses spectateurs — rôle plus agréable que la passivité tolérée d’eux par La vie est un long fleuve tranquille.
Dans Toto le héros, Thomas âgé se rappelle Thomas jeune homme et Thomas enfant : construction d’apparence chaotique mais au terme de laquelle tout se tient — c’est même un modèle de cohérence interne, soit dit en passant. En guise de pivots pour passer d’une époque à une autre, des sons, des thèmes, des personnages secondaires ; cela dynamise le tout et rend les transitions moins forcées. Cette relative complexité de la structure narrative n’est pas gratuite : elle recoupe celle de la mémoire humaine, laquelle est un autre des thèmes du film. Mémoire qui joue des tours, mémoire à laquelle il devient risqué de se fier : c’est pourtant sur sa mémoire que le héros a fondé ce qu’il y a de plus personnel dans sa vie.
Thomas est un individu parmi d’autres, sans doute plus malheureux et malchanceux que la moyenne, mais c’est son ambivalence qui le fait sortir du lot. Comme souvent lorsqu’un homme en épargne un autre, on ne saura pas si c’est par lâcheté, cruauté, ou grandeur d’âme. Pusillanime la plupart du temps, Toto a pour son frère une générosité ferme. Qu’il s’agisse pour « le héros » de se rêver en empoisonneur d’infirmière ou en agent secret, le thème de l’imagination comme refuge remplit ici à fond sa fonction de catalyseur d’ambiguïté. (L’ambiguïté d’Alfred ou d’Alice, esquissée dans le récit mais pas forcément moins forte, se rattache aussi moins à la question de l’imagination qu’à celle de l’amour.)
De fait, à mesure que Toto le héros avance, quelque chose de tragique — au sens antique du terme —, donc quelque chose d’ambigu, se met en place. En tout cas, c’est ainsi que j’analyse les relations de Thomas et de sa sœur Alice — dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles malmènent les conventions.
À la fin du film, une voix enfantine clame « C’est fini ! » Façon de tirer un trait sur la tragédie qui a trouvé son dénouement, mais aussi de charger la fiction, jusqu’au bout, de toute son ambiguïté : un jeu de mômes chargé d’enjeux, un crucial enfantillage. Toto le héros est soit faussement simple, soit faussement complexe.
C’est probablement un film comme celui-ci que réalisera Wes Anderson quand il arrêtera de se regarder filmer.