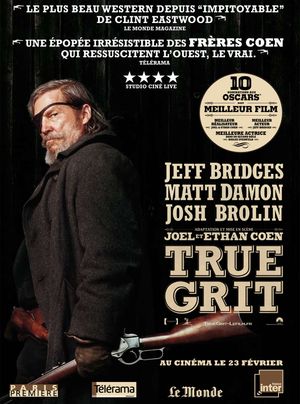True Grit n’est pas un remake du premier film éponyme, mais une nouvelle adaptation du roman original. Une certitude pour qui a lu le livre et vu les deux films, à savoir presque personne : bien qu’ils en coupent de nombreux morceaux, les frères Coen sont plus fidèles au roman de Charles Potis sur certains points, reprenant notamment sa narration à la première personne ainsi que son caractère biblique, et négligent les changements faits par Hathaway en 1969 pour apporter les leurs. Certains petits malins tirèrent quant à eux des dialogues/moments identiques entre les deux adaptations (au tribunal, ou dans la rivière) que la seconde copie ou adapte la première. À leur intention : c’est parce que ces dialogues/scènes sont repris tels quels du livre dans les deux cas…
A mes yeux, le défi majeur de la nouvelle adaptation devait être sa concurrence avec un premier film extrêmement sympathique. Wayne, après passage-coup de vent en ville, retrouvait sans plus se soucier de l’avis parasitaire des tenderfoots ou des bureaucrates une version révolue de la justice, exempte, lorsqu’il passait au-delà de la Frontier, de la paperasse juridique autant que des scrupuleux naïfs. Un personnage attachant qui ne tombait pas dans la vaine caricature d’une légende comme ça se faisait pourtant de plus en plus à l’époque. Finalement, Jeff Bridges apporte une autre interprétation du personnage, réussie par ailleurs, bien que ce soit moins ma tasse de soupe. Pour le reste, si tant le roman que le film original étaient liés à une époque transitoire (la désillusion par rapport aux vieilles légendes, de nouvelles générations naïves en quête de justice), la chose reste valable aujourd’hui, bien que l’on remarque certains glissements majeurs : à commencer par le fait que les changements observés en 1969 sont plus que consommés en 2010. C’est là que l’interprétation de Jeff Bridges est pertinente : il a remplacé ce qui n’était qu’usure et expérience d’un vieux pirate par un côté pathétique, désenchanté, qui colle mieux à notre temps. La nouvelle version de ce qui était encore légende ne l’est plus que de réputation, puisque ceux qui le connaissent de près sont mis au parfum de la rustre réalité : Jeff Bridges nous est introduit aux latrines (l’un des délicats ajouts des Coen…), son ivresse presque constante, alors qu’elle n’était que gentiment réprimée en surface par le premier film, le rend à présent ridicule. Là où John Wayne tirait encore juste sur un rongeur une cruche de bonne gueuze bien fraiche dans le bide, les frères Coen font déambuler maladroitement leur Marshall dans l’échoppe du vieil épicier pour qu’il se prenne dans les 60 saucisses suspendues au plafond, trébuche autant de fois et revienne finalement sur son point de départ sans avoir accompli quoi que ce soit si ce n’est que de perdre l’une de ses bretelles. La jeune fille d’autrefois, quant à elle, n’en est plus une, ou du moins le pense-t-elle : la petite Hailey a troqué sa jupe pour un pantalon trop grand (trop grand, j'insiste face aux interprétations féministes du film, complètement à côté de la plaque comme toujours).
Là où il ne fallait pas écrire une thèse pour saisir l’épopée du premier film, les Coen nappent le leur de dimensions religieuses à la grosse louche, ce qui a le mérite d’aller plus loin autant que le défaut de perdre en finesse. En disant s’être sentie « comme Ezéchiel dans la vallée des ossements desséchés » après une première nuit en ville (l’un des rajouts des Coen, qui ne font pas dans la subtilité pour leurs références, à la manière protestante), la Mattie d’Hailee Steinfeld, contrairement à celle de Kim Darby, démontre au public sa parfaite compréhension de ce qu’il se passe. Ou plutôt les réalisateurs nous font-ils un clin d’œil à travers elle ; l’un d’une longue série, puisqu’ils ponctuent également leur film de chants religieux et l’ouvrent sur une citation du Livre des Proverves : « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive », verset dont la seconde partie (« Le juste a l'assurance du lion ») peut être appliquée à Mattie, qui rugit plus qu’elle ne parle. Elle joue aux juges, aux dieux, pour rétablir l’ordre avant d’être à la fois rattrapée par la réalité et dépassée par ce qui lui échappe. Pour faire vite, cet élément qui lui échappe est la compassion (elle est entièrement dans ce qui est dû, incapable de faire des concessions ni de donner) ; les deux pôles sont symbolisés par deux bras chez les Coen, lesquels terminent leur film par l’une de leurs dernières références religieuses : Leaning on the everlasting arms, hymne inspiré d’un verset du Deutéronome. Ce verset du Deutéronome parle justement de la justice divine, en laquelle on peut compter et se réfugier comme dans les bras d’un père. Hold to God’s unchanging hand est un autre chant que l’on entend dans le film ; la seule certitude dans un monde changeant se trouve dans la stabilité de l’éternel. Evidemment, Mattie perd le bras qui lui permettrait d’accomplir pleinement la justice, contrairement au Marshall, qui lui, la portant dans la nuit, agit comme un envoyé divin venu la sauver de son obsession unipolaire. Vient alors le constat final : produisant un tas de cadavre au passage, elle a tenté de rattraper ce qui ne pouvait être rattrapé (le méchant qui fuit sans être poursuivi), ne parvenant pas à se venger par elle-même. Chainey s’échappe encore une fois dans la nuit bleue, à l’écran comme dans les hallucinations de la petite fille.
Comme la plupart des westerns, True Grit a donc pour enjeu la définition de la justice, ainsi que la rédemption face à la condamnation. Les frères Coen prennent leurs personnages en compassion ; s’ils en font presque toujours des imbéciles, ils ne sont jamais méchants mais sont seulement victimes de leurs absurdes ambitions (là où Dieu comme le véritable Mensch sont dans stabilité). Fargo est l’exemple parfait : il s’agit pour la justice – ou du moins le juste milieu, la modération (Frances McDormand) – d’aller dans l’inconnu, au-delà de la fin du chemin de fer si l’on veut, et d’y rencontrer à sa grande surprise une machine à transformer les cadavres en argent, de nombreux cadavres « for just a little bit of money » (i. e. absurde ambition). Le job du personnage principal du dernier Coen en date (Hail Caesar) est justement de maintenir les choses dans l’ordre face aux communistes (John Wayne approuve), comme le message d’A Serious Man était de faire face sans tomber dans le péché, comme Job. Dans True Grit, les véritables méchants conventionnels de 1969 sont remplacés par de rustres fripons victimes d’une méconnaissance de la Bible – on en prendrait presque pitié les pauvres ils n’ont pas de dentifrice. La justice menée à coup de pendaisons et de coups de feu n’en est que plus remise en question (la modération, c’est ce que préconisent toujours les Coen, à part pour eux-mêmes). Les personnages, mis à part la jeune fille, ont presque tous un passé peu glorieux derrière eux (l’un des condamnés à la pendaison en début de film le note d’ailleurs lorsqu’il proclame qu’il n’est pas fier de ce qu’il a fait mais n’a pas un passif plus noir que de nombreux membres de l’assemblée) ; il s’agit pour eux de choisir la rédemption ou de poursuivre dans le mauvais chemin. Une scène dans une cabane la nuit reprend les deux possibilités : l’un des deux brigands, qui devait avoir suivi la bande par naïveté plus que par méchanceté, sauve son âme au dernier moment (il marchera « on the streets of Glory ») alors que son compère reste pourri jusqu’au bout (« don’t be looking for Quicy » sur les « streets of Glory »). La rédemption est par ailleurs symbolisée par les « ossements desséchés » de notre ami Ezéchiel, qui symbolisent un poids mortifère (danger de mort pour Mattie lorsqu’elle tombe dans la fosse aux serpents, dont celui qui la pique se trouve dans les ossements d’un précédent cadavre) ; Dieu insuffle une nouvelle vie aux ossements dans la Bible (sortie de la fosse de retour vers la lumière du jour, puis passage par la nuit pour trouver celle d’une lanterne). Enfin, True Grit commence comme il se termine : la jeune fille arrive en ville et renvoie un cadavre par le train vers le petit cimetière en dessous de l’arbre sur la colline. Tout se rejoint merci voilà la fin ma présentation.
Il ne me reste qu’à conclure par une pensée pour Jonathan Joss, qui jouait l’indien pendu en début de film, puisque le pauvre a vu sa seule et unique tirade supprimée par les Coen (« I am ready. I have repented my sins, etc. », dans le roman comme dans le premier film), tirade qui serait pourtant rentrée dans l’idée de rédemption au centre de cette histoire et n'aurait pas fait tache au milieu des autres éléments bibliques. Pauvre Joss, c’était peut-être le rôle de sa vie.