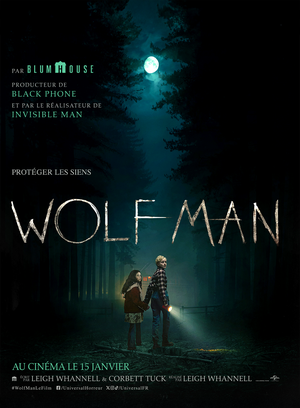Leigh Whannell poursuit son autopsie du monstrueux, explorant une nouvelle fois les failles du corps et de l’identité après Invisible Man (2020). Avec Wolf Man, il n’aborde pas seulement la lycanthropie comme un phénomène surnaturel, mais comme une déchirure intime, une contamination progressive où l’humain se défait de lui-même. Il inscrit son film dans la tradition du body horror, un cinéma de la chair altérée et de la psyché fracturée, où la transformation n’est pas seulement physique, mais existentielle.
Whannell filme cette mutation comme une fatalité génétique, un héritage impossible à fuir. La lycanthropie n’est pas une malédiction surgie d’un conte, mais une logique biologique implacable. Blake lutte contre un destin qui lui échappe, cherchant désespérément à préserver son humanité tandis que son corps et son esprit s’abandonnent à quelque chose de plus ancien, de plus primaire. L’horreur vient moins de la monstruosité elle-même que de la conscience de la perdre.
La mise en scène épouse cette descente aux enfers. La bande-son, jouant sur les distorsions auditives, amplifie la sensation d’un monde qui se dérègle. Pas de jump scares, pas d’effets faciles, mais une tension diffuse qui transforme chaque scène en une agonie silencieuse.
Si Wolf Man fascine dans sa première partie, il finit toutefois par céder aux codes du monster movie. Ce qui débutait comme une réflexion troublante sur la perte de soi glisse vers une mécanique plus convenue, où la traque et la survie prennent le pas sur la tragédie intime. Le film frôle l’excellence avant de retomber dans un schéma attendu, refermant son propos au lieu de l’étirer vers l’inconnu.
Reste une expérience sensorielle forte, un film où le corps devient le théâtre d’un combat perdu d’avance, où l’horreur ne réside pas tant dans la bête qui émerge que dans l’idée même de sa présence enfouie. Un film qui, malgré ses limites, pose cette question obsédante : et si le monstre avait toujours été là, tapi sous la peau, attendant simplement le bon moment pour surgir ?