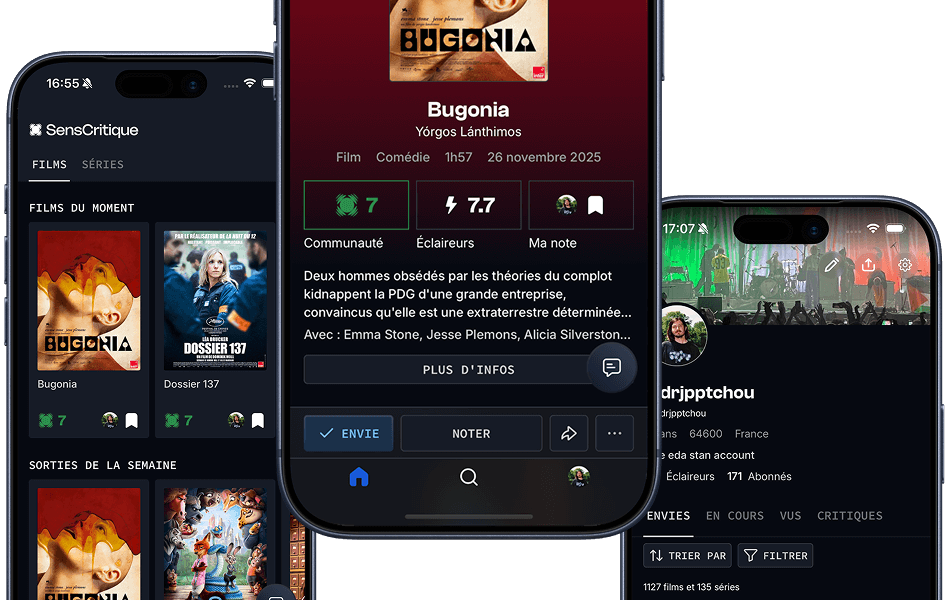Etoile-et-Champignon.fr
C-RPG se voulant dans la pure tradition des jeux de rôle papier, Disco Elysium est un jeu sans système de combat, où la progression est vécue comme une plongée dans une succession de situations lourdement dialoguées. On veut bien dire « lourdement », tant chaque moment de jeu est l’occasion de murs de textes qu’il faudra franchir tant bien que mal (en anglais uniquement) si l’on veut voir le bout de l’histoire de notre anti-héros – en une quarantaine d’heures de jeu. Ce dernier, parlons-en, est un détective au bout du rouleau qui se réveille amnésique au matin d’une cuite historique, et devra filer une double-piste : celle d’un meurtrier et de sa propre identité, perdue en même temps que son badge, son arme de service, sa voiture et, semble-t-il, sa raison.
De prime abord, l’idée d’un C-RPG tout entier résolu dans l’écriture et les dialogues est séduisante : elle rappelle les meilleures heures d’un Fallout ou d’un Planescape Torment, d’autant que Disco Elysium se présente d’abord comme un jeu visuellement splendide. La ville de Revachol et ses environs constituent un monde ouvert, sorte de hub connecté à des espaces plus petits, qui seront les divers décors de l’action : un bar-hôtel miteux, des immeubles vieillissants, des appartements tout aussi décatis, quelques commerces interlopes… D’entrée de jeu, on ne peut qu’être séduit par la joliesse générale de ce monde, composé comme un assemblage de tableaux à l’aquarelle. Les décors sont à la fois précis et impressionnistes, regorgeant de détails presque photographiques, mêlés de touches de peinture pour figurer certaines textures de façon picturale (la neige, le sang, la rouille comme autant de coulées multicolores).
L’interface est épurée et moderne, et ouvre sur un système de jeu intéressant reposant à part égale sur un système de traits, tous liés au psychisme du personnage principal, et sur l’inventaire qui fait la part belle aux costumes, ces derniers influant eux-mêmes sur nos traits psychiques. Tel chapeau augmentera d’un point l’«autorité » de notre héros, favorisant des choix autoritaires, telles lunettes amélioreront le « calcul visuel », débloquant de nouvelles pistes lors des enquêtes sur le terrain, et ainsi de suite. Les niveaux gagnés donnent des points à redistribuer dans les compétences du héros, et les costumes permettent de « tailler » un peu plus le personnage que l’on veut jouer, entre quatre grands pôles : émotionnel, physique, rationnel et psychotique. Ces choix ouvrent et ferment des options de dialogue qui s’excluent réciproquement, taillant ainsi la singularité de notre parcours : indéniablement, il y a là une belle cohérence ludique.
S’y ajoute la bonne idée de l’« inventaire » des pensées, qui se débloquent lors de situations très spécifiques et que l’on doit ensuite « équiper » (en les « internalisant ») afin de les couver un certain nombre d’heures (in-game) jusqu’à « éclosion » d’une pensée finie, qui jouera elle-même le rôle d’une pièce d’équipement mentale ajoutant bonus et malus à certaines compétences. L’idée est amusante, et laisse imaginer que le jeu pourra être une exploration vraiment consistante de la conscience diffractée de son personnage, à travers ces traits psychiques et ses dialogues intérieurs… Au final, on sort du jeu avec l’impression d’une occasion manquée sur ce point.
La gêne ressentie ne vient pas de la direction artistique, ni des systèmes de jeu, mais de l’écriture elle-même. Premier symptôme : presque aucun personnage ne parle comme il le ferait s’il était fidèle à sa condition. Excessivement bavards, ils parlent un langage trop châtié pour être le leur : on croise en effet des gamins de la balle, une prostituée, d’anciens soldats, des ouvriers syndicalistes hardcore, des teufeurs, des pêcheurs, un promoteur immobilier, on en passe… et tous ou presque parlent comme des aspirants-poètes-maudits, devisant sur l’Histoire de leur monde, la poésie, la politique (on y revient) ou la philosophie, d’une façon qui déréalise complètement leur caractère et les situations auxquelles ils prennent part.
Et puis il y a cet autre problème de la tonalité du jeu, sordide pour être sordide, que seule vient contrebalancer la direction artistique, avec ses touches de couleurs tentant de raviver un monde noyé de sinistrose. L’auteur-concepteur du jeu, Robert Kurvitz, entend manifestement dépeindre une décadence citadine et moderne à travers ces personnages et ces lieux, mais on ne comprend jamais vraiment ce dont il parle : décadence d’un pays en proie au libéralisme débridé ou, au contraire, décadence d’un communisme fraîchement déchu, au terme d’une guerre évoquée à coup d’anecdotes inutiles et usantes pour le lecteur ? Qu’est-ce qui est vraiment sinistre dans toute cette histoire, puisqu’il ne choisit jamais aucune option interprétative et se cache derrière l’argument du « jeu de rôle » (bah, c’est au joueur de choisir pardi !) ? Autre problème : comment se fait-il que l’on se sente si peu concerné par la misère côtoyée au cours de l’aventure ? Précisément, parce que les dialogues et descriptions ne la font jamais ressentir dans sa dimension tragique. Le sordide n’est ici que façade, comme une palette chromatique sur un tableau : elle est ici pour faire « joli ». Tous les thèmes abordés – décadence moderne, lutte des classes, folie du protagoniste – sont représentés, au mieux, de manière imprécise, au pire sous forme de caricature grossière, et ne sont jamais vraiment pris au sérieux. Voilà le cœur du problème : le jeu n’a pas le souci de ses personnages ni de leur sort ; in fine, PNJ et situations ne valent que comme faire-valoir d’une écriture seulement soucieuse d’elle-même et de son propre brio.
Preuve en est, les options dialoguées, bien qu’excessivement verbeuses, ne permettent que rarement de se faire une image précise des personnages rencontrés (sous couvert, peut-être de la « folie » bien pratique de son protagoniste, qui brouillerait la description qu’il nous en fait). Pire, un grand nombre de choix proposés sont empreints d’une couche de négativité et de cynisme, quand ils ne sont pas ouvertement sarcastiques et moqueurs (sur l’homosexualité d’un personnage, notamment, lors d’une scène hallucinante de bêtise, ou encore sur la pauvreté de certains personnages, présentée comme la conséquence de leurs mauvaises décisions) : aucun choix naïf ne semble vraiment pris au sérieux, aucune émotion positive, aucune affection réelle pour quiconque, aucune commisération n’est permise, on ne fait que « trancher dans le lard » de chaque situation, avec indifférence, sur fond de nihilisme adolescent et bon-teint.
Une gêne tenace vient enfin de l’inconséquence du jeu lorsqu’il se pique de politique : en usant et abusant de cynisme, il semble dire qu’il est au-dessus de toute partisanerie (pro-syndicalisme d’un côté, pro-libéralisme de l’autre), que toute les options se valent, puisque aucune ne vaut plus qu’une option dialoguée en forme de punchline ou de mot d’esprit… Il faut voir avec quelle désinvolture il aborde la « lutte des classe » comme s’il était au-dessus de tout cela, en décrivant d’un côté ses ouvriers syndicalistes comme des branquignoles ridicules et brailleurs, en caricaturant de l’autre ses personnages de riches ultra-libéraux comme des êtres de lumière planant au-dessus des contingences réelles (cf le personnage de l’ultra-riche dans le container), sans rien tirer de plus de ces représentations caricaturales qu’un « ni-ni » abscons ; il faut voir comment il dépeint son petit village de pêcheurs comme un havre de tranquillité, avec un angle-mort hallucinant dans l’écriture sur ce que devraient être les réelles conditions de vie de ses habitants si elles étaient prises au sérieux, une dureté du quotidien qui aurait pu être un moteur de récit et de quêtes positives et réellement héroïques, portées par la compassion. A la place, des addicts y devisent gaiement à la belle étoile, en nous racontant des histoires rocambolesques, une vieille ouvrière d’apparence miséreuse profite de la vie comme une bienheureuse sur son rocking-chair devant sa cabane de guingois, comme si de rien n’était : et l’on croise ce petit monde dans l’indifférence totale, l’écriture ne faisant jamais peser leur situation a priori difficile dans les dialogues.
Outre le fait qu’il est dur de croire une seconde à ce monde-là, donc de l’habiter vraiment, honnêtement, naïvement, comme il se devrait dans un « jeu de rôle », il y a quand même une indécence incroyable, de la part des scénaristes, à surfer sur ce misérabilisme ambiant, sur ses personnages et situations, sur la « folie » bien commode de son protagoniste, juste pour faire mousser leur écriture dans le registre du sordide, juste pour faire de l’épate.
Retrouvez toutes nos critiques de jeux vidéo sur Etoile et champignon.fr