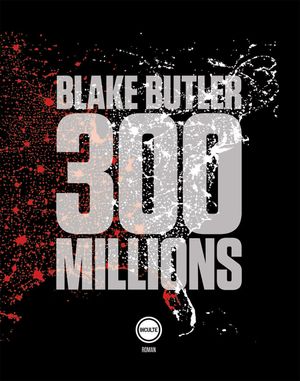Hasard de la classification, le livre de Blake Butler côtoie sur mon étagère ceux de Danielewski, Evenson et Hrivnak ; ça lui va plutôt bien. Mais en comparaison de 300 millions, la Maison des feuilles est simple à comprendre (1), la Confrérie des mutilés pas du tout macabre et le Chant de la mutilation un parangon de santé mentale.
Et puisqu’on y est, s’il fallait une matrice à ce roman, ça pourrait être Lovecraft, spécialiste ès phénomènes venus d’ailleurs, comme celui qui traverse 300 millions et fait notamment dire d’un personnage qu’« il s’autodétruira, s’entend-il dire de sa seconde voix à la troisième personne en un seul mot, d’une voix qui semble à chaque instant se retourner sur elle-même à son passage, une voix dépourvue de son mais faite de son, comme de son effacé, néant s’écoulant, désirant » (p. 191-192).
Des articles trouvés çà et là sur internet évoquent des auteurs (Denis Cooper, Pierre Guyotat, Christophe Siébert) ou des livres (2666 de Bolaño) que je n’ai pas lus. Une critique parle du roman de Butler comme d’« un piège à ours dont les mâchoires seraient la langue et l’univers », ce qui me paraît une définition tout à fait appropriée. Toutes semblent se rejoindre, explicitement ou non, sur au moins deux points : 300 millions est 1° à la limite du soutenable / du tolérable / du lisible, 2° impossible à résumer.
En l’occurrence, on peut en faire un résumé. Le tueur en série Gretch Gravey s’est mis en tête de supprimer l’intégralité de la population des États-Unis (2). Tout en recrutant et embrigadant des acolytes, il se consacre à la décoration intérieure (des miroirs partout), au rock, aux conversations intérieures avec une sorte de divinité (?) du nom de Darrel, au cannibalisme et à toutes sortes de perversions sexuelles (3). Quand la police intervient chez lui, Gravey se laisse arrêter. On retrouve au sous-sol, outre un amas de chair (4), un certain nombre de cahiers et de cassettes vidéo. Celles-ci comme ceux-là se révèlent hantés, entraînant chez qui les lit ou les regarde une folie frénétique et meurtrière tournée vers soi et vers les autres (5). D’où la réussite du projet de Gretch.
Un tel résumé appelle deux remarques. La première : on peut croire que ce n’est que le début de l’histoire, une sorte de synopsis. Mais non : tout ce que ces cinq cent cinquante pages racontent se trouve dans ces quelques lignes. La seconde : ça ressemble à un scénario de mauvais thriller qui voudrait se placer entre Seven (pour le côté vaguement ésotérique), Ring (le coup des vidéos maudites) et Martyrs (la viande crue), et qui finit généralement en troisième partie de soirée sur la grille d’une chaîne de la T.N.T.
Mais voilà, et c’est là qu’on approche de la question de l’illisible (6), 300 millions ne propose aucun regard en surplomb. Pas la moindre focalisation zéro dont on soit absolument sûr, même pas un petit coup de point de vue externe qui donnerait tous les gages de fiabilité. C’est Gretch qui prend en charge la majorité du récit – puisque ce sont ses cahiers qui sont censément retranscrits. Dès le début, un enquêteur du nom de Flood annote lesdits cahiers ; il précise : « ma retranscription élimine l’écriture particulièrement mutilée / enfantine / dégueulasse de Gretch Gravey, qui me donne de la fièvre dès que je la regarde plus de quelques minutes » (p. 15).
C’est-à-dire qu’au bout de deux pages, tu comprends qu’il ne faudra se fier à rien de ce qui est écrit. D’autant que des victimes / complices / avatars (?) de Gretch y vont aussi de leurs commentaires. Et d’autres enquêteurs, parfois en désaccord, voire en franche contradiction avec Flood. De temps en temps, on trouve même la mention « [retiré du compte rendu] », pour ne rien dire des lieux et des dates caviardés. Je crois même qu’un passage du livre reproduit un interrogatoire entre Gretch et un enquêteur mort plusieurs années avant les faits – ce qu’un certain Smith relève dans une note ; Smith est un de ceux que Flood accuse de mentir.
Pour te faire une idée de la logorrhée de Gretch, c’est-à-dire de ce qui constitue la toile de fond du roman, lis donc ceci : « Alors je voyais dans chacun une nouvelle façon de manier la couleur : je voyais que j’avais bien vécu sept vies avant le début de la mienne, comme un animal domestique, et que chaque vie au sein de la vie au sein de la vie [sic] d’avant en contenait sept également, même si au sein de chacune je ne me rappelais pas la résine des précédentes. C’était la septième vie qui faisait de nous des humains, qui nous donnait les symboles grâce auxquels nous pouvions croire que nous n’avions jamais vécu que dans le présent » (p. 19). Il y en a comme ça des pages et des pages (7). Et je ne n’insiste pas sur les passages où deux voix typographiquement distinctes alternent.
À moins qu’en fait, ce soit Darrel qui parle du début à la fin.
À moins qu’en fait, le roman soit une gigantesque métaphore d’un truc tout con.
À moins que la clé se trouve dans un passage caviardé des pages 367 et 368…
Ouais, le moment vient fatalement où 300 millions ferait passer le Jardin des délices de Bosch pour un modèle de transparence interprétative et d’épure. Et au milieu de tout cela, tu as ta place, lecteur ou lectrice en quête de sensations fortes. Pas seulement parce que c’est toujours agréable de te la péter avec de la littérature underground / postmoderne, pas seulement parce que tu dois accomplir ta part de boulot, pas seulement parce qu’à un moment tu auras peut-être mal au ventre, pas seulement parce qu’au fond tu aimes souffrir, mais simplement parce que « quelque chose dans la pièce commence à trembler. Cette pièce où vous êtes assis avec vos mains devant vous, où vous lisez. Vous ne l’entendez pas, j’ai dit que ça commençait. […] / Dans la pièce où il se trouve, Flood l’entend ; il entend le tremblement comme je l’ai entendu, bien que lui ait l’impression que c’est en lui. / Est-ce en lui. / Je crois qu’il y a quelqu’un à votre porte » (p. 201). Il y a même un moment où tu seras convié(e) à noter ton nom dans le livre.
Tu auras sans doute compris, du reste, qu’un tel brouillage / délire / amoncellement narratif est la transposition, dans le domaine de l’écriture, du thème de la prolifération contagieuse – ou de la contagion proliférante – qui, depuis la découverte du bacille de Yersin (et peut-être Dracula deux ans plus tard), non seulement fournit un thème de choix à nos fictions d’horreur, mais assure à certaines d’entre elles un modèle structurel foutrement efficace.
Qu’on se dise que Gretch Gravey assure une diffusion infinie de la lumière en couvrant de miroirs (8) l’intérieur de sa maison : prolifération, mais aussi inversion – un autre thème à l’œuvre dans le roman, quoique moins utilisé. On pense à la parodie biblique explicite de la page 224 : « il [le mot « engendrer »] se reproduit dans le processus inversé du livre que certains voient comme l’histoire de la création, mais à rebours : John désengendre Nancy désengendre Richard désengendre Tom » etc. pendant vingt lignes. On se rappelle aussi que la maison du destructeur des États-Unis s’appelle la Maison Noire, c’est-à-dire le contraire du nom de la maison de celui qui est censé les défendre.
Bref, tout se répand, que tout contamine tout dans 300 millions, ce qui en marque aussi les limites, notamment parce qu’un tel roman ne peut pas finir. À mon avis, Blake Butler le fait un peu trop durer, notamment parce que les cent cinquante dernières pages n’ont pas la densité – c’est-à-dire la richesse – des quatre cents premières. À sa place, j’aurais peut-être fini au milieu d’une phrase, ou par une bouillie de mots, ou par le langage fait de caractères inconnus qu’on trouve aux pages 365-366 et qui serait à la langue ce que la couleur tombée du ciel de Lovecraft est à l’optique.
Ceci dit, si j’avais écrit un tel roman, je serais peut-être aussi, en ce moment même, assis en tailleur sur le lit d’une chambre d’hôpital psychiatrique, à me balancer d’avant en arrière en marmonnant des trucs bizarres.
(1) Dans mes souvenirs, la Maison des feuilles s’ouvre par « Ce livre n’est pour personne ». Dans 300 millions, la phrase « Je suis inscrit en vous, et effacé. J’aimerais tant que vous posiez ce livre sur vos genoux et que vous pensiez à votre vie tant qu’il reste de la lumière. Je sais que vous ne le ferez pas » (p. 73) n’est pas censée s’adresser au lecteur, mais bon…
(2) À l’enquêteur qui lui demande « En Amérique ? Pourquoi pas dans le monde entier ? », il répond : « Quand le trou sera ouvert le reste entrera » (p. 231-232).
(3) Façon Charles Manson / David Koresh / Jeffrey Dahmer / Jim Jones / raie la / les mention(s) (in)utile(s).
(4) « Les clichés des dépouilles trouvées dans l’espace sous la maison sont pratiquement impossibles à regarder, car elles ressemblent davantage à des œuvres abstraites qu’à des cadavres. Le niveau d’amputation et de démembrement en est presque artistique » (p. 116). C’est Flood (un enquêteur sur lequel je reviendrai) qui parle.
(5) Dit en langage Butler : « De multiples corps employés aux procédures d’incarcération relatives à Gravey se tuent en l’espace de quelques heures. » (p. 183). Dit encore autrement : « Quatre mères de plus tuent quatre amis de plus. Quatre amis des personnes tuées tuent à leur tour quatre personnes qui elles-mêmes en tuent quatre chacune. Quatre relations de chaque victime de Gretch Gravey tuent quatre personnes de plus, et chacune des quatre personnes tuées par la mère tue quatre personnes de plus » (p. 243). Ça ressemble au problème mathématique du nénuphar, je te laisse faire la mise en équation.
(6) C’est chiant, hein, ces notes de bas de page ? Mais promis, cher lecteur ou chère lectrice à la patience d’ange, c’est dix fois moins éprouvant qu’une section de 300 millions. Promis aussi, j’arrête à la fin de l’autre échantillon qui suit : « chaque instant correspond continuellement à tout souvenir des heures passées qui corroborerait suffisamment la sensation du jour et de la force pour au moins persister, tout en se transformant rapidement en versions futures sans déranger la portion de la personne qui s’y raccroche mais avec une impression de vite écrasant que tout le monde trouverait pratiquement impossible à décrire » (p. 453).
(7) Quand je lis ça, je me dis aussi qu’il a fallu traduire, et je tire mon chapeau à Charles Recoursé. (Oui, j’avais promis d’arrêter, mais quand je te disais qu’il ne faut se fier à personne avec 300 millions…)
(8) Les doubles du miroir, dans le roman, ne seraient pas d’autres miroirs, mais les cassettes vidéo. Mais à la différence des miroirs, celles-ci semblent comporter un entre-deux, qui n’est ni la réalité, ni l’enregistrement, mais quelque chose comme des limbes, dans lesquelles il est aisé de se perdre. (Promis, cette fois j’arrête vraiment !)