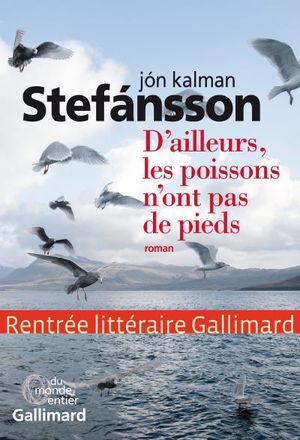Ari rentre chez lui. Il retourne à Keflavik, son village d’enfance, après un exil au Danemark. Keflavik, terre de pêcheurs, où « nulle part ailleurs en Islande, les gens ne vivent aussi près de la mort ». Un endroit qui ne compte que trois points cardinaux : le vent, la mer et l’éternité, et que le président islandais qualifia lui-même « d’endroit le plus noir du pays ». Un endroit où cet éditeur de poésie et de guides de développement personnel va retrouver son père mourant.
Le récit croise trois époques. Le présent d’Ari, sa jeunesse dans les années 80 et le début du vingtième siècle, lorsque ses grands parents Oddur et Margret se sont rencontrés. Le Ari d’aujourd’hui est seul depuis une séparation douloureuse avec sa femme. Il ne voit plus ses enfants et se démène dans une solitude pesante. Le jeune adulte qu’il était à 16-17 ans, maladivement timide avec les filles, a beaucoup souffert des moqueries des collègues qu’il fréquentait alors dans l’usine de poissons où il gagna ses premiers salaires. Quand à ses grands-parents, ils incarnaient une famille typique de pêcheurs à l’aube de la modernisation du pays.
C’est un fait, je dois reconnaître que ce roman n’atteint pas les sommets du fabuleux « La tristesse des anges », qui restera pour moi un chef d’œuvre absolu. Peut-être parce qu’il y a ici trop de passages ancrés dans la réalité actuelle de l’Islande, ses problèmes socio-économiques et la corruption de sa classe politique. Peut-être aussi à cause de la personnalité d’Ari qui, malgré ses nombreuses interrogations existentielles, n’est jamais parvenu à attirer ma sympathie. En fait, j’ai largement préféré les chapitres concernant Oddur et Margret, y retrouvant, comme dans La lettre à Helga, l’ambiance envoûtante d’un pays encore loin de toute forme de modernité. Et puis comment ne pas craquer devant leur première fois : « Elle lui dit : si je dénoue mes cheveux, alors tu sauras que je suis nue sous ma robe, alors tu sauras que je t’aime. Il parvient tout juste à hocher la tête. Attend, parfaitement immobile. Puis elle libère ses cheveux. »
Mais en dehors de ces quelques bémols, c’est un livre que j’ai envie de défendre, parce qu’il est beau, qu’il parle de la condition humaine et s’adresse donc, à un degré ou un autre, à chacun de nous. Parce que Stefansson dit la vie, la mort, l’amour, le désir ou l’art comme personne. Parce qu’il aime montrer des personnages perdus et en quête de sens. Parce qu’il allie une certaine forme de poésie avec un réalisme parfois cru et d’une banalité confondante, dans une prose à la grâce fabuleuse. Parce que son Islande est âpre, rude, balayée par les vents, aussi hostile que fascinante. Parce que ses réflexions sur le temps qui passe et lamine tout sur son chemin me bouleversent profondément. Parce que la traduction d’Éric Boury est une fois de plus d’une qualité exceptionnelle et tout simplement parce que cette chronique familiale est pour moi un grand livre, ni plus ni moins.