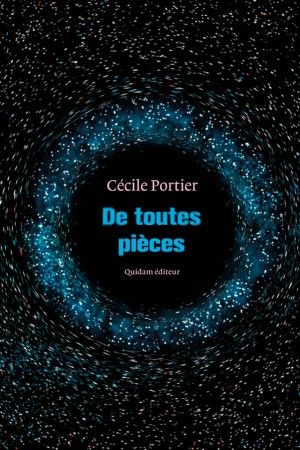Un homme est chargé par des commanditaires invisibles et anonymes de constituer un luxueux cabinet de curiosités. Il a peu de temps mais de l’argent, des moyens apparemment illimités pour cette entreprise. «De toutes pièces» est le journal de cet homme, au fil des quatre saisons de cette « aventure » ; il raconte l’assemblage obsessionnel de cette collection, projet visant à la perfection formelle et qui, d’une saison à l’autre, se fissure et se détraque.
En exergue à ce deuxième roman vertigineux de Cécile Portier, paru en septembre 2018 chez Quidam éditeur, est inscrite cette citation d’Elfriede Jelinek : « Voici que le langage en personne veut se mettre à parler. » On entre dans le roman par les objets, merveilleusement décrits, avec la précision maniaque d’un obsessionnel et l’œil d’un amoureux des belles choses. Empreint d’humour et d’une beauté paradoxale, le récit débute un 28 décembre (jour du massacre des Saints Innocents) par l’entrée dans la collection d’un ornithorynque empaillé, « un pondeur d’œufs à mamelles, une bête à poils et à pieds palmés », curiosité de la nature comme du langage, établissant d’emblée combien dans ce roman propos et forme se nourrissent mutuellement, interrogeant le rapport entre les choses et le langage, en écho à «Œuvres» d’Édouard Levé ou au «Parti-pris des choses» de Francis Ponge.
La poétique de cette accumulation foisonnante du bizarre et du merveilleux, dans une écriture performative, pourrait suffire à notre plaisir de lecteur mais Cécile Portier compose aussi avec ce roman une satire subtilement féroce sur le pouvoir corrosif et inhumain de l’argent et du néolibéralisme.
« 9 janvier
Savoir ce qu’on fait : un fatras agencé au millimètre près, avec dedans un paravent peint d’oiseaux, des bêtes à poil et à griffes, dont une loutre, pour la beauté enfin stoppée, réalisée, de sa nage, et des bocaux sur des étagères scellées dans de la menuiserie sombre aux mécanismes d’ouverture plus subtils que compliqués, s’offrant seulement aux doigts fins. Des surprises, des terreurs, des onguents, des mèches de cheveux de concubines d’un harem, type Angélique Marquise des Anges. Des planches d’anatomie exclusivement consacrées aux organes sensoriels et à leur raccordement au système nerveux central, et ainsi, une meilleure compréhension des envies de saccage. C’est une délectation un peu malsaine, très fin de siècle : le fruit de beaucoup de détournements, de toutes les concentrations décadentes du pouvoir et de l’argent. Plus, un tatou, recroquevillé sur le montant final des enchères du tout. »
Composant une collection de tous les superlatifs pour des commanditaires anonymes, espérant lui-même en retirer un gain substantiel, le narrateur forme l’archétype d’un mercenaire de l’accaparement pour les compte des ultra-riches, en bel écho à Mike Davis. Pendant la première saison, puisqu’il a carte blanche, il jouit de sa puissance de démiurge pour façonner un lieu de satisfaction égoïste et solitaire, imaginer l’installation « des objets les plus sacrés ou les plus obscènes » dans les alcôves de cette collection, car l’obscène et le sublime se rejoignent dans le retrait de l’exceptionnel aux yeux du monde, au profit de la jouissance exclusive de quelques-uns.
Dans ce fatras agencé au millimètre près viennent se côtoyer, au fil des acquisitions, un ornithorynque empaillé, deux fœtus de sœurs siamoises dans un bocal rond, le squelette d’une chauve-souris de Bornéo en plein envol, la photographie post-mortem très ancienne d’une toute petite fille, un cil prélevé sur le cadavre de Marilyn Monroe ou encore une oreille coupée coulée dans le béton… venant souligner, en une muséification morbide, une forme de délectation malsaine de l’accaparement et les premières traces de la folie du curateur.
Et soudainement et sans explication, le processus se grippe de manière kafkaïenne, entrant en friction avec un réel déshumanisé et très contemporain, lorsque le curateur se retrouve « stocké » avec sa collection dans un hangar près de Thionville et non au Luxembourg comme il l’avait prévu, non dans un paradis fiscal mais dans une ZAC frontalière et sinistre. Recevant les consignes de ses commanditaires par l’intermédiaire d’une interface web, en butte à leurs questions inquisitrices puis à leur indifférence, il est brutalement renvoyé à sa condition d’intermédiaire interchangeable, d’exécutant.
« 15 août
Cet espace est un serveur dont la synchronisation avec le monde extérieur a échoué.
Je ne suis sous le regard de personne, excepté celui, toujours changeant, des vigiles, et celui, à la fois globulaire et anguleux, des caméras de vidéosurveillance.
J’ai hâte que toutes les pièces soient arrivées, et que la livraison ait lieu. Je m’englue.
Je pense souvent ma position, mon bureau comme bocal, ma chaise étique, ma table un peu branlante, les murs seulement ponctués d’anciennes traces de scotch. »
Solitaire dans ce hangar, il attend des réponses de commanditaires invisibles et fantasmagoriques ; scrutant l’écran de son interface comme les veilleurs de l’entrepôt surveillent leurs écrans de contrôle, son attente fait écho à celles du lieutenant Drogo ou du magistrat de J. M. Coetzee, et sa condition à celle de l’écrivain.
Englué dans ce lieu déshumanisé, il est traversé par un double mouvement, faire et refaire l’inventaire de sa collection, s’arcbouter sur une position et dans un lieu désormais vides de sens, continuer l’accumulation d’objets de plus en plus morbides pour atteindre une perfection qui toujours se dérobe ou être gagné par la nostalgie des émotions, des palpitations furtives du vivant. Les œuvres qu’il continue de recevoir semblent faire écho à son état intérieur, confinement et montée en pression, contamination par l’angoisse.
Alors le texte enfle et forme une chambre d’échos impressionnante, comme une oscillation entre réel et fiction, entre mort et vie, vers la démesure de la folie.
« 1er septembre
Une membrane de vierge décapsulée, tendue dans un minuscule tambour à broder en bois. Je pense aux tigres de cirque, passant au travers des cerceaux de papiers, des cercles de feu. Je pense à cette camisole de force vue un jour dans une exposition, entièrement réalisée en ailes d’abeilles. Je pense à tout ce qui en moi ce déchire. »
Nous aurons le plaisir d’accueillir Cécile Portier à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris), le mercredi 7 novembre à partir de 19 h 30, pour une fête de lecture et de discussion autour de son roman profond et réjouissant.
Retrouvez cette note de lecture et et beaucoup d'autres sur le blog Charybde 27 ici :
https://charybde2.wordpress.com/2018/11/02/note-de-lecture-de-toutes-pieces-cecile-portier/