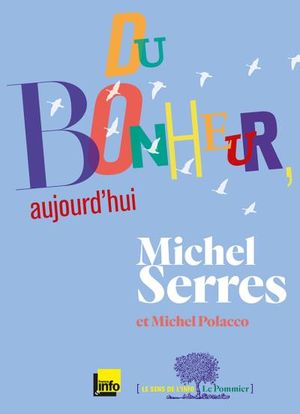Ce qui est bon comme un mécanisme de la vieillesse pour surmonter l'inéluctable est-il réellement souhaitable partout et applicable à tout âge ?
Ça y est, nous avons trouvé un remède à la tristesse, à la souffrance, à la nostalgie, à la misère, à l'horreur qui nous hante, et même à la mémoire : il s'agit de la vieillesse. Merci Michel Serres.
Auteur prolifique, Michel Serres affirme une idée puis l'explique. Les remarques s'enchaînent assez logiquement pour parvenir à une conclusion, mais il s'arrête où il atterrit sans chercher à approfondir le champ qu'il aurait pu ouvrir ou alors rebondit sans s'attarder grâce à l'usage d'un mot, d'une étymologie. C'est ce qui fait à la fois le charme de son style et sa limite. Il y a souvent un mot, soit pour renfermer la boucle soit pour s'échapper à des kilomètres.
Cela nous laisse avec des parties de vérité et des cheminements très intéressants d'un point de vue esthétique mais qui n'en restent pas moins des portions et par conséquent aussi des contre-vérités auxquels ont peut objecter par des contre-exemples.
Lorsqu'il traite de la "faiblesse" et du mauvais sort réservé aux innovations par la société idéalisant la "force", par exemple, et qu'il dit : ""Je crois que celui qui crée s'occupe de la chose, il ne s'occupe jamais de la "gagne". Voilà le secret pour inventer"", ce "jamais" casse certainement la valeur du raisonnement qu'il a déroulé jusqu'alors, raisonnement qui relevait néanmoins avec pertinence combien l'histoire des hommes se voulant force brute avait sacrifié des précurseurs et des inventeurs dont les trouvailles sont pourtant d'une importance capitale dans notre société aujourd'hui.
Ce serait effectivement se mentir que de penser qu'aucun esprit de gagne n'a jamais accompagné le parachèvement d'innovations. Et d'ailleurs, il l'insinue involontairement en citant plusieurs exemples de suicides de désormais célèbres inventeurs qui, de leur temps, n'avaient justement pas gagné la reconnaissance de leurs contemporains. Gagner le respect, ou même gagner une compétition, peuvent être les motivations additionnelles de bien des inventeurs, lorsqu'elles ne sont pas carrément fondamentales. Albert Einstein n'en démentirait pas, ce qui ne l'a pas forcé pour autant à massacrer ses collègues, au contraire.
La question revient alors à se demander si la reconnaissance implique la domination ou non, et Serres ne parle de la "gagne" que comme de la domination, de l'écrasement des concurrents.
En le lisant, on se rend compte que Michel Serres se transforme en poète de la logique pour ériger en vérités universelles des portions de pensée qui ne semblent au final correspondre qu'à un désir de s'épargner les erreurs de grande ampleur du passé, un passé qu'il a vécu de plein fouet comme des milliards d'êtres humains qui ont vu de près ou de loin deux guerres mondiales et plusieurs autres conflits impliquant tous le rassemblement de populations autour d'un but, d'un idéal, de sentiments négatifs partagés et de vulgaires intérêts stratégiques.
Mais, avec une conception du bonheur fondée sur l'oubli du passé vient également l'oubli de ses succès et, si le négatif du passé est malgré tout bien remémoré c'est sur son positif qu'est fait l'impasse. C'est à dire que, tout en se convaincant de faire le contraire, Serres fait souvent au passé le même procès que les nostalgiques du passé font au présent ou au futur en puissance.
XXème siècle, décennies des espoirs et des peines collectifs. L'auteur rend l'espoir responsable de toutes les peines, met la notion de grand projet au centre des catastrophes.
Pourtant, en condamnant toute finalité surpassant la poésie de l'instant et la connexion entre individus (Serres sonne ici malgré lui postmoderniste) sont condamnées également des constructions collectives sur lesquelles reposent encore ce présent plus heureux dont il nous parle (bonheur dont certains pays jouissent plus et mieux que d'autres étant donné la difficile adéquation de ces nouveautés du XXème siècle avec l'expansion mal pensée et plus récente d'un marché défendu en ordre quasi-spontané et dominant par les gouvernements successifs).
Ce n'est pas juste que l'on ne dise jamais assez qu'il est bon d'apprendre des erreurs du passé, mais je ne pourrais pas vivre dans cette bienheureuse et insouciante position du bonheur que Michel Serres pense avoir décelé de façon tout à fait scientifique, shooté au présent et à cette prétendue sagesse indéterministe que d'autres pensent en accord avec l'avènement tout aussi prétendu d'une quelconque réalité postmoderne là où se déroule en fait sous nos yeux l'écartèlement dans l'économie de marché de plusieurs institutions jadis victorieuses face à de multiples inhumanités, parties d'un socle sur lequel toute cette illusion postmoderne (illusion parce que coupée actuellement de ses bases) prend place. Quel bonheur dans le présent résulte du fait de couper, sans regarder vers le sol, la branche sur laquelle on s'est assis pour faire danser les mots sans cesse vers les conclusions qui nous arrange ?
Ça y est, à nouveau "la merde" n'existe plus, jusqu'à ce que nous ne posions le pied dessus par mégarde.
Le "kitsch" appliqué à la société et aux bonnes moeurs, tel que décrit pour le XXème siècle dans L'insoutenable légèreté de l'être, de Milan Kundera, semble avoir droit à une renaissance. Et s'il fallait le réinventer pour notre siècle à nous, Michel Serres l'aurait fait dans Du bonheur, aujourd'hui. Cette fois, ce n'est plus le kitsch de la Grande Marche des gens de gauche ou encore du politicien américain souriant, c'est le kitsch de la curiosité joyeuse. Une curiosité de l'instant, sans jamais sortir du cadre, qui glisse à l'aide de la poésie dans les sciences, la philosophie et les faits sociaux, pour n'en retenir que des bribes enthousiasmantes, coupées d'un passé inintéressant au mieux, menaçant au pis.
Le prédicateur n'est plus un vieux tchèque grisonnant au doigt, bien physique, pointé sur quelqu'un, mais d'humbles conteurs à l'apparence insouciante qui assènent leur prêche en la faveur de la créativité de l'instant et en défaveur, pour nous en dissuader, de toute aspiration à plus grande échelle ou à plus long terme, (que des enjeux de taille s'y trouvent ou non), cherchant à garantir par là la durabilité de leur propre conception de la fin. En économie, en philosophie, dans la justice, on les retrouve aisément, pointant, dans chaque ambition dépassant le cadre défendu, de sombres desseins déjà éprouvés autrefois ou se contentant de souligner, tels les apôtres d'un néo-darwinisme social, le caractère prétendument branlant voir dépassé des propositions.
A l'heure où ici et là sur les ondes radio résonne doucement la mélodie de Angèle : "...le spleen n'est plus à la mode... il faudrait tout oublier", ils ont, en fin de compte, une fonction presque comparable à celle de ce béat agitateur de foule dans les soirées qui crie en vous prenant le bras : "alors, tu ne danses pas ?!" parce que c'est une affaire sérieuse de danser en souriant au milieu de gens qui ne vivent que l'instant dans le Meilleur des Mondes.
En fait, on voit très bien "la merde" dans le passé mais on se cache de celle du présent ou de celle que le présent tient en puissance. C'est en cela qu'il y a un kitsch du XXIème siècle.
Alors serait-ce que Michel Serres nous fait lui aussi le coup de la fin de l'Histoire ? Pas vraiment. Il est plus sur son chemin que dans ses coordonnées exactes. L'auteur est conscient que l'époque contient des enjeux et des problématiques de taille. Mais il se coupe du passé, et nourrit une position indéterministe. En d'autres termes, dieu sait à quoi ressemblera le futur. Mais d'ici là, si le philosophe n'a pas résolu son désir de négation de ce qui brille dans le passé, fort est à parier que la curiosité joyeuse l'intéressera moins si ce futur n'est pas pour lui la reproduction du présent qu'il se fait un devoir de chérir au nom d'un "mieux" coupé de ses raisons, un présent parsemé d'une "merde" grandissante.
Au final, Du bonheur, aujourd'hui est un ouvrage agréable à lire, pour la singularité des réflexions qu'il contient et la manière élégante pourtant simple avec laquelle elles sont transmises, mais il est traversé d'une récurrente charge contre ce qui dépasse l'horizon de l'interaction entre les individus et la découverte spontanée, qui peut apparaître paradoxalement assez contraignante de part son exclusivité, et naïve dans sa louange universelle faite à la contingence et à la poésie de l'instant.
Mais au fait, quoi qu'il soit pour les uns ou pour les autres, n'y a t-il que le bonheur pour orienter sa vie ? Kundera disait : "La source du kitsch, c'est l'accord catégorique avec l'être. Mais quel est le fondement de l'être ? Dieu ? L'humanité ? La lutte ? L'amour ? L'homme ? La femme ?". Serait-ce désormais la contingence d'une curiosité locale, une danse éclectique, un télégraphe optique, un nouveau gadget sur le marché ?