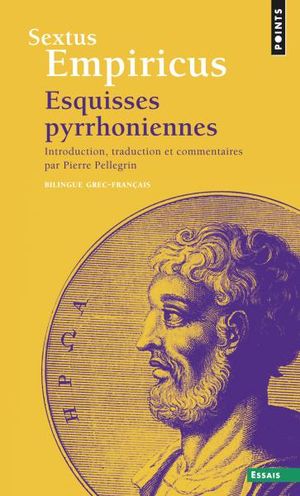Les premiers propos de l'auteur pour résumer cette école de pensée semblaient attrayants :
Ainsi la voie sceptique est appelée aussi "chercheuse" du fait de son activité concernant la recherche et l'examen ; "suspensive" du fait de l'affect advenant à la suite de sa recherche chez celui qui examine ; "aporétique" soit, comme disent certains, du fait qu'à propos de tout elle est dans l'aporie et recherche, soit qu'elle est incapable de dire s'il faut donner son assentiment ou le refuser ; "pyrrhonienne" du fait qu'il nous semble que Pyrrhon s'est approché du scepticisme d'une manière plus consistante et plus éclatante que ceux qui l'ont précédé.
Mais au lieu de recherche, je n'ai trouvé que déconstruction vers le néant, ou dit-il, vers l'aporie, cette position d'incapacité à trancher une question qui oblige donc à suspendre son jugement, manière supposée d'obtenir la tranquillité de l'âme en se libérant des opinions sur le monde.
Sextus s'attaque aux philosophes qui affirment des vérités, les "dogmatiques", à savoir principalement les stoïciens, parfois les épicuriens et aristotéliciens, et quelques autres. Il applique souvent les mêmes méthodes contre leurs propos :
- La proposition X peut être comprise soit comme X1 soit comme X2. Or X1 est impossible, et X2 est indémontrable car elle demanderait une régression à l'infini ou une acceptation de principe, donc X est fausse.
- Un tel prétend que X, mais tel autre prétend que non-X, aucun ne peut emporter la conviction, donc je suspends mon jugement
Méthodes qu'il applique même à démontrer qu'on ne peut rien démontrer quel que soit le sujet. L'auteur reconnait que sa propre démonstration s'en trouve minée, ce qui lui fait conclure que dans tous les cas, le jugement doit être suspendu. L'aporie visée ressemble donc à un piège dialectique et sophistique frisant la mauvaise foi lorsqu'il déforme les idées adverses pour les faire rentrer dans des oppositions stériles qu'il aime réfuter.
Rappelons que l'idée d'arriver à l'ataraxie par la suspension du jugement est aussi indémontrée, mais les sceptiques s'autorisent à la supposer probable. L'auteur prend même des précautions de langages en expliquant que lorsqu'il dit "toutes choses sont indéterminées" il faut comprendre "sont" comme "paraissent". Mais il ne concède pas les mêmes précautions à ses adversaires.
Ainsi le fameux pyrrhonien apparait moins comme un Socrate affirmant "Je sais que je ne sais rien" que comme un indécis volontaire qui dirait "Je ne sais pas si je veux savoir."